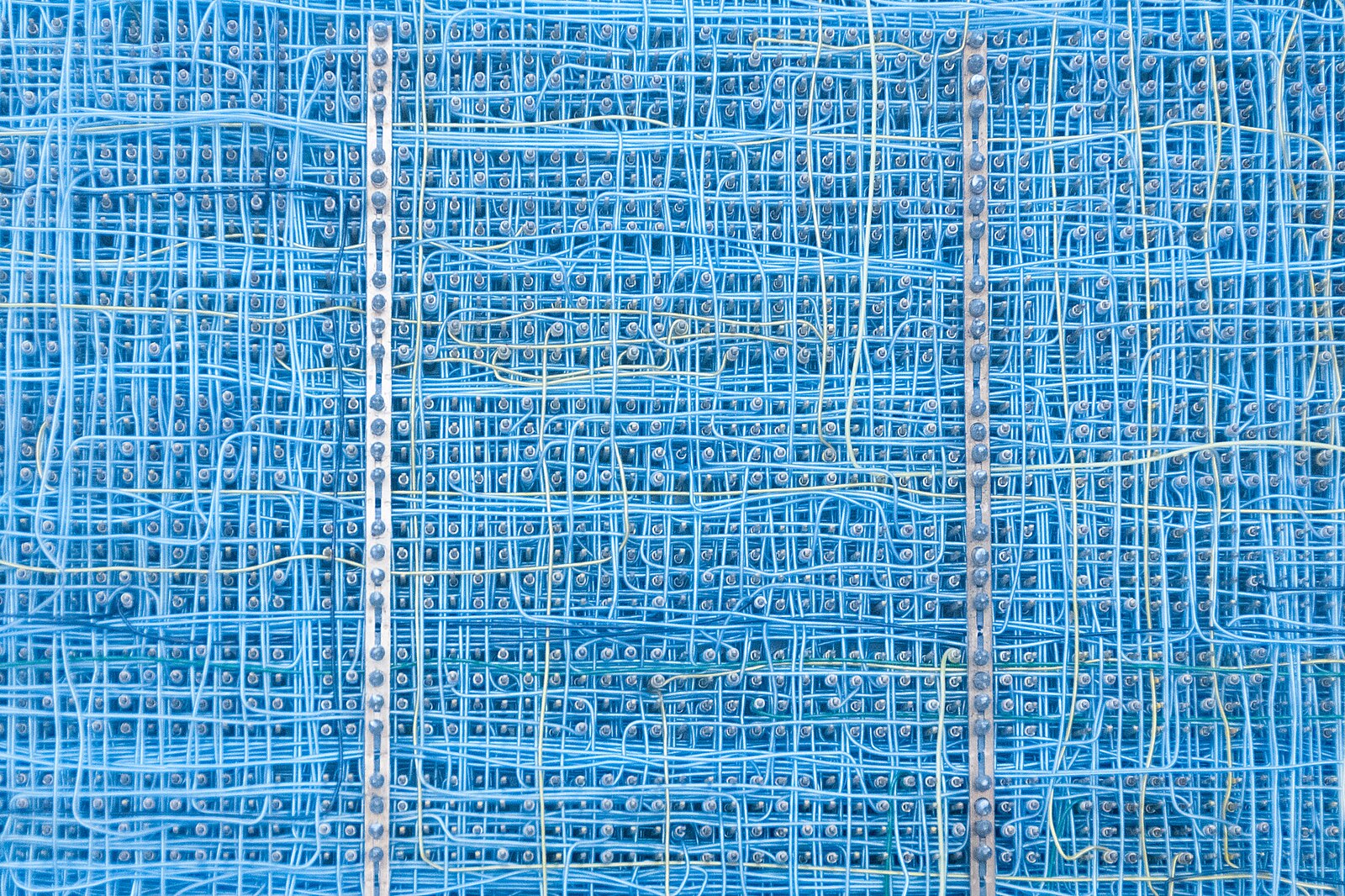Deuxième étape de notre promenade à l’ombre des commémorateurs des années 68, les grands « acteurs ». La plupart ont déjà publié des mémoires, ou des souvenirs. Or, cette année, deux personnalités attachantes, Henri Weber et Hans Magnus Enzensberger, tranchent avec l’ordinaire autocélébration : un « général », qui était en première ligne des manifestations étudiantes, nous dit comment il a changé ; et un poète, qui flânait dans les révolutions, converse avec lui-même. Apparemment aux antipodes, ils nous parlent tous les deux d’une perte de la révolution.
Henri Weber, Rebelle jeunesse. Robert Laffont, 288 p., 19 €
Hans Magnus Enzensberger, Tumulte. Trad. de l’allemand par Bernard Lortholary. Gallimard, 288 p., 22 €
Henri Weber, devenu à la fin des années 1980 un des pontes du Parti socialiste, nous raconte sa « rebelle jeunesse », particulièrement son Mai 68, dans le premier tome de ses mémoires. Étudiant en sociologie à la Sorbonne, dirigeant fondateur de la Jeunesse communiste révolutionnaire d’inspiration trotskiste et libertaire, il fut un des quatre ou cinq « généraux » qui se réunissaient chaque soir rue d’Ulm, début mai, pour organiser les manifestations. Son récit, alerte et chaleureux, nous restitue l’adolescent choqué par la guerre d’Algérie et les lâchers de napalm sur le Vietnam, devenu un quasi professionnel de la révolution (quoique vite universitaire, assistant de Michel Foucault à Vincennes). Les péripéties de sa vie politique, depuis la contestation au sein de l’Union des étudiants communistes d’avant 68 jusqu’à sa rupture avec la Ligue communiste révolutionnaire au cours des années 1980, en passant par Mai et les deux dissolutions de son organisation (JCR puis Ligue communiste), sont restituées avec bonne humeur et précision. Le témoignage est ici précieux pour les historiens. On est loin du tragique de la gauche prolétarienne, des péroraisons lambertistes ou du moralisme puritain de Lutte ouvrière. Weber fut une des figures les plus sympathiques de l’extrême gauche de ces années 68. Il fut un des inventeurs d’une autre manière d’agir, hostile à la violence minoritaire (type Gauche prolétarienne, Fraction armée rouge ou Brigades rouges). Toujours prêt à en découdre avec l’extrême droite, il voyait dans la fête, les grandes mobilisations et les « coups politiques », une nouvelle manière de secouer les consciences. « J’éprouvais, avoue-t-il, beaucoup d’excitation et de plaisir à concevoir et à organiser, avec tout un gang de complices, ces ‘’initiatives politiques centrales’’ qui nous apportaient notoriété, fierté collective et flux d’adhésions. La demande était insatiable. » Une de ses plus belles réussites fut la manifestation pour le centième anniversaire de la Commune de Paris, en 1971. Déboulant du mur des Fédérés du cimetière du Père-Lachaise, la foule a investi la Halle aux vins de Jussieu, transformée en dortoir géant, au son d’une Internationale sur un air de reggae interprétée par Jacques Higelin.

Alain Krivine et Henri Weber © Collection privée
Weber évoque, avec l’humour que ceux qui l’ont approché connaissent bien, ses amitiés politiques, sa bande de copains et ses amours – un voyage à moto vers la « révolution des œillets » au Portugal –, des rencontres avec des guérilleros urbains, tels Roberto Santucho de Cordoba, des personnalités émouvantes (Michel Recanati, Guy Hocquenghem), et sa joie de vivre. Jean-François Bizot, fondateur d’Actuel, avec qui il cultiva la dimension hédoniste de la révolution de Mai, lui fit connaître « les artistes et les auteurs de ‘’la marge’’ ». Révolutionnaire de bonne foi, Weber nous dit comment les théories révolutionnaires inspirées par Marx et Trotsky, vulgarisées et actualisées par Ernest Mandel (le gourou de la IVe Internationale !), l’ont convaincu. Comment l’embrasement des luttes émancipatrices qui secouait le monde, l’encourageait, confortait ces thèses : « Nous étions portés par l’optimisme prométhéen des années soixante. […] Le fond de l’air était rouge et la croissance française supérieure à 5 % ! Tout nous semblait possible sinon facile ». Et comment, quelques années plus tard, a éclaté une « crise de foi ». Jusqu’au milieu des années 1970, les prédictions du « grand récit révolutionnaire » se trouvaient vérifiées, et puis, les défaites s’accumulant, il a fallu en tirer les conséquences. Weber, devenu directeur de la revue Critique communiste, s’est alors consacré à une longue réflexion théorique, revenant sur le projet révolutionnaire lui-même, publiant et commentant des textes fondateurs du marxisme réformiste opposé aux bolcheviks, s’intéressant particulièrement aux changements en Espagne et au Portugal, à l’eurocommunisme en Italie, aux transformations du patronat français. Et il est revenu sur sa caractérisation de Mai comme « répétition générale » (titre d’un livre publié en 1968 avec Daniel Bensaïd) : « Notre diagnostic était erroné ». Son essai mémorable sur le sujet parut en 1988 (réédité tous les dix ans, dernière version : Faut-il liquider Mai 68 ? Essai sur les interprétations des événements, Seuil, 2008). Dans ses mémoires, Henri Weber nous raconte comment il a perdu la foi révolutionnaire et s’est construit un autre credo, social-démocrate cette fois. Loin des mea culpa ou des autocritiques, ce récit de vie, sincère et honnête, trace le cheminement d’une pensée politique de la révolution à la réforme, tout en restant fidèle à une idée du changement. « J’avais acquis la conviction que notre entreprise commune était condamnée à l’impasse et à la marginalité. »
« Peux-tu m’expliquer ce que tu as fabriqué à l’époque ? », se demande de son côté le vieil Hans Magnus Enzensberger dans Tumulte, un dialogue fascinant. Il se met en scène face a son jeune double attiré par les révolutions, poète de l’Allemagne d’après-guerre, essayiste et romancier, Prix Georg-Büchner 1963, un des fondateurs du Gruppe 47 avec Günter Grass et Ingeborg Bachmann. L’autre lui répond : « J’ai oublié la plupart des choses, et je n’ai pas compris les plus importantes ». Savoureuse confrontation qui s’est imposée à l’écrivain quand il a découvert de vieux cartons d’archives personnelles au fond d’une cave, des textes et des notes oubliées. Il y découvre ce qu’il était cinquante ans plus tôt. Ce double lui « est étranger », ressent-il en feuilletant ses notes de l’époque. « Je voulais le questionner. Mais je ne voulais pas d’un interrogatoire, ni d’une confession. […] La seule chose qui m’intéressait, c’était ses réponses à la question : Mon cher, qu’est-ce que tu pensais de tout cela ? »
Déjà reconnu, le jeune Enzensberger collectionnait alors les prix, les bourses, les invitations à des résidences ou à des voyages, des enseignements. C’était la décennie 1962-1973, sa trentaine. Beaucoup d’invitations en terres révolutionnaires, à commencer par l’URSS avec des collègues occidentaux. Il y rencontre Lili Brik, Ilya Ehrenbourg, Mikhaïl Cholokhov, Alexandre Tvardovski, et bien d’autres. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont du voyage. Khrouchtchev les fait venir dans sa datcha à Sotchi, leur tient un long discours sur le socialisme « devenu une démocratie », évoque la répression de l’insurrection hongroise en 1956, qui « n’était pas une erreur ». Personne ne bronche. « J’ai l’impression, a-t-il noté, qu’il en veut à ses hôtes d’être aussi prudents, aussi complaisants. »

Hans Magnus Enzensberger © Catherine Hélie
Passé ces visites initiatrices du socialisme version Khrouchtchev, il a abandonné un peu plus tard un poste lucratif dans une université américaine, pour Cuba. La révolution l’appelait. Il y est demeuré longuement, à La Havane en 1967-1968, censé instruire les futurs diplomates cubains des bonnes mœurs occidentales, avant d’être expulsé pour avoir défendu le poète Heberto Padilla, avec qui il s’était lié d’amitié (arrêté en 1971, Padilla a été emprisonné et contraint à une autocritique publique, il n’a pu sortir du pays qu’en 1980). C’était « un être solaire et étonnamment libre, se souvient Enzensberger, qui n’avait aucune peine à osciller entre gravité et cynisme – une personnalité typiquement cubaine ». Ses descriptions de Cuba, quelques années après la révolution, alors que des conseillers soviétiques s’installaient, avec ses commandantes et les amis de passage installés au célèbre hôtel Nacional, valent le détour. Dans ce palace, où l’on croisait jadis Lucky Luciano, Errol Flynn ou Ernest Hemingway, il se raconte « attablé avec un guérillero sur le retour et un vieux trotskiste parisien qui, agréablement subversif, bombardait tout le monde de boulettes de pain et de citations d’Engels et Freud. Il y avait là un Américain en tenue de la nouvelle gauche, qui avait l’air d’Allen Ginsberg en plus petit. Je me souviens également d’un marchand d’armes yougoslave, d’un patron pêcheur et de sa femme en voyage de noces, et d’un technicien nucléaire soviétique. Il y avait un bar à cocktails, l’eau chaude, du courant et du chauffage. Par rapport à la situation des Cubains normaux, nous avions une vie de milliardaires ». Ce qui ne l’empêcha pas d’aller couper la canne à sucre (il en a conservé une machette, chez lui) et de remarquer le sort réservé aux homosexuels. « Fainéants », « contre-révolutionnaires », « immoralistes », ils avaient droit à des camps de travaux forcés spéciaux.
Ces séjours étaient entrecoupés d’allers-retours à Berlin. Il y retrouvait ses amis de la gauche critique, il se sentait proche de Rudi Dutschke dont il ne comprenait pas toujours les discours, « le seul leader politique qu’a produit l’opposition au système ». Il ouvrait sa maison, et accueillait tout le monde. Une fois sont passés Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin et « l’abominable » Andreas Baader traqués par la police. « Les femmes lui étaient soumises inconditionnellement. Il se comportait avec elles comme un souteneur. Ulrike parla avec désespoir de la nécessité d’abattre le ‘’système’’ par la violence. Je lui dis que je ne souscrivais pas à pareils fantasmes. Baader prononça le verdict. Il fut unanimement déclaré que j’étais un lâche. » Ainsi se déroulait pour lui le temps des révolutions – on le voit encore en Italie, en France, en Asie et dans bien d’autres circonstances – entre les grands espoirs et les délires autoritaires, un temps vécu comme un film, avec des flashs et une sorte d’incohérence. Le temps d’un tumulte.
Au cœur de ce tumulte, son « roman russe », c’est-à-dire sa relation avec Macha, une belle et passionnante russe qu’il avait rencontrée lors d’un voyage à Saint-Pétersbourg, et épousée. Le roman a mal tourné. Macha incarne dans cette douce introspection, avec ses hauts et ses bas, telle une allégorie, la révolution désirée et perdue. Ce qui plaisait au jeune Enzensberger avec ce tumulte, « c’était l’ébranlement de l’ordre allemand. C’était à la fois urgent et irrépressible. Pour moi, c’était la principale attraction. Antiautoritaire – tel était le slogan. Cela ne me gênait pas de risquer moi-même de devenir une espèce d’autorité… ». Tandis que le vieil écrivain de près de 90 ans n’y voit plus que « charabia et criailleries ». Finalement, le jeune avoue n’y avoir « jamais cru ». C’est donc la révolution qui s’efface.