Frank Witzel a travaillé de nombreuses années à ce roman dont le titre à la fois interpelle et suggère une volonté de relier la fiction à l’histoire collective et aux souffrances psychiques individuelles. Ce fut un succès : le livre trouva un écho immédiat chez ses compatriotes qui lui attribuèrent en 2015, un peu contre toute attente, le prestigieux Prix du livre allemand. C’est un roman long, touffu, qui mêle les genres et les points de vue aussi bien que les temps. Si l’intrigue existe, elle suit une chronologie discontinue, obéissant à une logique qui relève du rêve ou de l’imagination. Mais une vérité se fait jour peu à peu, dans l’échange avec le policier qui enquête, la confession que le prêtre ou le médecin recueille, les pages griffonnées sur un coin de table.
Frank Witzel, Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la fraction Armée rouge au cours de l’été 1969. Trad. de l’allemand par Olivier Mannoni. Grasset, 990 p., 29,90 €
Les faits relatés ont pour point de départ l’année 1969. Le narrateur, tout comme l’auteur, a alors un peu plus de treize ans. Le roman de Witzel s’ouvre sur une poursuite, comme dans un polar. Mais, d’emblée, le lecteur est pris à contrepied, l’intensité dramatique se résout dans la loufoquerie, le rythme faisant davantage songer à une bande dessinée où manqueraient les dessins : ceux qui fuient au volant d’une voiture volée (une NSU Prinz, voiture d’époque !) sont de jeunes lycéens, et leurs armes sortent tout droit du coffre à jouets ! Cette parodie pourtant laisse transparaître une réelle menace, car la poursuite évoque immédiatement la traque des terroristes qui avaient placé des bombes à Francfort moins de deux ans auparavant. Et le journal télévisé s’en mêle.
Un rappel historique n’est sans doute pas inutile, au moins pour les plus jeunes lecteurs. Les attentats perpétrés en avril 1968 à Francfort par Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll et Horst Söhnlein révélèrent l’existence en Allemagne d’un mouvement révolutionnaire prêt à passer à l’action violente, qui allait bientôt prendre le nom de « Fraction Armée Rouge » (Rote Armee Fraktion, ou RAF), et opérer durant une trentaine d’années, jusqu’à son autodissolution en avril 1998. Le groupe, qui entretint rapidement des contacts avec des terroristes d’autres pays et se rapprocha d’Action directe et des Brigades rouges italiennes, est responsable de plus de trente morts sur le sol allemand, de l’enlèvement de Hanns Martin Schleyer, président du patronat allemand (qui se termina tragiquement) à l’assassinat une quinzaine d’années plus tard de Detlev Karsten Rohwedder, responsable de la Treuhand, structure mise en place lors de la réunification allemande pour privatiser les biens situés en ex-RDA. L’incarcération puis la mort des fondateurs de la RAF dans la prison de Stammheim ont en leur temps fait couler beaucoup d’encre dans le monde (Jean-Paul Sartre alla jusqu’à leur rendre visite dans leur cellule).
C’est dans cette sombre période de l’histoire allemande que se situe le roman, dans ces « années de plomb » dont témoignent plusieurs livres et films (1). Sans doute la fin des années soixante a-t-elle marqué le monde entier : le Che est mort en octobre 1967 en Bolivie, et l’offensive du Têt a commencé au Vietnam en janvier 1968 – une année qui a fait date ! Mais est-ce un hasard si la violence qui a touché l’Europe a pris tant d’ampleur dans une Allemagne pourtant en paix, avant de gagner des pays voisins comme l’Italie et la France ? Les Alliés avaient dû s’appuyer pour reconstruire le pays sur une population laminée par douze ans de dictature, et les rouages du pouvoir étaient en partie entre les mains d’hommes qui avaient fait leurs classes dans l’administration hitlérienne, « dénazifiés », blanchis – ou discrets sur leur passé.
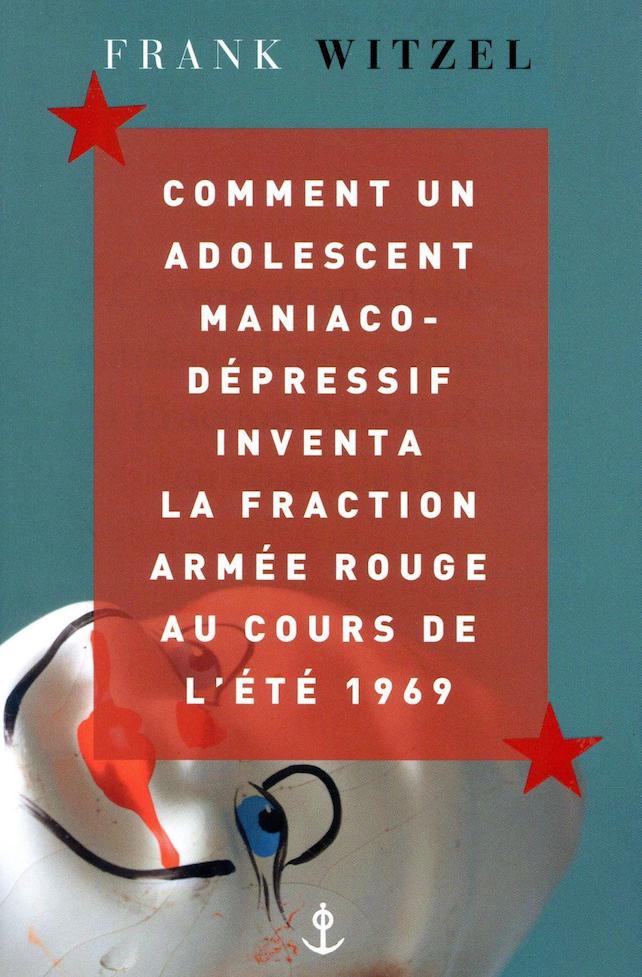
Du coupable avéré au simple comparse, toute une génération était suspecte, les scandales révélés par la presse aidant, et les adolescents se heurtaient au silence, quand ce n’était pas à la nostalgie du temps où la Wehrmacht triomphait. Leurs histoires familiales comportaient des blancs, et il se répandit dans le pays une sorte de névrose collective, née d’une absence de réponse à des questions qu’ils n’osaient le plus souvent pas poser, tandis que leurs parents se réfugiaient dans leur nouvelle prospérité, mettant le passé entre parenthèses. Il faut souligner que la République fédérale telle qu’elle apparaît ici appartient désormais à l’Histoire, elle n’existe plus aujourd’hui sous la même forme : ses contours ont changé, Bonn n’en fut que la capitale éphémère. Ce qui survit encore de cette république première manière, née de la volonté des vainqueurs de 1945, est désigné par les Allemands sous le nom de « anciens Länder », faisant implicitement référence aux temps révolus où l’Europe était coupée par un « rideau de fer » qui lui barrait l’horizon oriental. Dans les années soixante, c’était un pays qui vivait un traumatisme identitaire face à sa rivale communiste qui parlait la même langue, avait le même droit à se réclamer de l’histoire allemande, et lui disputait l’héritage culturel. Un pays qui affichait encore dans ses journaux les prévisions météorologiques pour les provinces situées au-delà de la ligne Oder-Neisse, à Stettin, Breslau ou Königsberg. Un pays qui se cherchait sans vraiment se trouver, déjà puissant par son économie, mais largement dépourvu d’indépendance politique. Une sentinelle occidentale aux frontières du « bloc de l’Est »…
Un pays, donc, apparu malgré lui sur la carte, qui tente de s’édifier sur les décombres de l’Allemagne nazie qu’il suffit de gratter pour en sentir encore les fumées malodorantes. À quoi donc un adolescent de treize ans pourrait-il se raccrocher ? Sortant à peine de l’enfance, il n’a pas encore de passé propre, et, quand il se retourne, il ne voit rien par-dessus son épaule, sauf peut-être ce que ses parents lui ont montré, raconté, transmis. Mais les parents de 1969 souffrent d’une amnésie partielle, voire totale, en ce qui concerne des événements vieux de plus d’un quart de siècle. L’adolescent décrit dans le roman craint de grandir dans le monde qu’il découvre, un peu comme le faisait le héros du Tambour de Günter Grass, entraîné dans l’écroulement de l’Europe. « Puer aeternus » accablé par le poids d’un passé qui n’est pas le sien mais qui pèse sur ses épaules, en un temps où les mères aussi sont coupables parce qu’elles sont impuissantes ou paralysées, ou parce « qu’elles ne nourrissent plus l’enfant, mais qu’elles se nourrissent elles-mêmes de lui ». La crise d’adolescence se confond avec la critique sociale : car la République fédérale non plus n’a pas de passé, elle vient d’avoir vingt ans en 1969, et ses racines, comme celles de sa sœur détestée la RDA, plongent dans un terreau maudit, une histoire impossible à assumer, mais qui se prolonge pourtant puisque ses principaux acteurs sont toujours là. Quand les repères se dérobent, « quand l’historiographie officielle se perd, la seule possibilité consiste à donner sa propre histoire au passé ».
« Vous êtes celui qui est resté coincé quelque part en 1969, comme si vous n’aviez plus vieilli ensuite, comme si vous n’aviez pas aussi eu une vie par la suite et jusqu’à ce jour », dit au narrateur celui qu’on ne peut guère appeler que psychologue ou enquêteur. Relier la contestation, puis le terrorisme des jeunes à l’impossibilité de construire et de lire leur histoire, c’est le propos de ce livre, mais il le fait d’une façon non didactique, tentant d’exposer au jour le jour les angoisses et les désirs d’un homme qui se veut désespérément « normal », mais qui vit dans un monde qui revendique ses nouvelles certitudes et cherche à le convaincre que le malade, c’est lui. L’auteur prend son temps, le roman est long, protéiforme, mais c’est dans ce qui se construit et se partage peu à peu, dans ce que le livre distille lentement au lieu de l’asséner, que le public allemand d’aujourd’hui a pu reconnaître son vécu ou celui de ses parents et offrir à Frank Witzel un succès aussi total qu’inattendu.
Le ton varie – humour, ironie et même franche plaisanterie alternent avec gravité, noirceur et tragique. L’adolescent du début vieillit, même s’il ne devient pas vraiment adulte au sens où les autres le voudraient, et sans en être quitte pour autant avec les interrogatoires : a-t-il commis, après ses premiers démêlés avec la police, d’autres méfaits qui le conduisent devant un officier du renseignement ou un juge d’instruction, ou bien son état mental justifie-t-il l’intervention d’un médecin ou d’un psychiatre ? Est-il possible que « quelqu’un veuille avouer quelque chose qu’il n’a pas du tout commis » ? L’auteur entretient habilement le doute autour de ces questions et laisse au lecteur le soin d’interpréter les indices.
D’un chapitre à l’autre (il y en a quatre-vingt-dix-huit), la perspective change du tout au tout. Ce sont parfois de simples maximes philosophiques, voire des apories, et on trouve quantité de références aux philosophes allemands (Heidegger, Marcuse, Adorno) mais aussi français (Sartre, Camus, Foucault ou Derrida), avec lesquels le narrateur entame le dialogue. Parfaitement à l’aise avec les divers aspects de la pensée moderne ou postmoderne, de déconstruction en reconstruction, l’auteur révèle de page en page de solides connaissances culturelles qui s’étendent aussi au cinéma et à la musique, intégrant à l’histoire de son personnage les célèbres groupes de rock qui se sont succédé et l’ont accompagné depuis son enfance. Sans oublier la littérature qui tient ici une place de choix, la découverte par exemple de Peter Handke reconnue comme expérience décisive.

Frank Witzel © Maja Bechert
Les entretiens relatifs aux besoins de l’enquête ou à la thérapie imposée au narrateur occupent une bonne partie de l’espace du roman, mais on y trouve aussi beaucoup d’autres choses, dont des récits qui constituent à eux seuls une petite œuvre dans l’œuvre, où l’on voit parfois surgir des personnages surprenants qu’on pourrait croire à tort étrangers au fil romanesque. Ou des pages qui ressemblent à celles d’un journal que le narrateur tiendrait avec application pour tenter de se trouver soi-même. Une « thérapie contextuelle, dans laquelle le patient se représente un contexte historique ou géographique, familial ou social dans lequel il produit des souvenirs quasiment fabulés » ?
La religion aussi tient une place importante dans une œuvre où s’expriment les doutes d’un homme marqué par son éducation catholique. Le cadavre décharné de Holger Meins, membre de la RAF mort en 1974 en prison des suites d’une grève de la faim, évoque irrésistiblement le Christ, et le lecteur découvre avec stupeur de « brèves hagiographies des membres de la Fraction Armée Rouge », où l’auteur imagine par exemple qu’Andreas Baader abat l’instituteur du petit Indien Winnetou (2) et erre au pays des Apaches, qui finissent par le scalper et le noyer. Autre exemple, un passage est consacré à la figure historique de Grégoire, grand théologien du IVe siècle qui fut ordonné prêtre par son propre père, qui se qualifie lui-même ici de « déchet de Dieu » et qui est né – ça ne s’invente pas – à Nazianze, en Cappadoce ! Quand le récit dérape aux frontières du réel et explose dans une fantaisie débridée qui lui permet tout, du burlesque à l’absurde en passant par le fantastique, quand les certitudes habituelles deviennent dérisoires et que le monde sort de ses gonds, c’est un peu l’esprit des plus anciens qui se manifeste sans qu’on ait eu besoin de l’invoquer, celui de Bruno Schulz ou d’Alexander Wat, de Franz Kafka ou d’Alfred Kubin.
Le narrateur comme les membres de la RAF – du moins tels qu’il les conçoit dans le rapport incertain qu’il entretient avec eux – souffrent d’un mal enraciné dans un temps où le monde issu de la guerre était divisé en deux camps entre lesquels il fallait choisir, sans toujours souhaiter ni pouvoir le faire. Il déteste d’ailleurs toutes les alternatives, parce qu’elles lui sont imposées par les autres : le monde est-il binaire ? À l’image d’une personnalité, les sociétés aussi peuvent-elles être « bipolaires » – ou carrément schizophrènes ? Une des manifestations du mal dont le narrateur souffre, c’est justement l’impression d’être « ventriloqué », de parler d’une voix qui n’est pas la sienne, dans une langue qu’il n’a pas choisie et que le passé récent a durablement pervertie : « D’une manière générale, les nazis ont contaminé toute la langue allemande ». La constatation n’est pas nouvelle, mais c’est pour l’auteur prétexte à un long passage qui, là encore, ne laissera pas de surprendre le lecteur.
Car le roman de Frank Witzel déroute, et sa longueur – peut-être excessive – pourrait décourager. Pourtant, on s’adapte vite et sans peine à la discontinuité de l’écriture et au mélange des temps, car l’auteur a tout prévu pour qu’on ne se perde jamais complètement, même en ayant parcouru trop vite quelques pages : le chapitre suivant ramènera à coup sûr dans le bon chemin ! Et ce qui ne gâte rien, on est souvent ébloui par l’écriture, par ses incursions dans le langage poétique, et les quatre-vingt-dix-huit chapitres sont autant d’images d’un kaléidoscope dont les couleurs chatoyantes ne perdent rien de leur éclat dans la belle traduction d’Olivier Mannoni.
-
On retiendra par exemple : La troisième génération (Fassbinder, 1979), Les années de plomb (Margarethe von Trotta, 1981), Stammheim (Reinhard Hauff, 1986), ou Les trois vies de Rita Vogt (Volker Schlöndorff, 2000).
-
Personnage de fiction créé en 1879 par le romancier Karl May. Ses aventures ont été plusieurs fois portées à l’écran.












