Parmi les écrivains canadiens à l’honneur du Festival America 2018, il y avait D. W. Wilson, auteur de La souplesse des os, recueil de nouvelles situées dans la vallée de la Kootenay, coin reculé de Colombie britannique et lieu de son enfance. EaN a pu s’entretenir avec lui à Paris.
D. W. Wilson, La souplesse des os. Trad. de l’anglais par Madeleine Nasalik. L’Olivier, 272 p., 23 €
Dans ce livre très poétique, vous avez élaboré votre propre idiome. Cela doit être difficile à traduire.
J’apprends le français depuis un an, je regrette de ne pas le lire mieux. J’aurais voulu voir comment Madeleine m’a traduit, la moitié de mon jargon est complètement inventée.
Ce ne sont pas des mots que vous avez entendus ?
C’est un mélange entre le langage que j’ai entendu enfant dans la vallée [de la Kootenay], d’une part, et, d’autre part, une extrapolation.
La métaphore du squelette est omniprésente, que ce soit dans le titre de la première nouvelle, « La souplesse des os », ou dans celui de la dernière nouvelle, « Tu te bousilles un doigt une fois », pour ne pas parler de la manière dont le narrateur décrit le coït : « boning. »
J’aime ce mot, la sonorité profonde du « o. » On trouve le « o » au cœur de beaucoup d’émotions – la souffrance, la joie, la peur –, donc « bone » y correspond. En plus, les os sont la partie forte de l’anatomie ; lorsqu’ils se cassent, cela crée un effet dramatique.
Dans la première nouvelle, ils auraient pu se casser, parce qu’il s’agit d’un match de judo. Avez-vous pratiqué ce sport ?
Je l’ai fait pendant treize ans avant de recevoir un coup de pied dans le visage qui m’a déréglé la mâchoire. J’ai dû arrêter à cause de cet accident.
Les accidents sont importants ici. John Crease, père du héros de plusieurs nouvelles, Will Crease, se fait tirer dessus au cours d’une mission dans le Kosovo, alors qu’il intervenait dans une dispute domestique. Dans « Les routes mortes » – lauréat du BBC National Short Story Award en 2011 –, l’ami du narrateur, Animal Brooks, est renversé par une voiture. Et puis dans une troisième nouvelle, une balançoire se casse, provoquant une mort.
On a beaucoup critiqué ce livre pour sa violence. Je ne suis pas d’accord. Souvent, je me retiens : par exemple, dans la première version de « Les routes mortes », quand Animal était renversé, il se cassait la jambe (dans la version finale il n’est pas blessé). J’évite d’aller jusqu’au bout pour ne pas donner au lecteur ce qu’il attend. En ce qui concerne les accidents, je les trouve plus tragiques que la violence délibérée : c’est plus poignant de perdre quelque chose lorsqu’on aurait pu l’éviter. La violence préméditée est sinistre. J’aime que mes personnages portent le poids de la tragédie plutôt que le poids du mal.

D. W. Wilson
Au fond vous vous intéressez au destin.
Absolument, la fatalité. Pendant longtemps j’ai médité sur l’orientation que devrait prendre mon travail. Ces hommes ne sont pas mauvais, je refuse de les condamner. Ils sont figés dans l’espace situé entre la masculinité et l’émotion : cela a toujours été mon sujet. On a grandi ensemble, mais ils n’ont pas réussi à s’échapper de la vallée, ils sont emprisonnés par les attentes claustrophobes de la communauté, par leurs horizons limités. J’écris sur ces hommes très masculins.
Pourriez-vous nous raconter brièvement les grands contours de votre vie ?
J’ai grandi dans la vallée de la Kootenay. J’ai toujours voulu être écrivain, mais je ne sais même pas comment cela m’est arrivé. Mes parents lisaient peu. Néanmoins, ils m’ont encouragé à lire. Après le lycée, j’ai travaillé pendant un an comme électricien. J’ai ensuite fait une licence dans le programme d’écriture créative à l’Université de Victoria, puis une maîtrise et un doctorat à l’Université d’East Anglia, en Angleterre. Mais quel a été le premier pas ? Qu’est-ce qui fait que je n’étais pas à l’aise avec une vie où j’écrasais les écureuils sur la route comme le faisaient mes potes ? Pourquoi n’étais-je pas à l’aise avec les codes de la masculinité ? Sans doute à cause de mes parents. Mon père est flic. Il est taciturne mais très sentimental, comme beaucoup de membres de la police montée [Gendarmerie royale du Canada, en anglais : « Royal Canadian Mounted Police »]. En fait, il est John Crease.
Alors vous seriez son fils Will Crease, héros récurrent de ce recueil ?
Dans un premier livre, on éjacule tout ce qu’on a. Mon père s’appelle John, ce recueil a commencé avec « La souplesse des os ». J’étais dans ma troisième année à la fac, je n’avais aucune idée de ce que je voulais écrire, je faisais du mauvais Hemingway, j’ai reçu une mauvaise note de ma professeur Lorna Jackson – elle est la meilleure –, qui m’a conseillé d’écrire sur quelque chose que je connaissais. Quand j’étais enfant j’avais combattu mon père dans un tournoi de judo, donc je l’ai mis au cœur du récit. Et j’ai modifié l’interligne de mon logiciel de traitement de texte – créant un interligne de huit – pour que je ne puisse voir que trois lignes à la fois sur l’écran, parce que Lorna m’avait dit qu’il fallait se focaliser sur sa ligne. Et quand je lui ai rendu cette nouvelle, elle m’a dit « Ça y est. »
A l’Université de Victoria vous n’avez étudié que l’écriture pendant quatre ans, vous n’avez pris aucun cours de littérature ?
Uniquement l’écriture, dans des ateliers.
Enfant, que lisiez-vous ?
J’ai lu beaucoup de science-fiction.
Par exemple ?
La roue du temps de Robert Jordan, des trucs comme ça. J’ai arrêté à la fac. Le passage de la science-fiction à Hemingway m’a ouvert les yeux. Il a beaucoup compté. C’est l’écrivain le plus ancien que j’ai lu. Le plus important a été Tim Winton. Lorna m’a donné Angélus. Mon Dieu ! La souplesse des os est une sorte de cousin d’Angélus, qui est un recueil de nouvelles interconnectées situées sur la côte Ouest de l’Australie. Les personnages principaux sont un flic et son fils – le père de Winton avait été policier. C’était bizarre. Je me suis dit : « Oh, c’est comme ça qu’on peut faire. »
Quels sont vos auteurs préférés ?
Je suis très fan de Wallflowers et de Demi-Gods d’Eliza Robertson. Et j’aime Lorrie Moore, Lauren Groff et feu James Salter. Oh, et Denis Johnson, j’adore ce mec.
Pourriez-vous décrire la vallée de la Kootenay ?
Elle est nichée entre les Rocheuses – énormes, déchiquetées et étouffantes – et les Purcells, plus vallonnées et plus douces. Il y a la ville d’Invermere, situé sur le lac Windermere, qui est assez grand. J’ai un peu simplifié la géographie pour les besoins de ma fiction. En hiver, il y a des sports saisonniers dont le ski ; en été, il y a beaucoup de tourisme, avec de nombreux terrains de golf.
Mais ce n’est pas du tout le portrait que vous avez dressé.
En effet. Quand j’étais enfant on n’avait pas beaucoup d’argent. Mon papa était le seul gagne-pain, il avait un salaire correct mais il n’était pas plein aux as. La plupart de mes amis étaient dans une situation similaire. Aujourd’hui, il y a de l’argent. Il y a eu un boom, notamment dans le bâtiment. On l’aperçoit brièvement dans certaines de mes nouvelles.
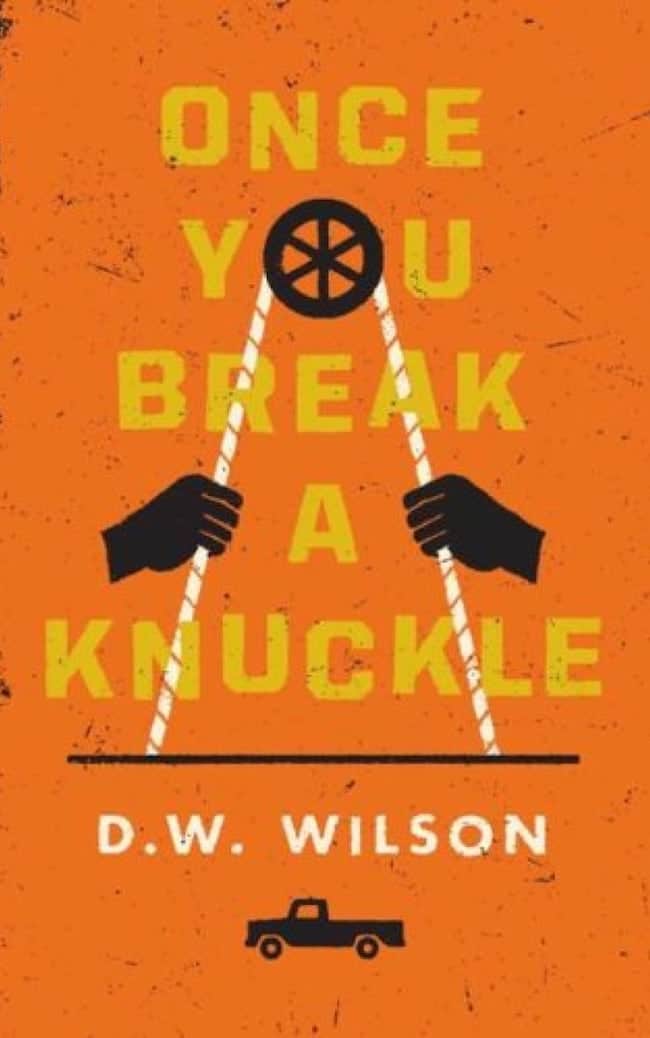
Un autre aspect intéressant de votre univers concerne la violence sous-jacente. On pense à un film de Hitchcock, ou aux récits de Joyce Carol Oates. Comme chez elle, la possibilité d’un viol n’est jamais loin de l’esprit.
Cela crée une tension dramatique. Avez-vous lu « Save the Reaper » d’Alice Munro (nouvelle dans le recueil L’amour d’une honnête femme) ? C’est comme « L’écho au fond de la vallée » : les personnages arrivent dans un endroit où il y a des péquenauds du Nord de l’Ontario. Malgré les apparences, il n’y a probablement pas de danger, néanmoins un sentiment de menace plane, comme dans un jeu vidéo ou un film d’horreur. Cela rejoint ce que je disais sur le fait de ne pas aller jusqu’au bout de la violence.
La nouvelle la plus longue dans ce récit – « L’écho au fond de la vallée» –, composée de plusieurs « tableaux, » raconte, entre autres, comment un fils et un père partagent une même maîtresse.
C’est la nouvelle la plus difficile que j’ai jamais écrite. J’ai dû demander un délai.
À l’Université de Victoria ?
Presque toutes ces nouvelles sont passées par les ateliers à Victoria. En gros, j’avais déjà terminé le recueil avant d’arriver à East Anglia. En tout cas, quand j’écris, je ne fais que suivre la voix : je l’écoute, je laisse venir la phrase suivante. Le père couche avec la femme vers le début du récit. Cette nouvelle est un écho, un miroir du début à la fin, une même histoire répétée deux fois. Quel est le mot – j’ai un blanc de mémoire – il commence en « o, » et concerne les fils qui baisent leurs mères ?
Œdipe.
Voilà. En effet, il y a ces allusions et cela m’a plu. Souvent les relations père-fils sont assez positives, alors que dans celle-là, ce nest pas du tout le cas, bien que Conner (le fils) ait beaucoup essayé.
Le personnage du père, John Crease, est excentrique et sympathique. Il est toujours habillé en T-shirt porteur d’un slogan. Votre père faisait-il pareil ?
Oui, c’est un détail que je n’ai pas pu lâcher. Il avait des T-shirt avec des slogans ridicules, dont « La douleur, c’est simplement de la faiblesse qui quitte le corps » ou « Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. »
Êtes-vous professeur d’écriture créative ?
Je l’ai été. J’ai reçu une subvention du Conseil des arts qui m’a permis d’arrêter. Cette année, je donne un cours sur l’histoire des jeux vidéo à l’Université de Victoria, en tant que conférencier contractuel. C’est très amusant : on joue aux jeux vidéo dans la classe. On a joué à Space War 1962, le premier jeu de l’Histoire.
Ça fait partie de quel département à l’université ?
L’Histoire de l’art.
Propos recueillis par Steven Sampson












