Les sagas islandaises racontent le plus souvent les hauts faits des ancêtres. Mais s’agissant des intellectuels français de la seconde moitié du siècle dernier, où sont les hauts faits ? On ne peut pas leur reprocher de n’avoir pas eu d’idéaux, mais ont-ils eu les bons ? La chronique de François Dosse nous invite à contempler le déclin et la chute de l’intellectuel prophétique, mais le problème est ailleurs : c’est d’intellectuels tout court que les Français ont manqué.
François Dosse, La saga des intellectuels français, 1944-1989. À l’épreuve de l’histoire, 1944-1968 et L’avenir en miettes, 1968-1989. Gallimard, 2 vol., 622 et 689 p., 29 € chacun
C’est loin d’être le premier livre de François Dosse sur ce sujet, qui est devenu un pont aux ânes de l’historiographie française. Dosse est l’auteur de nombreuses études sur l’histoire intellectuelle du XXe siècle : une histoire du structuralisme, un livre sur l’histoire des intellectuels, un autre sur l’historiographie, et de nombreuses monographies-biographies sur Ricœur, de Certeau, Deleuze, Nora, Castoriadis et alii, et même Macron. Cette fois, il se lance dans une vaste fresque de ce qui s’est passé depuis 1944 jusqu’en 1989 dans notre Landerneau. Le récit est supposé retracer les aventures des intellectuels français depuis la Libération jusqu’à la chute du mur de Berlin, et leurs liens avec les événements politiques et sociaux. Vaste programme.
Le premier volume couvre la période qui va de la Libération à 1968 : les débats autour du Comité national des écrivains, l’épuration, l’omniprésence des communistes, leurs fidèles et leurs dissidents, la création des Temps modernes et la vague sartrienne, les querelles avec Camus, Merleau-Ponty, la naissance de Socialisme ou barbarie, la guerre d’Algérie, la vague structuraliste, Mai 68. Le second volume va de l’après 68 à la chute du mur de Berlin, en passant par le courant féministe, l’écologie, l’affaire Soljenitsyne, l’épisode des nouveaux philosophes, la naissance de l’humanitaire et du droit de l’hommisme.

Raymond Aron
On apprend bien peu en lisant ces livres, tant cette histoire est connue, et tant l’auteur fait peu d’efforts pour l’éclairer sous de nouveaux angles. Le style est journalistique, les figures passées en revue échappent peu à leurs médaillons: l’éternel Sartre sur son éternel tonneau, l’éternelle Castor distribuant La Cause du Peuple, l’éternel Sollers pape de Tel Quel, l’éternel Barthes éternellement bougon pendant son voyage à Pékin, Ricœur et son éternelle poubelle. On croirait lire une longue série d’articles du Nouvel Obs. Quelques épisodes éditoriaux, tels que la naissance de la revue Le Débat, ou le mouvement féministe, sont un peu plus étudiés, et apportent des éclairages. Les passages les plus intéressants sont ceux qui portent sur les courants de droite, des « hussards » à la nouvelle droite, et sur les intellectuels chrétiens, des catholiques aux protestants – particulièrement de Certeau et Ricœur, que l’auteur a beaucoup chroniqués.
Mais ce qui frappe surtout, à la lecture de ces 1 300 pages d’anecdotes mises bout à bout, c’est le peu d’efforts fait par François Dosse pour sortir des clichés : la liberté sartrienne, le sens de l’histoire marxiste opposé aux structures des Lacan, Althusser, Foucault ou Lévi-Strauss, la pensée désirante de Deleuze-Guattari contre la psychanalyse, toutes ces doctrines défilent, portées chacune par leurs marionnettes, sans que les discussions intellectuelles soient abordées. L’auteur ne propose même pas de grille de lecture autre que le passage du temps : on passe de l’intellectuel prophétique, supposé porter l’universel et engouffré dans la soufflerie du vent de l’histoire, aux désillusions et au « retrait du politique ». Il n’y a pas de tentative d’explication sociologique ou transhistorique de ces courants, comme dans les deux volumes dirigés par Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, qui au moins essayaient de sortir du récit héroïque et personnalisé.
Par exemple, aucun effort n’est fait pour essayer d’expliquer comment une bonne partie de l’histoire des intellectuels français et de leur surinvestissement dans le politique et le journalistique tient à la faiblesse, dans notre pays, de l’université (qui explique à bien des égards la crise de 1968, mais aussi le désir permanent des intellectuels de lui échapper pour refonder ailleurs leur légitimité – sans parler de Sartre, Aron au Figaro, Revel à L’Express, Althusser au Parti, Deleuze à Vincennes, Derrida aux États-Unis). Aucun effort n’est fait pour comprendre comment, dès les années 1970 et 1980, avec notamment l’épisode, grotesque mais si significatif, des « nouveaux philosophes », une culture encore ancrée dans les revues et les bastions intellectuels éditoriaux s’est transformée en satellite des émissions de télé. Régis Debray avait raison quand il a fustigé l’empire de Bernard Pivot et d’Apostrophes. Il a compris qu’on avait changé d’époque. Nous nous sommes moqués des neocons américains, et rions aujourd’hui de Trump, mais nous avons oublié que Deleuze et Bourdieu avaient soutenu la candidature de Coluche à la présidentielle de 1981.

Pierre Bourdieu
Et pourtant, malgré ses défauts, le livre de François Dosse est utile. Il nous rappelle en creux combien, d’une part, les intellectuels français sont provinciaux, et surtout combien la définition de l’ « intellectuel » dans notre pays est biaisée et erronée. Quant au provincialisme, que n’aborde jamais Dosse, il est accablant. Il l’est d’autant plus que les Français n’ont cessé, sans le dire, de lorgner outre-Rhin ou outre-Atlantique. François Dosse ne dit rien du véritable magistère de Heidegger sur la philosophie, mais aussi sur la gent intellectuelle française, qui est pourtant une donnée fondamentale de l’histoire des années 1944-1989 et au-delà. Simone de Beauvoir a certes existentialisé le féminisme, ou féminisé l’existentialisme, mais bien peu encore notent ce que Le deuxième sexe doit à Margaret Mead. Certes, dans le domaine phare pour les Français, la théorie politique, Raymond Aron a fait le travail nécessaire en introduisant Weber, Simmel ou Veblen, en revisitant Tocqueville, et, par son association avec les libéraux américains, il a été l’un des rares français de la période à prendre ses références ailleurs que dans l’hégélianisme et le marxisme. Mais comment est-il possible que John Rawls n’ait été traduit qu’à la toute fin des années 1980, ce dont ne dit mot François Dosse ? S’il s’était interrogé sur les raisons pour lesquelles un livre aussi fondamental que la Theory of Justice a été, pendant vingt ans au moins, zappé par les protagonistes de son histoire, celle-ci eût été plus juste. Cela ne s’explique pas seulement par le fait que ce livre ait été perçu comme « libéral », par les Français, mais par le fait que les moyens intellectuels de le comprendre leur manquaient, y compris pour s’y opposer.
Pourquoi, par ailleurs, François Dosse ne dit-il mot de Bourdieu, dont les travaux et la revue Actes de la recherche en sciences sociales inspirent la sociologie dès les années 1970 ? Pourquoi ne dit-il rien non plus de sociologues comme Raymond Boudon, qui sont du bord opposé, mais si peu provinciaux intellectuellement ? Pourquoi des intellectuels qui n’ont cessé de critiquer le modèle de l’intellectuel à la française qui fait l’objet de ce livre, comme Jacques Bouveresse, en sont-ils si obstinément absents ? Pourquoi le seul titre de gloire de Georges Canguilhem dans ce livre est-il d’avoir patronné la thèse de Foucault ? Pourquoi aucun mot n’est-il dit de philosophes comme Jules Vuillemin ou Gilles Granger, qui ont incarné le courant rationaliste envers et contre tous ? Étaient-ils trop « universitaires » pour figurer ici ? Dans les rares passages où Dosse discute un peu la philosophie des sciences, c’est pour traiter de La nouvelle alliance de Prigogine et Stengers, et célébrer avec eux la complexité et le hasard, ou pour vanter le relativisme pluraliste de Michel Serres ou de Bruno Latour. Mais pourquoi des économistes comme Gérard Debreu ou Maurice Allais, pourtant Prix Nobel, ne sont-ils même pas mentionnés ? Est-ce parce que leurs travaux sont surtout lus aux États-Unis ? Pourquoi les mathématiciens ne figurent-ils dans cette saga qu’avec Grothendieck, au titre de la révolte écologique et soixante-huitarde? Pourquoi n’y est-il pas au titre de la géométrie algébrique ? Pourquoi Laurent Schwartz, pourtant très engagé, n’est-il pas considéré, lui et ses collègues, comme un intellectuel à part entière dans ce livre ? Maurice Audin ne fut-il pas autant mathématicien que militant ?
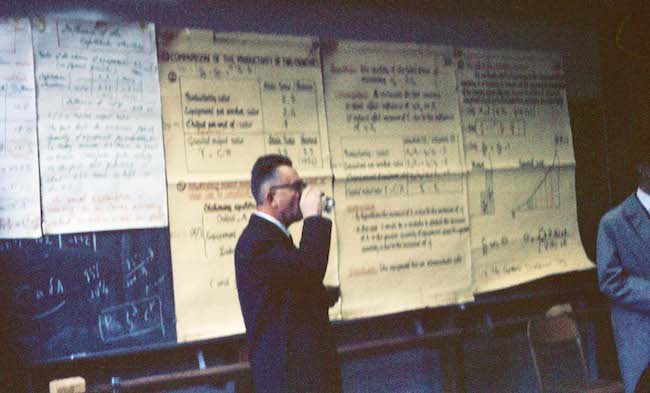
Maurice Allais, en 1963
La faiblesse principale du livre de Dosse ne tient pas tant aux erreurs factuelles ou aux omissions ponctuelles qu’à la définition même de son sujet. Ce n’est pas entièrement sa faute : dès l’époque de l’affaire Dreyfus, on a pris l’habitude d’appeler « intellectuel » un type d’individu, et de rôle social, supposé intervenir dans la sphère politique, au nom de son savoir (supposé), mais surtout au nom des idéaux et des causes politiques. Péguy le premier déplora que ceux-là se perdent dans celles-ci, quand il regrettait qu’on commence en mystique pour finir en politique. Benda souleva la question principale : le rôle des intellectuels, des clercs, est-il de suivre les passions politiques de leur époque, au détriment des idéaux de justice et de vérité ?
La longue histoire du début du XXe siècle a montré que ceux qu’on appelait les intellectuels avaient renoncé à incarner ce rôle. Dosse l’identifie à celui de l’intellectuel « prophétique », mais cette notion même implique qu’on tienne la fonction de l’intellectuel pour celle d’intervenir, dans des situations historiques, au nom de valeurs elles-mêmes historiques, ou messianiques. Même les intellectuels chrétiens qui apparaissent ici où là dans la chronique de Dosse semblent en être convaincus. Mais il n’est pas évident que le rôle de l’intellectuel soit de s’occuper et d’épouser les passions de son époque, pour les servir dans un camp ou dans un autre. N’est-il pas plutôt de les critiquer et de les combattre, au nom d’idéaux qui dépassent l’époque et le temps qu’il vit ? N’est-il pas de faire des travaux qui s’élèvent au-dessus du journalisme ? La fonction même des intellectuels n’est-elle pas de dire : « Je ne suis pas de ce temps-ci » ?
Dosse cite à un moment la fameuse discussion de 1972 entre Deleuze et Foucault sur les intellectuels et le pouvoir, prônant un changement de paradigme de l’intellectuel : il faudrait, selon eux, passer de l’intellectuel « universaliste », qui parle au nom de la vérité et de l’idéal, à l’intellectuel « spécifique » qui intervient dans des luttes concrètes, situées, et sans se réclamer d’un savoir surplombant. Foucault dit : « Chaque époque a son régime de vérité ». Mais comment peut-on être un intellectuel, non pas dans sa posture, mais dans ses tâches les plus quotidiennes de vérification des faits et, s’il y a lieu, de révolte contre les injustices si l’on ne reconnaît pas l’objectivité du vrai indépendamment des « régimes » ? Comment peut-on protester contre l’oppression si l’on pense que la vérité est toujours relative à des cultures, des langues, des situations ? Nombre des auteurs mentionnés ici en ont eu certainement conscience, mais ils se sont interdit toute possibilité d’être autres que de leur temps. Le problème des intellectuels, depuis 1944, Sartre en tête, est qu’ils sont devenus historicistes et relativistes. Par là même, ils ont trahi leur propre cause, qu’ils aient été ou non marxistes. Il n’y a pas d’intellectuel s’il n’y a pas d’universel, et les meilleurs d’entre eux l’ont compris, malgré leurs contemporains. La saga racontée par Dosse est une Berezina.












