Suspense (19)
Dans Le Président a disparu, Jonathan Lincoln Duncan, président des États-Unis, raconte comment il a fait échapper « le monde libre » à « la menace la plus grave [que celui-ci ait connu] depuis la Seconde Guerre Mondiale ».
Bill Clinton et James Patterson, Le Président a disparu. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd. J.-C. Lattès, 491 p., 23 €
Comme c’est Bill Clinton, vrai ex-président, aidé de James Patterson, qui a écrit ce roman, le lecteur s’attend, non au « thriller visionnaire que seul un président pouvait écrire » annoncé par la quatrième de couverture, mais à une histoire qui lui fournirait deux ou trois détails originaux sur le fonctionnement de la Maison Blanche et son locataire, ou quelques réflexions un poil personnelles sur les difficultés que pose l’exercice du pouvoir. Eh bien non.
Que lira-t-il ? Une histoire qui en vaudrait une autre si… mais remettons les « si » à plus tard. Un terroriste, le plus recherché du monde, après avoir montré ses capacités de nuisances sur d’autres continents, veut déclencher une cyber-attaque contre les États-Unis. Autour de cette menace centrale, d’autres éléments de suspens sont ajoutés, concernant essentiellement le président : il doit comparaître devant une commission d’enquête (non, non, pas pour des débordements libidineux avec une jeune stagiaire) et contrer les attaques de son opposition ; il est aussi atteint d’une maladie du sang qui, s’il ne se soumet pas aux traitements nécessaires, et bien sûr il n’a pas le temps, lui fait risquer le coma. Tout ceci pendant qu’on découvre qu’une taupe s’affaire à la Maison Blanche et qu’une tueuse en liberté s’apprête à exécuter un contrat.
Pourquoi pas. C’est un scénario qui en vaudrait un autre si la construction des personnages, l’intrigue cybernétique, le niveau de tension dramatique ne voisinaient le zéro. Le lecteur alors privé des centres d’intérêt habituels du « thriller » ne peut que porter son attention sur le personnage principal et l’aspect politico-idéologique du livre.
JLD, président des États-Unis est ancien combattant de la guerre du Golfe qui a été prisonnier en Irak, soumis à la torture, mais n’a jamais trahi ni ses camarades ni son pays. Sourire du lecteur qui se souvient que le héros de guerre, dans l’histoire des candidats à la présidence, c’est John McCain, et que Clinton s‘est vu reprocher d’avoir échappé à la conscription lors de la guerre du Vietnam. Il n’est jamais dit s’il appartient au parti démocrate ou au parti républicain. Bref c’est une figure admirable, sans appartenance partisane, susceptible de rassembler tous les Américains – contrairement, est-il entendu, à l’actuel président.

Bill Clinton © D.R.
Duncan, qui parle donc à la première personne dans la plus grande partie du livre, laisse, modestie oblige, ses collaborateurs et ses partisans rappeler ses faits de guerre et faire la liste de ses vertus. Quant à son charme irrésistible, ce sont les dames qui sont chargées de le souligner. Ainsi bien qu’encore ulcérée de sa défaite contre lui aux primaires, sa vice-présidente (cf. Obama/Hillary Clinton) lui reconnaît « de beaux traits burinés et un formidable sens de l’humour ». De son côté, son épouse récemment décédée (c’est plus pratique) a évoqué sur son lit de mort, avec un sens de la drôlerie sans doute familial, le fait que sa disparition allait faire de lui « le célibataire le plus en vue de la planète ».
Ah, Rachel Carson ! JLD l’a rencontrée à la fac de droit, il l’adorait, elle était « la plus forte et la plus belle » des femmes, et un cancer l’a emportée. Lorsqu’il songe aux six derniers jours qui précédèrent sa mort, il les voit comme « les plus précieux de [s]on existence » car, ajoute-t-il, « durant cette parenthèse, ce fut seulement elle et moi. Et notre amour. »
Duncan a aussi une fille ; il l’adore, c’est la plus belle, la plus forte, etc., mais « il se sent bien seul ». Comme le thème du bonheur matrimonial et les règles d’un veuvage récent (16 mois) sont impératifs, il ne peut céder à aucune tentation érotique, fussent-elles celles que représentent les amies de sa femme ou même la première ministre israélienne, une vieille pote à lui, venue en visite pour tenter d’écarter la terrible menace terroriste. Jonny — car c’est ainsi qu’elle appelle le président — raconte ainsi leur scène d’adieux après leur entrevue : « Nous tombons dans les bras l’un de l’autre, je goûte au réconfort de sa longue et chaude étreinte : « Je pourrais rester, Jonny » murmure-t-elle à mon oreille ». Je m’écarte. » Ouf, on a eu peur !
Mais si le président se montre plein de vertu et de réserve, on ne peut pas en dire autant des deux auteurs du livre, qui s’égarent parfois à produire, par exemple, un portrait d’un des personnages féminins du roman, aussi stéréotypé que graveleux. La tueuse à gages, comme d’hab la plus belle, la plus forte etc. est aussi la plus « sexy » et pour « passer inaperçue » (sic), prend « une démarche chaloupée », un sourire engageant et exhibe un décolleté profond qui laisse à ses seins (incroyablement appelés « girls » dans le texte américain) assez d’espace pour rebondir lorsqu’elle marche. Les traducteurs sans doute effarés par ces invraisemblables « bouncing girls » ont laissé tomber l’expression dans leur version française. On les comprend.
Quant à la vision présentée par le livre des rapports des États-Unis avec le reste du monde, elle est troublante dans sa négligence des réalités avérées. Prenons par exemple, la question terroriste : c’est un certain Suliman Cindoruk, censé être « le terroriste le plus recherché de la planète » qui, dans les pages du roman, représente le plus grand danger pour la nation américaine. Qui est-il ? Le président le présente comme « un nationaliste laïc … turc mais pas musulman. » Ah tiens ? Alors qu’il a appelé son groupe Les Fils du Djihad ? Curieux ! De plus Cindoruk, aux dernières nouvelles, se cachait dans « une ferme au Nord de l’Algérie », mais s’en est enfui lorsqu’ « un groupe de séparatistes pro-Ukrainien et anti-Russe » a pris d’assaut son repère. Il n’a eu la vie sauve, mystère des tactiques du contre-terrorisme, que grâce à « un Commando des Forces Spéciales et de membres de la CIA des États-Unis » qui a repoussé l’attaque contre lui. Des membres de la CIA des États-Unis ? Ah bon, pas de la CIA du Luxembourg ou du Honduras ? (Là encore les traducteurs ont eu la bonté de censurer ce malencontreux « des États-Unis » dans leur version française).
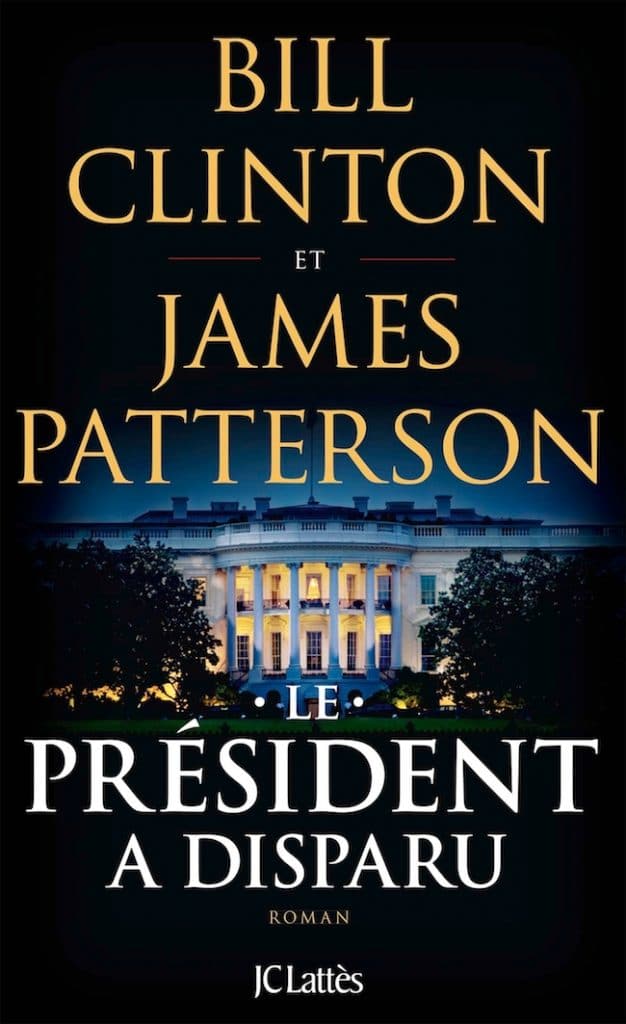
Bref, en matière de terrorisme, Clinton et Patterson ne se montrent pas particulièrement méticuleux, pas plus qu’en matière de géopolitique et de rapports diplomatiques. Ainsi, parce que les circonstances sont graves, le président doit à un moment se tourner vers ses alliés ; et qui sont-ils ? Eh bien, nuls autres qu’Israël et l’Allemagne (pauvres Grande-Bretagne, France etc. ). Quant à ses ennemis, ce sont, dans cet ordre, la Corée du Nord, la Russie et l’Iran. Pourtant les diaboliques projets de Cindoruk ne sont attribués à aucun de ces trois pays, mais comme il faut aller dans le sens de la paranoïa anti-Poutine du moment, la Russie se voit accuser de ne pas avoir informé les États-Unis du projet terroriste dont elle avait connaissance. Cela fournit au livre quelques moments de vengeance compensatoire permettant à JDL d’exercer son autorité sur l’ambassadeur de Russie —à qui il annonce des sanctions commerciales pour son pays, le renvoi de diplomates etc. Voilà comment il faut traiter ces affreux Russki !
Mais alors qui désigner comme instigateurs et financiers du projet terroriste de Cindoruk s’il est impossible de céder à la tentation de choisir comme coupable un état en particulier ? Clinton/Patterson optent pour une solution proche d’une réalité familière, celle du 11 septembre, qui a l’avantage de sembler vaguement crédible et de rendre hommage à un des grands alliés des États-Unis, mal aimé du public : l’Arabie Saoudite. (Oui, ça tombe un peu mal vu du mois d’octobre 2018, mais Clinton/Patterson ne pouvaient pas prévoir les sinistres opérations pieds nickelés de l’ambassade saoudienne en Turquie).
Bref, ce n’est pas le souverain du royaume saoudien qui soutenait Cindoruk mais de richissimes princes de son entourage désireux d’en découdre avec lui et avec l’Amérique. Et c’est sa majesté Saad ibn Saoud qui, au téléphone explique toute l’affaire à Jonny. le grand projet de ces félons étaient de faire revenir par leur attaque cybernétique les États-Unis « au XIXe siècle », de prendre le pouvoir en Arabie Saoudite puis de réconcilier celle-ci avec l’Iran et la Syrie « afin d’établir un califat technologique moderne » qui règnerait sur tout le Moyen Orient.
Heureusement les États-Unis de JDL peuvent compter sur la capacité de leur dirigeant à résoudre les grands problèmes. Un épisode dans la « war room », un jour précédant la crise Cindoruk, en fournit la preuve. JDL doit décider d’autoriser ou non une attaque de drones sur un duo de chefs de différentes branches d’Al-Qaida réunis dans une petite ville du Yémen ; l’un d’eux a amené avec lui ses sept enfants tous très jeunes « pour se protéger ». Que faire ? Éliminer ces deux ennemis de l’humanité et tuer sept innocents ou etc. ? Dans une psychomachie intérieure éthique comme du Marc-Aurèle et stratégique comme du Général Giap, JDL se concentre, pesant le pour et le contre : « Comment puis-je condamner sept enfants ? Ce n’est pas toi. Toi, tu élimines deux terroristes dont le but est d’exterminer des innocents. Al-Fadhli signe l’arrêt de mort de ses propres enfants en se réfugiant derrière eux. […] Que dirai-je à mon créateur le jour où je devrais répondre de mes actes ? […] Je prends un peu de temps pour murmurer une prière. Je prie pour ces enfants. Je prie pour qu’aucun autre président n’ait plus jamais à prendre une telle décision.– Dieu nous pardonne. Vous avez le feu vert. »
Et voilà, Clinton aurait pu se contenter d’écrire comme l’avait fait avant lui un de ces prédécesseurs, F. D. Roosevelt, grand amateur de fiction policière, une œuvrette à énigme sans enjeux nationaux ou internationaux (The President’s Mystery Plot, 1936) mais il a décidé de mettre en toile de fond les questions de la gouvernance d’une nation. Devant l’embarrassante indifférence au monde et la complaisance morale nationaliste que déploie son roman, les lecteurs étrangers ne sont pas rassurés.












