Dans un livre novateur, Hervé Guillemain propose une série d’analyses sur le schizophrène comme figure subalterne dans la France du XXe siècle.
Hervé Guillemain, Schizophrènes au XXe siècle. Des effets secondaires de l’histoire. Alma, 328 p., 22 €
L’historien se focalise sur l’itinéraire de 157 individus, tel qu’on peut le reconstruire à partir des dossiers de patients conservés dans les archives départementales et les hôpitaux. Ainsi se tourne-t-il résolument vers les méthodes de l’histoire sociale pour fonder un nouveau type de récit, en prenant le contrepied de l’histoire conceptuelle de la schizophrénie et de l’hagiographie médicale : « quand d’autres s’étonneront d’y lire bien d’autres choses que l’histoire de la folie et de la psychiatrie – quelques pages consacrées à la sténodactylo, à la migration polonaise, à la folie des Corses ou encore à la psychologie des tuberculeux ».
Cette nouvelle ligne narrative conduit à une série de constats effarants relatifs aux ratés du processus d’émancipation et d’intégration sous la Troisième République. Dans un premier temps, l’historien montre que le programme de prévention associé à la notion de schizophrénie s’est rapidement retourné contre les patients, enfermés très jeunes dans une catégorie stigmatisante. En effet, en posant le principe d’un processus morbide chez l’adolescent et le jeune adulte, susceptible de faire l’objet d’un dépistage et d’une prise en charge précoce, les psychiatres ont poussé à l’extrême la médicalisation et la ségrégation d’une partie de la jeunesse, jugée socialement inadaptée. Pourtant, Hervé Guillemain souligne qu’il n’a guère retrouvé dans les archives la sémiologie médicale des manuels de psychiatrie, mais bien plutôt des jugements socialement normés : « Dans la pratique au quotidien, c’est plutôt une appréciation sociale des règles de bienséance et de savoir-vivre, à l’image dominante de la femme qui l’emporte, lorsque l’on désigne les limites d’une saine coiffure et d’un bon habillage. Cette manière de repérer la déviance, qui, rappelons-le, est contemporaine de la construction sociale de la figure de l’androgyne et émancipée de la garçonne, dont les coupes courtes de cheveux estompent les différences de genre et provoquent parfois de vives querelles familiales, est d’autant plus significative qu’elle a son pendant masculin. […] Le schizophrène étant un pubère raté, il s’agit de repérer les indices physiques de cet échec. Le schizophrène mâle est un viril avorté à l’attitude maniérée, comme le schizophrène femelle est une inadaptée de la féminité moderne ».
En s’inspirant du projet de recherche du philosophe des sciences canadien Ian Hacking sur les niches écologiques propices à l’essor de « maladies mentales transitoires », l’enquête porte sur la naissance, la vie et la mort de formes typiques de schizophrénie, tant les catégories psychiatriques sont changeantes et les populations auxquelles elles s’appliquent contingentes au fil du temps. Cette interrogation se déploie alors sous les formes de la répartition spatiale, chronologique et sociologique des schizophrènes dans notre société. Hervé Guillemain souligne que, si le terme de schizophrénie ne s’impose pas au même rythme partout dans le monde (entre les années 1920 et 1950), il correspond cependant à des taux très élevés de diagnostics dès son adoption. Aujourd’hui, la schizophrénie désigne encore 25 à 40 % des patients hospitalisés dans les unités psychiatriques françaises, un chiffre stable depuis près d’un demi-siècle malgré les critiques émanant à la fois de la société civile et des chercheurs, qui réclament la suppression d’une catégorie fourre-tout.
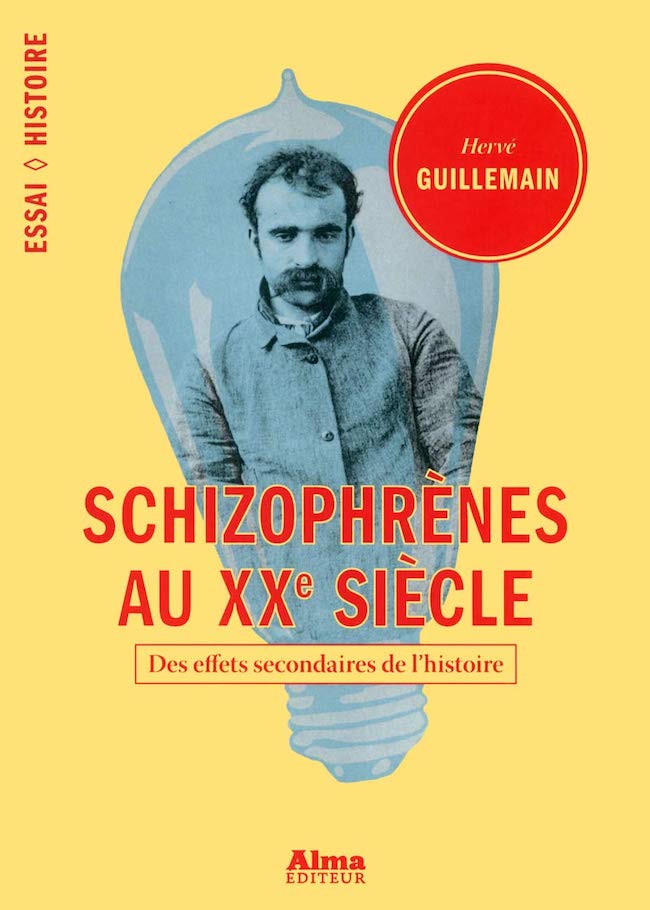
Or la thèse principale d’Hervé Guillemain est que ce groupe n’a jamais constitué une population homogène. Au contraire, la population diagnostiquée schizophrène est majoritairement féminine jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir majoritairement masculine à partir des années 1950, ce qui témoigne d’un changement de registre. En battant en brèche l’idée naïve d’une universalité de la schizophrénie, l’auteur constate plutôt que les schizophrènes appartiennent d’abord à deux sous-ensembles principaux dans l’entre-deux-guerres : d’une part la domesticité, d’autre part les nouvelles professions tertiaires. Ce résultat est original car contre-intuitif. En effet, si le premier est alors une catégorie socioprofessionnelle en plein déclin, celle-ci constitue pourtant la grande pourvoyeuse de schizophrènes jusqu’à la Seconde Guerre, avant de disparaître dans les années 1950. Puis le profil change avec la société : ce sont désormais des femmes éduquées, employées de bureau, qui sont identifiées comme schizophrènes. Ce qui amène l’historien à établir un constat inédit : « En 1940, une femme schizophrène sur cinq travaille comme sténodactylo ». De sorte que l’histoire des schizophrènes fait surtout ressortir deux facteurs historiques : la féminisation des professions tertiaires et l’exode rural des jeunes éduqués. Des types de population se dégagent aussi des statistiques d’admission, comme les anciens orphelins de l’Assistance publique et les veuves de guerre. En ce qui concerne la masculinisation des schizophrènes dans l’après-guerre, Hervé Guillemain s’interroge sur le rôle normatif des manuels de psychiatrie qui diffusent alors principalement des représentations masculines.
Autres disparités, les inégalités régionales permettent de repérer une prédominance dans le sud de la France, une carte associée à une autre particularité : dans les années 1940, la grande majorité des schizophrènes portent des noms d’origine italienne ou corse. Or les Italiens ont constitué au début du XXe siècle un fort contingent de migrants, tandis que la Corse n’a pas bénéficié d’établissements psychiatriques jusqu’en 1974, les patients étant systématiquement transférés dans les hôpitaux du sud de la France. Ce n’est pas tout, cette répartition se superpose à celle qui a partagé la zone occupée et la zone Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, les patients des asiles étant évacués en masse vers la zone Sud. De sorte que les transferts de population sont susceptibles d’expliquer ces disparités plutôt que les données épidémiologiques, d’autant plus qu’ils confirment que la guerre est responsable de l’explosion démographique des schizophrènes dans les années 1940 – à rapprocher de l’arrivée massive des soldats de la Grande Guerre à l’asile, un phénomène qui avait l’objet d’un précédent livre avec Stéphane Tison (Du front à l’asile, 2013).
Enfin, la transplantation des populations européennes ressort également des dossiers de schizophrènes d’origine étrangère : groupes sociaux issus de l’Europe de l’Est et des Balkans, Arméniens et Russes ayant fui les ruines des empires ottoman et tsariste, juifs polonais, etc. Hervé Guillemain fait là encore le constat que la surreprésentation des schizophrènes d’origine étrangère est tout sauf évidente, puisque leur profil change avec les événements historiques. Mais le phénomène le plus terrible mis en évidence par l’historien est le sort des femmes d’origine juive polonaise et tchécoslovaque, qui connaîtront des formes de déportation avant l’Occupation, une mesure prise par les pouvoirs publics français dans le contexte de la xénophobie ambiante de la fin des années 1930. En effet, des convois ont été organisés pour renvoyer les malades mentaux indésirables dans leur pays d’origine, afin de délester les grands hôpitaux urbains. Après la fermeture des frontières, les schizophrènes qui n’ont pas bénéficié de protection ont été relégués dans des hôpitaux ruraux isolés, affichant des taux de mortalités inédits, dans le dénuement des années de guerre. Les chiffres sont terribles : 56 % de ces schizophrènes transférés sont morts avant la fin de la guerre, transplantés loin de leurs proches. Ces données confirment les travaux de l’historienne Isabelle von Bueltzingsloewen sur la mortalité massive des aliénés réfugiés. Hervé Guillemain n’hésite pas à parler de « population littéralement déportée », un phénomène méconnu dans l’histoire de la psychiatrie et qui devrait susciter de nouvelles études.












