La vendetta est un phénomène toujours actif, en particulier en Albanie et dans l’est de la Turquie. Deux ouvrages nous plongent dans l’univers des coutumiers, écrits ou oraux, qui dictent la conduite à suivre dans des lieux longtemps sans État ni institution judiciaire sérieuse. On mesure la force de la tradition au fait qu’elle prévalait sur la Bible ou le Coran, les religieux ayant toutes les peines du monde à éteindre « la reprise de sang ». Il n’est pas ici question de justice mais d’« honneur » : la vendetta est un acte social qui implique la famille et la communauté, non un crime individuel.
Ridvan Dibra, Le petit Bala. Trad. de l’albanais par Évelyne Noygues. Le Ver à Soie, 130 p., 15 €
Murathan Mungan, Taziye. Cérémonie funèbre. Trad. du turc par Sylvain Cavaillès. Kontr, 72 p., 13 €
Ces deux textes ont le mérite d’aborder ce cruel sujet de la vendetta sous des formes originales qui rejettent le réalisme sordide, l’indignation facile ainsi que le moralisme inutile. Ils montrent l’inexorable fonctionnement d’un mécanisme difficile à enrayer. Il n’est pas fortuit que le récit albanais Le petit Bala se présente comme La Légende de la solitude et que la pièce turque Tazye. Cérémonie funèbre soit annoncée comme « une tragédie classique en terres mésopotamiennes ».
En Albanie, la vendetta était codifiée par le « Kanun », un écrit datant au moins du XVe siècle , attribué à un féodal, Lekë Dukagjini. Interdite sous la dictature d’Enver Hoxha, elle a connu une « barbarisation » lorsqu’elle est réapparue. Le « Kanun » interdisait de tuer les femmes dans la reprise de sang, de même que les enfants qui n’étaient pas en âge de porter une arme ainsi que les religieux. Il n’en est plus ainsi. Le retour de la vendetta est dû, en grande partie, à la très complexe restitution des terres à leurs propriétaires d’avant-guerre.
En Turquie, dans la partie est de l’Anatolie, les crimes dit « d’honneur » ont souvent pour victimes des jeunes filles suspectées de fréquenter des garçons, refusant des mariages arrangés ou y échappant par la fuite. Quand elles sont violées, il arrive qu’elles soient « exécutées » par leur famille, comme le raconte le député kurde emprisonné Selahattin Demirtas dans son recueil de nouvelles L’aurore.
Le récit de Ridvan Dibra, qui est un romancier albanais, s’inspire d’une cruelle chanson populaire des montagnards du Nord. On y conte l’histoire « contre-œdipienne » d’une mère qui aveugle son fils et l’assassine… L’écrivain s’éloigne cependant considérablement de la forme traditionnelle. Trente courts chapitres sont précédés d’un titre explicatif, comme au XVIIIe siècle, et suivis de quelques mots qui en tirent les enseignements. Le style est très sec, direct et sans détour. Le narrateur omniscient sait tout de Bala, garçon de dix-huit ans, qui peine à exister dans une solitude entière. Toutefois, il ne manifeste aucune compassion pour son personnage, dont il décrit l’évolution à la manière d’un entomologiste. Cette distance accroît la tension qui ne cesse de s’amplifier au fil du récit. Ce n’est pas un hasard si ce roman a reçu le prix Rexhai Surroi du meilleur roman de l’année 2012 au Kosovo.
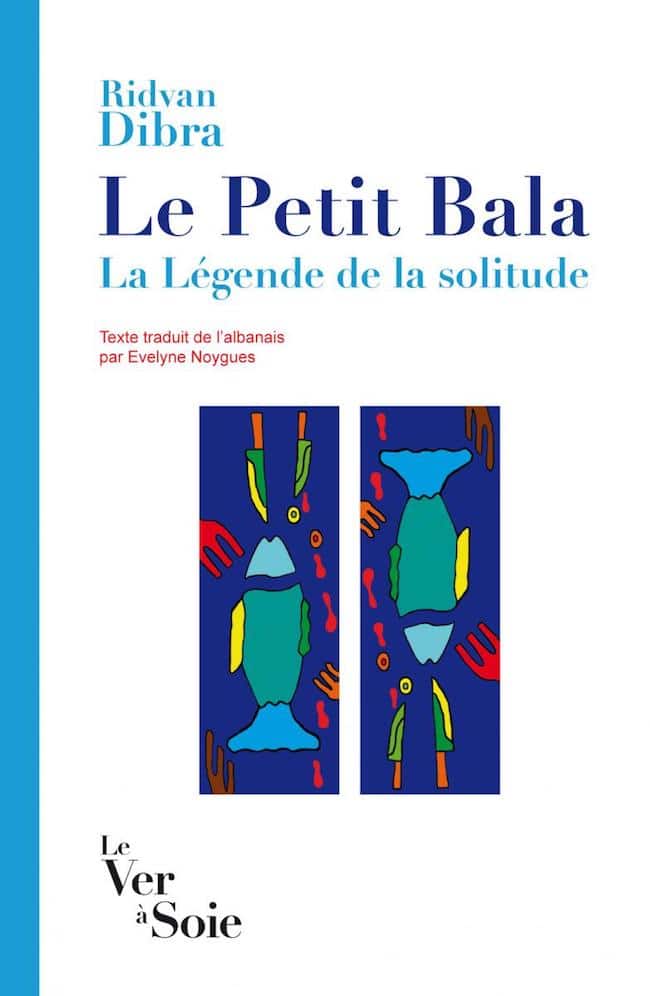
L’isolement extrême de Bala s’explique par le fait qu’il n’a plus de père, celui-ci est mort dans des circonstances suspectes : « Bala apprend la version officielle : son père s’est tué accidentellement, lui qui touchait le cœur d’une cible à cent pas ». Alors que son père est bien mort, Bala croit entendre un nom s’échapper de ses lèvres : celui du voisin. Sa mère lui certifie que c’est son prénom, « Bala », que son père a prononcé avant qu’elle ne lui ferme les yeux. Le narrateur explique : « Il croit plus sa mère que ses oreilles. Il est à un âge où on fait confiance aux autres ». Cette réplique donne le ton de l’ouvrage, particulièrement bien traduit par Évelyne Noygues qui a été nominée pour le prix Révélation de traduction de la Société des gens de lettres.
La seule amie de Bala, au début de l’histoire, est une grande pierre noire, de mauvaise réputation à qui il parle et qui lui répond parfois. Il est insulté et ostracisé par ses camarades de classe. Une tentative de rapprochement se solde par la perte d’un œil tant la violence est grande. Une injure qui l’a particulièrement touché, « bâtard », l’amène à confronter son visage aux photographies de son père pour tenter d’y déceler des ressemblances. Il l’aimait profondément pour sa douceur avec la nature – de la chasse, il ne rapportait guère de gibier – et pour ses encouragements car il stimulait les talents de dessinateur de Bala. Un tel père ne peut être remplacé par un voisin, affichant une sympathie pour l’enfant mais de plus en plus suspecté d’être un assassin… L’idée de la vengeance naît donc peu à peu. Bala échafaude des plans mais prend conscience que la réalité résiste à ses intentions. Il n’en est pas moins obsédé par son projet. La fin n’est pas celle qui est attendue ; la mère, fausse et cruelle, veille… Le récit se clôt par un épouvantable « happy end » qui laisse le lecteur pantois.
La pièce de Murathan Mungan, romancier, poète, homme de théâtre turc, intitulée Taziye. Cérémonie funèbre retrace, à partir d’un rituel funéraire, la vie de l’agha Bedirhan et de sa femme, Falsa, qu’il a enlevée naguère lors de ses noces, en assassinant son promis. Serho Agha, père de Falsa, et ses trois fils ont l’obligation de se venger. Faut-il préciser que ce clan portait la responsabilité de l’assassinat de Rüso Le Noir, père de Bedirhan ?
Le « prélude » de la pièce s’ouvre significativement sur un linceul. Falsa, en proie aux douleurs de l’enfantement, va s’y allonger. Tous les protagonistes sont présents sur la scène, accompagnés par les pleureuses, les gardes et Mère Kevsa. L’agha Bedirhan se sait menacé mais ignore que le principal danger vient de sa mère. Celle-ci évoque avec acharnement tous les sortilèges et les sacrifices auxquels elle a inutilement recouru afin de rendre Falsa stérile. Elle éprouve, en effet, une « noire haine » envers cette femme que son fils aime avec passion. Lui clame, au contraire : « Je veux un fils. Je veux un visage à ma passion ».
L’enfant réplique, sans illusion : « Ne t’inquiète pas père! Je ne vais pas tarder à naître. Toute naissance est le signe de l’oppression. À présent va commencer la mienne, et face à moi-même, et face à ma tribu ». Il sait qu’il est né sous le sceau du malheur : « Tout ce que je sais a trait à la mort ». Il s’interroge : « Qui est mon père ? Qui est ma mère ? Qui tue qui ? Qui est l’assassin de qui ? » On comprendra, au fil de la pièce, les raisons de ses interrogations. Il conclut : « J’aiguiserai ma cruauté à mes douleurs, à mes tourments. Que ma cruauté escorte votre destin ! »

Si les personnages sont ensemble sur scène, ils parlent pour eux-mêmes, dans des temps distincts. Mère Kevsa rumine : « Un voile empoisonné se pose sur l’œil de l’agha. […] La fissure des coutumes va rester encore un temps sur les murs de la demeure. Mais avant de mourir, moi, je refermerai cette fissure. Je lâcherai vers les cieux tous les oiseaux de proie ». Tout est en place ; les gardes de Bedirhan, qui ne tiraient pas sur les nuages afin que Falsa restât stérile, par leur feu déclenchent tonnerre et éclairs. Le linceul, qui était lit d’accouchement, berceau, tapis de prière dans le prélude, retrouve sa première fonction, dès la première scène, avec le corps sans vie de Bedirhan qui a été assassiné. Mais qui donc a ouvert la porte de l’escalier secret aux fils de Serho Agha?
Les épisodes de cette tragédie se télescopent avec une réelle force dramatique qui fait bien sentir que tout est joué d’avance dans cette logique vengeresse implacable. Chacun exécute sa partie, parfois sans écouter les autres, dans une profonde solitude. Avec « la dette de sang millénaire » mais aussi avec les haines familiales, Azraël, l’Ange de la Mort, n’a pas fini de désigner des victimes. Pour mesurer la force de la tradition, dans un « interlude », un conteur raconte le sacrifice qu’Abraham fait de son fils Ismaël [et non d’Isaac, conformément à la tradition musulmane] sauf que l’ange n’apparaît pas et que, comme « aucun bélier n’est descendu du ciel », « Ismaël s’écroule et reste à terre ».
Plus qu’à Eschyle ou à Sophocle, la pièce fait penser à Maurice Maeterlinck par son hiératisme poétique et souvent lyrique. Les répliques qui sont parfois de petits poèmes, les répétitions de phrases, l’immobilité de nombreux personnages, pleureuses ou fusiliers, qui forment chœur, évoquent ce théâtre de la profération malheureuse et inquiète, signe d’une impuissance majeure des personnages, jouets du destin. De fait, l’extrême attention portée à des éclairages complexes et précis rappelle Lugné-Poe et son fameux théâtre de l’Œuvre.
La violence ne vient pas seulement de la tradition de ces sociétés patriarcales mais aussi de mères perverses œdipiennes et criminelles qui n’hésitent pas à tuer ou à mutiler leur progéniture. Elles évoquent, à leur manière, les grands personnages tragiques de mères effroyables comme la Cléopâtre (Rodogune) de Corneille ou les Agrippine (Britannicus) et les Athalie de Racine. De quoi frémir…












