Rabelais, que le roman commence !, essai de Lakis Proguidis, propose une nouvelle vision du roman, où celui-ci ne serait pas un genre littéraire, mais plutôt un art autonome, constituant sa propre catégorie esthétique, et ce à partir de Pantagruel. Pour défendre sa thèse ambitieuse, l’essayiste mélange l’intime, la polémique, la théorie et l’anecdote, empruntant ainsi à son maître, Milan Kundera.
Lakis Proguidis, Rabelais, que le roman commence ! Pierre-Guillaume de Roux, 384 p., 26,90 €
Tout commence sous les acacias. On est en 1972, en Grèce, dans la ville natale de Lakis Proguidis, l’auteur a vingt-cinq ans. Il vient de sortir de prison, après avoir été enfermé pendant quatre ans en tant qu’opposant au régime des colonels. Incarcéré, il s’est consacré à la lecture, dont La plaisanterie, lu quelques mois avant sa libération. Au lendemain de son retour au foyer, il rend visite à l’un des plus proches amis de son père, un dénommé « S. ». Ce dernier, du même camp politique que les Proguidis, pose une question intime à l’ex-détenu : « Et avec le désir sexuel, comment as-tu fait ? »
Selon l’essayiste, ce fut la première fois que son esprit fut accaparé par un personnage romanesque : sa réponse fut dictée par Ludvik, héros de La plaisanterie. Il a donc avoué s’être masturbé en prison. S., déçu de voir ainsi ébranlée son image héroïque des résistants, a évité la maison des Proguidis pendant les jours suivants. Seul le fils comprenait son absence. Perturbé lorsque son père l’a interrogé au sujet de leur conversation, le narrateur s’est offert une petite promenade sous les acacias, le temps de réfléchir.
Trente-trois ans plus tard, en 2005, pendant la rédaction du présent essai, il y réfléchit encore. À l’aube du troisième millénaire, il se rend compte qu’il y avait alors trois Ludvik présents dans son esprit : celui de sa première lecture de La plaisanterie, un héros tragique ; celui de la deuxième, où Ludvik était cynique, insolent et provocateur ; et enfin, celui de la troisième lecture, advenue sous les acacias, où Ludvik devient quelqu’un de mélancolique qui aurait regretté d’avoir blessé S. La prise de conscience de cette dernière lecture déclenche une réaction forte : « Je me mets à rire. Sans bruit ni grimaces, ni autres signes extérieurs. Pourtant le ventre, le cœur, les muscles du dos, la colonne vertébrale et le cerveau tremblotent. Tout est simultanément présent : ma consternation d’avoir déçu S., la compassion envers mon père, les deux Ludvik, le Ludvik vengeur et le Ludvik mélancolique, et ce rire étrange, inexplicable. »
C’est en riant qu’est née sa vision de « l’unicité d’une expérience esthétique », celle où, apparemment, l’auteur ne fait aucune distinction entre sa « psychologie » individuelle, et son expérience de lecteur. Sous les acacias, de manière encore indistincte, cet essai fut engendré, même si, à l’époque, l’auteur n’avait qu’un vague souvenir scolaire de Rabelais. Son rire, décrit comme « une décharge électrique », était son premier « rireromanesque » : « On ne trouve pas le rire romanesque dans les dictionnaires. On y trouve toutes sortes de rires. Pas celui-là. On y trouve gros rire, fou rire, rire forcé, narquois, bruyant, éclatant, sardonique, moqueur, sourire, de rire romanesque, point… Quand nous disons rire sardonique, ‟rire” est le substantif et ‟sardonique” l’adjectif qualificatif. Tandis que, dans mon esprit, les deux mots, ‟rire” et ‟romanesque”, forment un seul substantif.
À cette difficulté d’ordre linguistique s’en ajoute une deuxième d’ordre ontologique : le rire romanesque n’est pas, à mon sens, une sous-catégorie dans la supposée grande catégorie du rire. Dans ma dyade lexicale, le rire n’a pas plus d’étendue ou de profondeur sémantique que le romanesque. Si on considère le rire comme un trait anthropologique – l’homme est le seul animal qui rit, disait Aristote –, ce n’est pas de celui-là que dérive le rire romanesque… Le rire romanesque est une catégorie à part, nouvelle, incomparable à tout autre rire non romanesque. Il faut l’entendre comme un seul mot : rireromanesque. »

Le roman serait-il né de ce néologisme ? En le créant, l’auteur érige Rabelais en fondateur de cet art, à côté de Boccace [1]. Et pour mieux illustrer l’originalité de son propos, Proguidis accomplit l’une de ses nombreuses digressions – l’aspect le plus jouissif de son texte – afin de se démarquer de ses confrères, dont les arguments sont résumés avec finesse.
Comme François Bon, coupable d’avoir écrit l’histoire de « l’écriture » plutôt que l’histoire du roman, voire d’avoir insisté sur « la toute-puissance de la langue » ; ou Michael Screech, spécialiste de Rabelais, pour qui ce dernier serait « le Lucien français », faisant de Rabelais une étape dans l’art de la comédie « tel qu’il fut véhiculé par la tradition gréco-latine ». Proguidis observe justement que cette lecture le condamne à « rester collé à son époque », à la différence d’auteurs tragiques.
D’autres critiques sont pris sous le feu de Proguidis, dont Michèle Clément et Pascale Mounier, auteures d’une introduction aux actes d’un colloque sur le roman français au XVIe siècle organisé en 2002 à Lyon 2. Proguidis y loue le renversement de l’idée que le roman commence avec La Princesse de Clèves. En revanche, relativement à la conclusion principale – au XVIe siècle, « les formes romanesques commencent à mettre en scène des individus dans leur singularité et des épisodes à sens à construire » –, il émet une nuance, à savoir que la « singularité » n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà mise en scène dans des œuvres ayant pour héros Achille, Œdipe ou Dante. Mais il admet l’importance du fait que dorénavant les singularités « précèdent le sens », ce qui implique la fin du régime bimillénaire de la mimesis.
Selon Proguidis, on est tout juste en train d’élaborer une théorie du roman, cinq cents ans après sa naissance. Comment expliquer ce retard ? Il le trouve naturel, non seulement parce que l’art (Eschyle) précède sa conceptualisation (Aristote), mais surtout du fait des obstacles imposés par la « nouvelle réalité esthétique ». Lesquels ? C’est là que Proguidis, imprégné de la civilisation de l’Antiquité gréco-latine, propose un éclairage particulier, et ce à partir du fameux bouclier d’Achille, sur lequel on trouve une image du monde entier.
Pour l’essayiste, Achille serait « le grand héros de la mimesis », d’un univers où « on n’imite pas quelque chose qui existe déjà », en dépit de l’emploi erroné de ce terme aujourd’hui. En fournissant des interprétations originales des concepts antiques, Proguidis, d’origine grecque, recadre notre conception des régimes esthétiques. Par exemple, le terme logos – qui pour votre serviteur ainsi que pour Wikipédia signifie « parole » ou « discours écrit » – prend un tout autre sens sous la plume de Proguidis : «Le logos hellénique n’est ni la raison abstraite (cartésienne) ni la raison d’être de l’être en général. C’est la raison qu’a chaque être d’être ainsi, sous cette forme-là et pas une autre. On passe du chaos à la forme grâce à un logos que seule la forme possède […] Le logos n’est pas, n’existe pas en soi. Chaque chose doit avoir sa raison (son logos) pour être telle qu’elle est. Le logos n’existe pas de manière universelle et immuable. Il appartient de façon exclusive à chaque forme particulière ».
Et donc, dans le monde hellénique de la mimesis – celui du régime esthétique d’avant Rabelais –, l’artiste s’imaginait habiter un cosmos (un monde ordonné) et cherchait à créer une œuvre qui pourrait sécréter « l’illusion de sa conformité avec son logos, autrement dit avec sa nécessité propre ».
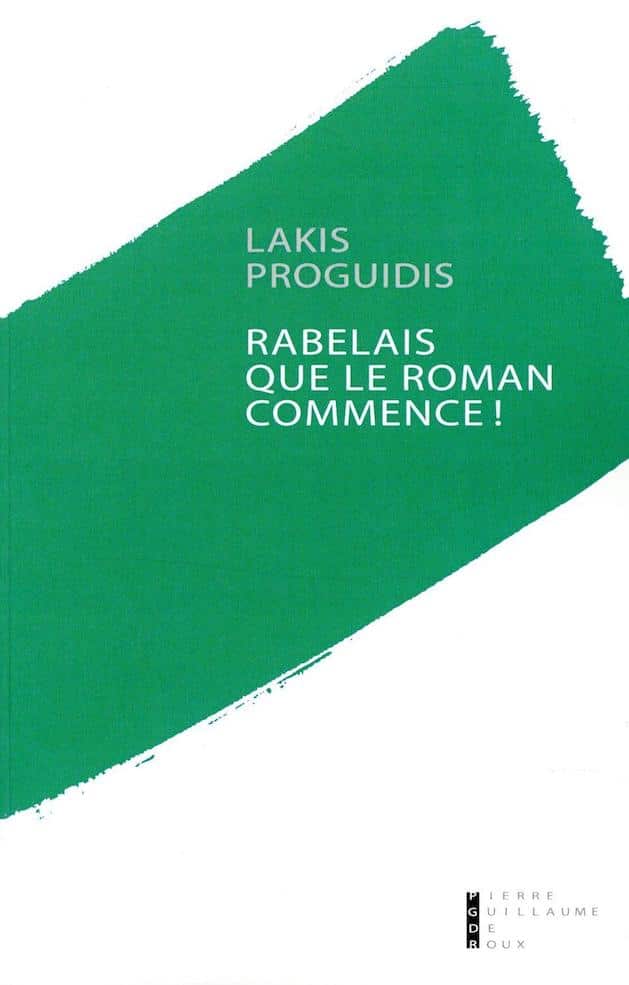
D’où la critique formulée par Proguidis à l’égard de Thomas Pavel, auteur de La pensée du roman, pour qui cet art naît au IIIe ou au IVe siècle, avec les Éthiopiques de Héliodore. Pavel estime que le passage du polythéisme au monothéisme installe « une façon de sentir », créant ainsi ce nouveau genre littéraire. Mais Proguidis critique sa vision, arguant que les logos appartenant autrefois aux « multiples éléments de la réalité » ont été maintenus en place, assumés dorénavant par Dieu, le « logos suprême ».
Rabelais serait-il alors plus puissant que Dieu ? La clé se trouve au début de Pantagruel, dans un passage concernant la lecture, où l’on n’est plus dans un espace mimétique « fermé en soi » à cause de la présence d’un « élément juxtaposé », à savoir la figure du lecteur : les talvassiers ainsi que le professeur de droit Raclet, « le cheveu dans la soupe ». Cela crée la structure esthétique du « binôme romanesque originel », ce mariage entre « la nécessité et le hasard, entre l’impératif de la forme et l’impératif du chaos, entre le logos et l’irrationnel, entre la narration forcément mimétique et la digression arbitraire ». Le « sens à construire » évoqué par Clément et Mounier sera alors fourni par le « lecteur romanesque » né avec Rabelais, faisant de ce genre un art « ontologiquement altruiste » et « anti-narcissique ». Le roman implique alors la formation de son lecteur, où « lire signifie augmenter, emplir le texte lu avec l’expérience de soi et des autres ».
C’est ainsi que la révolution esthétique s’accomplit, que l’Europe quitte enfin le régime mimétique pour celui du romanesque. Où « l’homme sérieux » sera remplacé par « l’homme non sérieux » ayant intégré le principe du hasard, et donc capable de rire sous les acacias, habité par un personnage romanesque.
Depuis, l’arbitraire règne partout, peut-être même dans l’équation en trois « r » qui résume ce magnifique essai : Rabelais = roman = rireromanesque !
-
Voir aussi son essai La conquête du roman. De Papadiamantis à Boccace, Les Belles Lettres, 1997.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)





![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)




