Suspense (20)
Le registre de Valerio Varesi est assez sombre. L’humeur du commissaire Soneri aussi, comme a pu le constater le lecteur ayant déjà suivi ses enquêtes dans Le fleuve des brumes et La pension de la via Saffi, les excellents romans qui précèdent Les ombres de Montelupo.
Valerio Varesi, Les ombres de Montelupo. Trad. de l’italien par Sarah Amrani. Agullo, 311 p., 21,50 €
Pourtant, dans Les ombres de Montelupo, la troisième de ses aventures à être traduite en français, l’atmosphère pourrait être plus détendue car Soneri est en vacances dans son village natal des Apennins au pied du Montelupo où il espère se promener en forêt, cueillir des champignons et trouver la paix de l’âme. Las ! c’est la Saint-Martin (11 novembre en Italie) et donc l’automne profond ; le brouillard borne la vision, le froid et l’humidité transissent hommes et bêtes tandis que s’annoncent les premiers flocons. Le village se replie dans la maussaderie et le commissaire ne rapporte de ses balades que des trompettes de la mort indignes de la poêle de son aubergiste.
Le lieu et le moment sont d’autant plus mal choisis que le repos escompté est troublé par la disparition de Paride Rodolfi, directeur de l’usine de charcuterie locale, et ensuite par le suicide du père de Rodolfi, Palmiro, qui avait fondé l’entreprise. Le commissaire, bien qu’il fasse ce qu’il peut pour se tenir à l’écart des soubresauts de l’existence villageoise, va se trouver impliqué ; d’abord parce qu’il découvre au fond d’un ravin le cadavre de Rodolfi fils, tué d’un coup de fusil, ensuite parce que tout le passé ressurgit et qu’il souhaite alors comprendre, pour lui-même, les rapports que son propre père, communiste vertueux, à présent décédé, pouvait bien entretenir avec Palmiro Rodolfi, opportuniste avide et sans principes.

Valerio Varesi © Andrea Bernardi
Il lui faut pour cela saisir les liens que Palmiro, à la faveur de la guerre et de l’après-guerre, a construits avec les autres habitants et la manière dont il les a bernés pour les utiliser à son profit. Mais la communauté, toute ruinée qu’elle soit à présent par Palmiro, se montre peu désireuse d’expliquer les opérations douteuses auxquelles elle a participé, et le commissaire, bien qu’enfant du pays et maintenant avide de faire la lumière sur les événements, se trouve confronté au silence des habitants.
Comme dans les deux livres précédents, l’intrigue des Ombres de Montelupo est en partie un prétexte à une peinture sociale et à une méditation à la fois historique et individuelle sur le temps qui passe. L’histoire est en effet une des préoccupations de Varesi, journaliste de La Repubblica à Bologne, qui, parallèlement à ses histoires policières, a publié une Trilogia di Una Repubblica (non traduite), portrait de l’Italie de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 2011. Déjà, dans Le fleuve des brumes, qui se déroule de nos jours dans la plaine du Pô, ex-terre de partisans, l’assassinat d’anciennes chemises noires faisait réapparaître les conflits d’antan et montrait comment le monde actuel, en ayant fermé l’horizon à des sections entières de la population, ne savait les apaiser. Le livre, sans pathos, était une sorte d’oratorio au passé où Saneri apparaissait lui-même comme un homme d’autrefois, « réservé, inductif et intuitif, réfractaire à l’informatique, rempli de méfiance vis-à-vis de la police scientifique » ( suivant les paroles hors-roman de son créateur).
Avec La pension de la via Saffi, dont l’intrigue se situe à Parme, la question mémorielle se faisait plus personnelle, puisque Sanari s’y retournait, comme dans le présent livre, sur son propre passé et en particulier sur la mort de sa femme ; étaient évoqués les changements qui, au cours des cinquante dernières années, ont transformé Parme, capitale provinciale tranquille et mesquine, ainsi que les derniers bouleversements apportés par l’immigration. Dans La pension de la via Saffi comme dans Les ombres de Montelupo, les circonvolutions successives de l’histoire, les ravages de l’argent facile et corrupteur, le délitement des solidarités anciennes apparaissaient. Les ombres de Montelupo prolonge donc les préoccupations de Varesi, mais dans un cadre paysan montagnard.
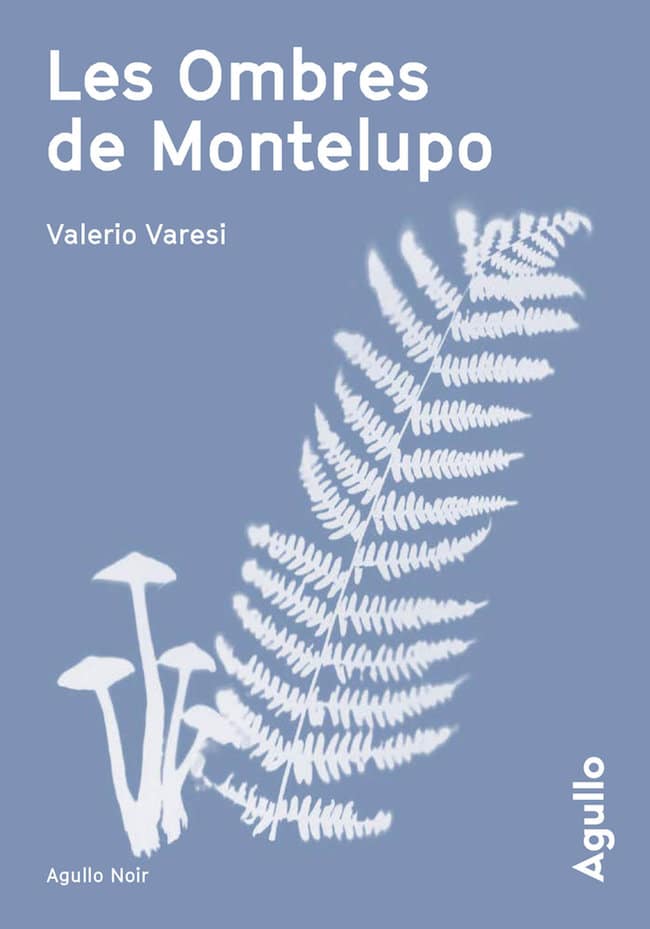
L’atmosphère est également semblable à celle des deux premiers livres rythmiquement, météorologiquement et psychologiquement. Varesi prend le temps de poser décors, personnages, actions, laissant pénétrer dans l’esprit du lecteur le charme inquiétant d’une montagne où le brouillard règne en maître, celui des secrets villageois, des silhouettes mystérieuses qui hantent les forêts, et d’un commissaire Soneri, marcheur solitaire et mélancolique. Même les tortelli fourrés aux châtaignes arrosés de bonarda du repas du soir ne suffisent pas à lever son spleen. C’est tout dire ! Rien, pas même les telefonate d’Angela, son amie parmesane qui l’aide dans l’enquête.
L’atmosphère « maigretienne » du livre est cependant interrompue vers la fin par une chasse à l’homme épique entreprise par les carabinieri imbécilement convaincus d’avoir trouvé le coupable de l’assassinat de Rodolfi en la personne du « Maquisard », un vieil homme qui habite dans les bois de Montelupo et les a défendus des commandos SS pendant la guerre. De quoi désespérer plus encore Soneri qui a tenté de les dissuader car il juge, à juste titre, le « Maquisard » innocent et les risques pour les poursuivants bien trop élevés.
Tout se termine mal, même si Soneri finit par percer les différents mystères. La complexité des motivations humaines reste, elle, entière, comme il se doit dans tout bon polar méditatif, et le commissaire, toujours plus calmement pessimiste, reprend pour finir le chemin de Parme : « La neige tombait recouvrant tout : Montelupo, le Maquisard, les Rodolfi, le village sourd et haineux peuplé de vieillards, les bois et même les champignons qu’il n’avait pas réussi à cueillir. Elle recouvrait une partie de son passé, dont il s’était désormais détaché pour toujours. »












