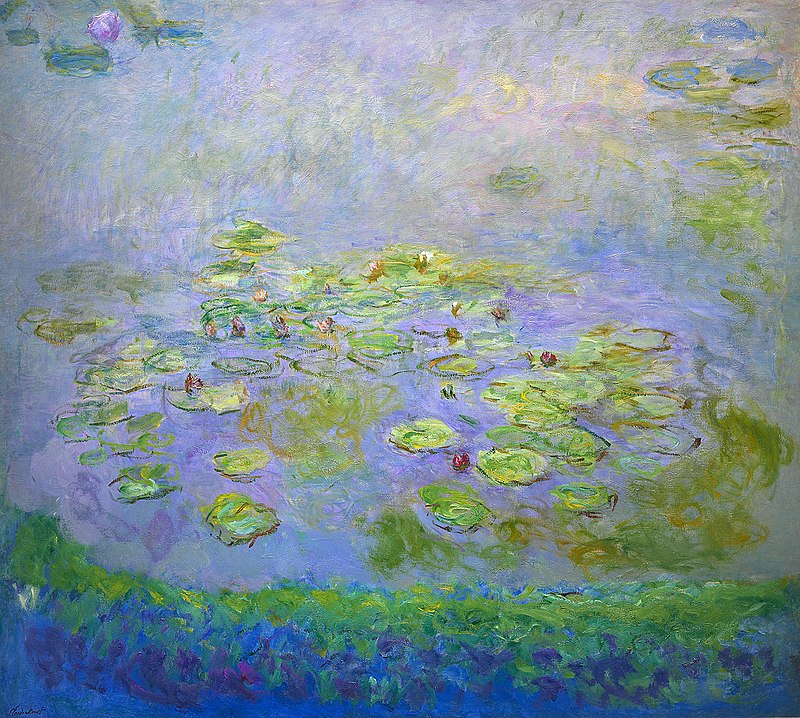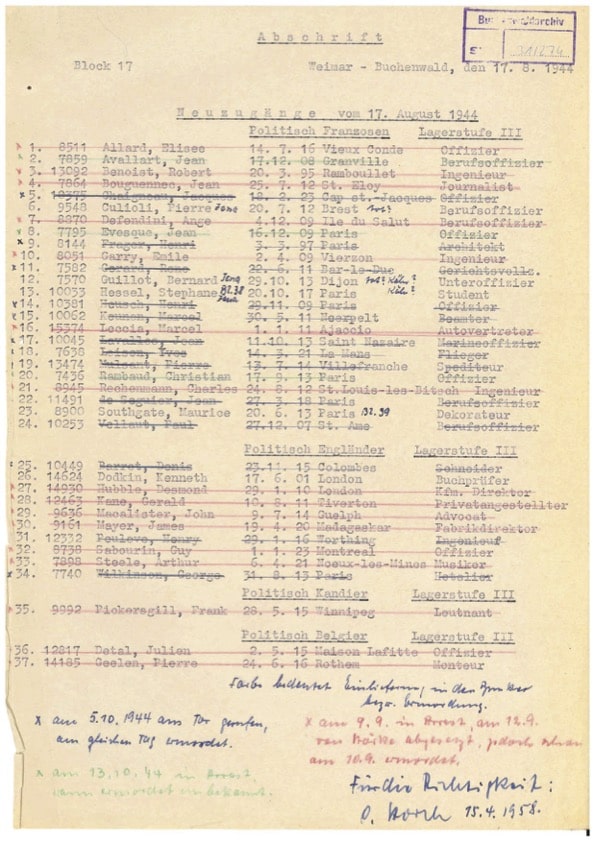Le lecteur retrouvera avec enthousiasme dans État d’ivresse l’esprit sarcastique de Denis Michelis. Sa plume corrosive s’attaque de nouveau à la violence, qu’il dénonce de manière incisive et drôle depuis son premier roman, paru en 2014 aux éditions Stock. Après avoir traité de la violence du travail dans La chance que tu as, et de la violence scolaire dans Le bon fils (Noir sur Blanc), dans État d’ivresse Michelis s’attaque, sur un mode tragique et désopilant, à celle que l’on s’inflige à soi-même. Cette violence est celle de l’addiction, ici de l’alcool, autrement dit celle de la solitude absolue quand on a sombré et que plus personne ne peut vous retenir.
Denis Michelis, État d’ivresse. Noir sur Blanc, coll. « Notabilia », 161 p., 14 €
Dans ce nouveau roman, Denis Michelis continue d’interroger les conflits plus ou moins déclarés entre parents et enfants (grands enfants, l’auteur entretenant un goût certain pour ces périodes incertaines de l’adolescence), mais aussi et surtout la violence de la solitude contre laquelle le personnage principal du récit, la mère de Tristan, âgé de 17 ans, n’a plus assez de force pour se battre.
État d’ivresse n’est pas le récit d’un naufrage – le naufrage a déjà eu lieu. Il est la description du désastre plutôt, mais sans arracher des larmes au lecteur, ce qui n’est pas si facile quand il s’agit d’évoquer l’alcoolisme d’une mère enfermée dans une maison désertée par un époux sans doute à bout et fréquentée épisodiquement par un fils dont on devine qu’il n’a pas vraiment d’autre choix que d’assister à la débâcle, partagé entre tristesse, angoisse, culpabilité et colère.
C’est lorsque tout est terminé que le spectacle commence. Et c’est d’abord celui de ces voix qui se croisent, et sont le gage de la réussite du texte de Denis Michelis. L’ivresse dont il est question ici, on l’aura bien compris, est à des lieues d’une joyeuse ivresse entre amis. Elle est de celles qui font plonger au fond de soi, où les voix ne sont plus capables d’être tues, où le monde réel est cet au-delà flottant et quasi nauséeux qui s’éloigne toujours un peu plus et auquel on ne peut plus se raccrocher. On pensera parfois au Son de ma voix de l’écrivain écossais Ron Butlin pour l’entrecroisement des voix intérieures.

Denis Michelis © Mark Melki
Le lecteur, pendant sept jours, partage le quotidien hautement alcoolisé d’une mère dans une zone pavillonnaire d’une petite ville du Nord de la France où il fit bon s’installer mais où il devient sordide de vivre quand on n’a plus de permis de conduire et qu’on jouit, pour seule compagnie, d’une drôle d’amie, une amie des temps où tout allait bien, et d’un fils fantomatique. Dans un dialogue intérieur continu, la mère, et narratrice donc, voit combien les échappées sont improbables : « Si ton mari et toi avez acheté cette maison, ce n’était pas en effet pour l’attrait de la ville, de cette ville mal fichue que l’on peut résumer à une interminable route principale menant soit au centre (du moins ce qu’il en reste : un bureau de poste, un assureur, une banque et un PMU), soit en forêt. Entre les deux : des maisons blafardes où l’on se hâte de fermer les volets dès que la lumière décline. » Et si l’envie de fuir la prend à certains moments, elle est pourtant incapable de se lever : « Ah, si seulement j’avais le pouvoir de me téléporter dans une autre vie, dans un autre monde. Me désagréger au milieu du salon, laissant derrière moi cet homme et ce grand dadais. » Mais, précisément, la désagrégation est en cours, et elle n’aura rien de salutaire.
La mère flotte du matin au soir dans des vapeurs d’alcool qui rendent paradoxalement la réalité à la fois incertaine et totalement vraie, ce dont l’écriture de Michelis dans l’entrelacement des voix rend compte avec subtilité. En s’enfilant, dans le désordre, des verres de gin, de rosé, de blanc, des bières de Noël trouvées à la cave (et tant pis si ce n’est pas la saison) et, son péché mignon, des mignonnettes, qu’on peut cacher à peu près n’importe où, elle nourrit des échanges parfois musclés avec une voix intérieure pas toujours conciliante, tente d’établir un contact avec Tristan, entreprend d’écrire un article pour un magazine de bien-être et de développement et échange des coups de téléphone avec un patron désagréable, ou tout simplement impatient, rédacteur en chef dont elle ne connaît rien d’autre que la photo sur LinkedIn et qui finit par lui proposer une pause : « Une pause ? Comme au sein d’un couple ? Probablement l’un de mes pires articles où j’expliquais qu’un peu de répit pouvait s’avérer une bonne alternative à la séparation tout en mettant la lectrice en garde : attention toutefois aux pauses qui s’éternisent. »
État d’ivresse, c’est donc un récit qui vient après le naufrage, dans lequel une femme se débat, comme elle peut, avec le temps, avec l’espace, avec les siens, mais surtout avec elle-même. Elle tente à de nombreuses reprises, dans des sursauts de désir, de se raccrocher à la réalité, mais le réel se dilue dans les verres, et alors comment savoir où est Tristan ? « Je me demande quel jour nous sommes, Tristan ne m’avait-il pas parlé d’une matinée de libre une semaine sur deux ? Ou était-ce l’année dernière ? »

Boire sans s’interrompre nécessite de se cacher, du fils d’abord, qui n’a pourtant pas l’air bien dupe, et dont les réactions, jamais décrites, sont suggérées dans les propos intérieurs de la mère, par le prisme du délire éthylique du personnage féminin, ou ceux de la voisine qui oscillent entre répulsion et peur. Le face-à-face, sur un parking de supermarché, avec un clochard suspend le délire pour quelques secondes, comme si la lucidité d’un reflet du futur prenait la narratrice (et le lecteur) à la gorge. Le personnage émeut par ses efforts dérisoires dont elle-même se moque, dans un esprit qui ne la quitte jamais, et qui donne au récit sa saveur, le faisant échapper à toute émotion facile. La lucidité pointe, l’ironie est bien là et c’est peut-être la voie du salut (en tout cas celle à laquelle on aimerait croire) : « Je connais mes répliques, je les connais sur le bout des doigts. Bien sûr que je vais me faire aider, on a tous besoin de se faire aider un jour ou l’autre, pas vrai ? Je retournerai en cure s’il le faut. Cela va sans dire. Non, rien ne va sans dire. Où en étais-je ? (Une gorgée.) Cette décision est une décision collective. Pourquoi, collective ? Car au-delà de ma petite personne, c’est aussi pour mon fils et mon mari que j’ai décidé d’accepter de me faire soigner. (Une autre gorgée.) Mon fils et mon mari qui me soutiennent dans cette longue et douloureuse épreuve. »
Et si tout cela n’était qu’une affaire de masque ? À quelle existence doit-on se consacrer, sans renoncer à ce que l’on est ? La faille originelle n’est-elle pas justement cette impossibilité d’exister ? « C’est dans le tiroir du bas de ma commode que je range mes différents visages. Lequel choisir ? Celui de la mère ? de l’épouse ? de la journaliste ? de la femme d’intérieur comblée ? J’en prends un au hasard (la journaliste) ». L’état d’ivresse fait tomber tous les masques et relève alors parfois d’une mortelle nécessité, en somme une survie toute temporaire.