Dans la forêt du hameau de Hardt, premier roman de Grégory Le Floch, expose à travers un narrateur misanthrope la difficulté et finalement la nécessité de dire. Et d’écrire.
Grégory Le Floch, Dans la forêt du hameau de Hardt. L’Ogre, 152 p., 16 €
Avouons d’emblée que le titre est trompeur. Si le narrateur s’est retiré dans le hameau de Hardt, où sa maison est sise en bordure du bois, il évite soigneusement la forêt « abominable », pour rester sur la route asphaltée qui la tient en respect. Il ne pénètre qu’à deux reprises sous les arbres : la première en quête d’un être hurlant dans lequel il voit un double aussi désespéré que lui, mais qui s’avérera n’être qu’un chien, la seconde pour une promenade silencieuse avec une femme qu’il s’est évertué à fuir pendant dix ans.
Ce narrateur, Christophe, est une âme en souffrance, un homme blessé ; traumatisé par ce qui s’est passé en Calabre, sur une autre route bordée par une autre forêt. Au milieu de cactus, d’agaves et de palmiers « atroces », Anthony, touche-à-tout de génie, exubérant et capricieux, a trouvé la mort dans des circonstances que Christophe, son assistant et faire-valoir, ne veut absolument pas raconter.
Dans cette existence de « cauchemar », où il tente d’échapper à l’horreur en la taisant, le narrateur surmonte ses crises en cherchant du réconfort, au bout de la route asphaltée, auprès de Richter, un homme normal, ordinaire, sauf par son extrême bienveillance. Et il s’occupe en travaillant à une étude sur Thomas Mann, « l’écrivain suprême », étude qu’il a commencée quinze ans plus tôt, et qu’il modifiera, chamboulera, abandonnera, détruira, avant de finalement s’y remettre.
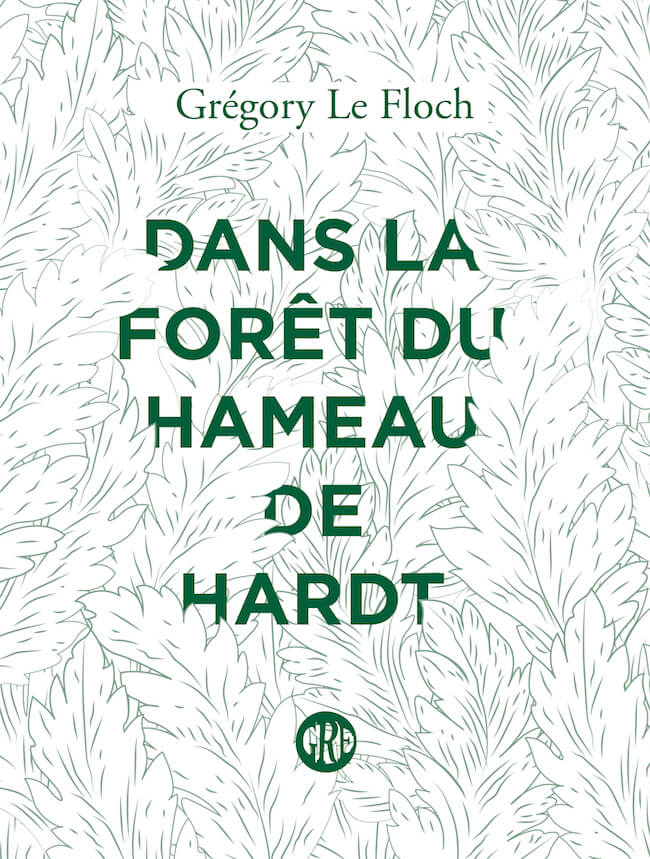
En un style qui peut rappeler Thomas Bernhard par son usage de la répétition, du ressassement, et son sens très sûr du rythme, comme par sa vison sombre des rapports humains, Grégory Le Floch ausculte une impossibilité de raconter qui tourne à la hantise. Certes, Christophe a vécu une scène « abominable » du fait des turpitudes d’Anthony, mais son enfer personnel s’est construit sur son incapacité à la dire plus que sur les faits eux-mêmes.
Mis en abyme, le roman est l’histoire de la gestation du récit de cette scène. L’effet d’attente se tend sur cent trente pages : que s’est-il passé exactement au milieu des cactus ? Au fond, cela n’a que peu d’importance. Le sujet de Dans la forêt du hameau de Hardt, c’est de savoir si et comment le narrateur va arriver à le dire. Et cela, la mère d’Anthony le permet : depuis dix ans, elle le traque, mais, quand elle arrive enfin, elle ne lui demande rien. Elle l’emmène faire une promenade dans cette forêt qui l’apaise. Elle s’installe chez Christophe, pour qui cette présence se révèle beaucoup plus supportable que ce qu’il croyait. Elle le pousse même indirectement à écrire le récit de la mort d’Anthony, à en travailler et retravailler chaque détail vingt fois. Patiente, présente sans être pressante – elle passe ses journées dans les bois –, elle est la lectrice idéale qu’il n’avait pas soupçonnée. Quand il sera prêt, pourtant, Mme Jouve sera déjà partie. Elle n’a plus besoin de son histoire. Mais Christophe, lui, a à présent besoin d’être entendu, il est prêt à sortir de la forêt de cactus de Calabre. Et donc aussi de la forêt du hameau de Hardt.
Ce roman creuse et fouille avec précision aussi bien les affres de la création que la difficulté à trouver les mots justes pour exprimer la vérité d’un événement. Mais cela va plus loin : la parole et l’écoute se font toujours à contretemps. Si Christophe, qui raconte l’histoire que l’on lit à un auditeur indéfini – d’où les « dis-je, dit-il… » qui rappellent que tout cela est médiatisé par une subjectivité –, a eu tant de réticence à parler, s’il remet sans cesse sur le métier son étude sur Thomas Mann, c’est qu’il doute de la capacité des mots à vraiment transmettre une expérience.
S’il s’y résout enfin, c’est sans doute parce que, paradoxalement, la mère d’Anthony lui a elle-même apporté un récit. Au lieu d’entendre comment il a découvert le corps de son fils, elle lui raconte comment Anthony enfant avait découvert son père mort. Ce récit montre au narrateur que le tragique est indémêlable du grotesque, qu’on ne peut pas tamiser la trivialité du quotidien pour en extraire la pureté du sens. À moins que la mère d’Anthony n’ait recherché Christophe que comme un alter ego auprès de qui se débarrasser de son récit de mort et de culpabilité, comme on refile un mistigri. Et que le narrateur se soit empressé de lui rendre la pareille. Dans tous les cas, le livre se termine sur l’image d’« un chat maigre et malade » reniflant sa propre urine.
En ce premier roman à l’écriture impressionnante de maîtrise, Grégory Le Floch entrelace l’humour noir et la vraie souffrance en un questionnement sur les possibilités de dire et d’entendre, de faire part et de recevoir.












