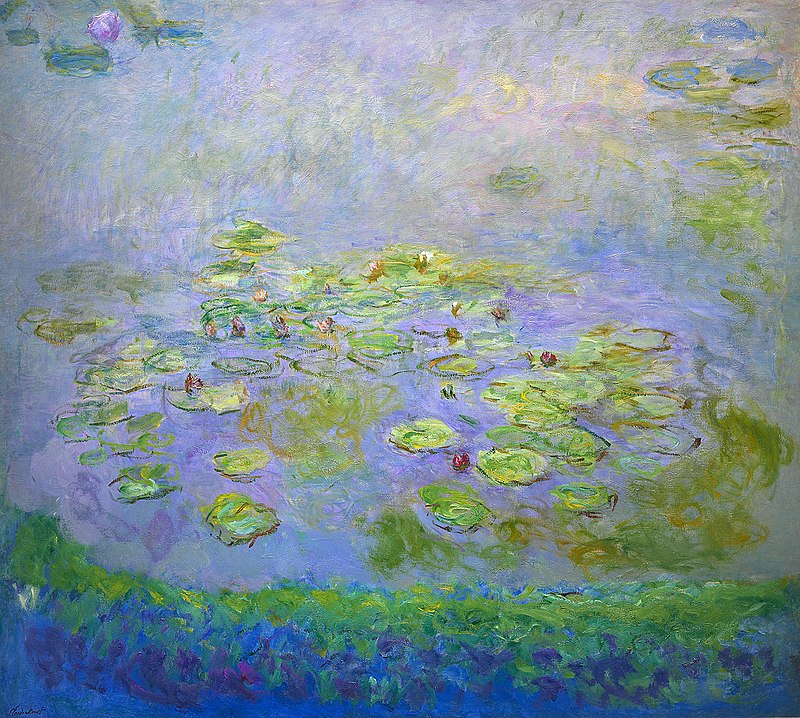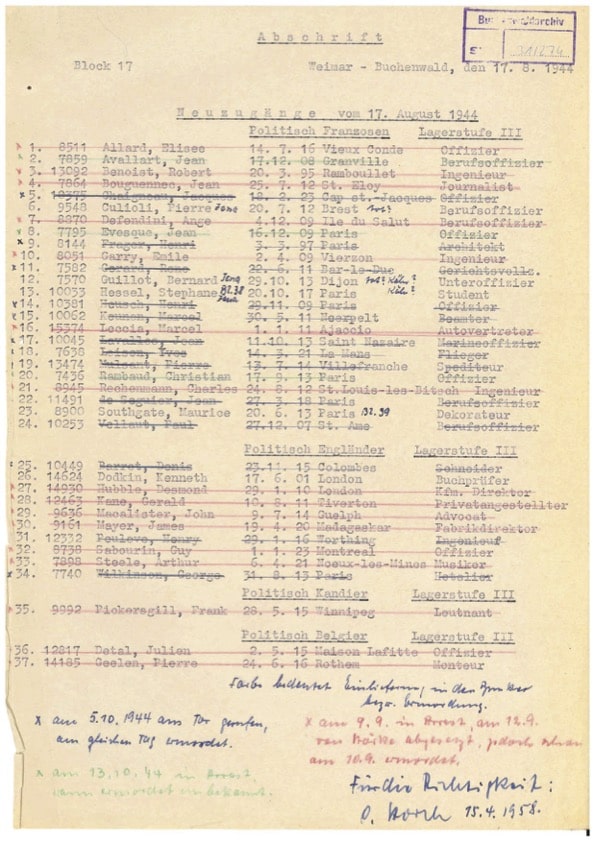Une fois n’est pas coutume, on se fiera à la quatrième de couverture de Rendez-vous à Parme pour savoir ce que raconte ce roman de Michèle Lesbre. On y retrouve des thèmes et des lieux de prédilection, les livres, le théâtre, les chemins pris au hasard, les rencontres, l’Italie et en particulier l’Émilie-Romagne, plongée dans une brume douce.
Michèle Lesbre, Rendez-vous à Parme. Sabine Wespieser, 118 p., 15 €
C’est donc l’histoire de Laure, une femme qui ouvre un carton de livres, découvre un exemplaire de La Chartreuse de Parme. C’est l’histoire d’un voyage d’abord accompli seule, puis avec un compagnon, qui repartira. Mais La Chartreuse de Parme, c’est une promesse de monsieur Barroux : l’été de ses quatorze ans, cet ami de son père lui lisait le roman à voix haute : « Quand vous serez plus grande, vous irez à Parme, il faut lire ce roman de Stendhal à Parme. » Et j’en atteste : incapable de comprendre ce roman à Paris, dans le contexte il est vrai d’un concours, j’ai tout saisi, senti, aimé, une fois la frontière passée. Avec Stendhal, en effet, on franchit la frontière. Sans doute parce que jeune homme il l’a franchie lui-même, arrivant à Milan après le périlleux passage des Alpes, et qu’il a été très heureux.
La narratrice du roman de Michèle Lesbre prend donc le train pour la ville dont Proust chantait le nom « compact, lisse, mauve et doux », et un monde renait, prend forme. Lecture faite, elle envoie deux lettres au vieil ami de son père.

Philippe Clévenot en 2001 © Bérangère Bonvoisin
Le roman de Michèle Lesbre est l’évocation d’un temps passé. Il lie entre eux des noms et des instants que l’on a eu la chance de connaître quand on avait vingt ou trente ans dans les années soixante-dix et que certaines formes de beauté, d’intelligence, d’ardeur étaient ou semblaient au cœur de nos conversations, suscitant l’émotion et la discussion. Il est question de Chéreau, parce que Laure a failli faire du théâtre avec Léo qu’elle a peut-être aimé. On reconnaît la silhouette de Philippe Clévenot, interprète de Woyzeck, d’Alceste, du Neveu de Rameau, d’Artaud le Mômo, qui côtoyait constamment les gouffres, et dont elle retient une phrase superbe : « Il faut toujours s’inventer des abîmes jusqu’au dernier soir, il y a un combat. » Elle se rappelle Kantor, et Qu’ils crèvent les artistes : « On entrait dans les âmes, elles nous laissaient chancelants. » Nous avons partagé ces moments de théâtre.
Et puis Prague, Havel, Hrabal, une sorte de rêve éveillé : c’était la fin des années grises dans cette Tchécoslovaquie qui ressemblait tant au désir d’Europe, une Europe des théâtres, des livres, des cafés, des bibliothèques, qui manque si cruellement à l’heure des réseaux asociaux et des pulsions haineuses et anonymes. Il y a « trop d’absents », « trop de fantômes », comme l’écrit la narratrice, et ces absents nous manquent aussi cruellement que l’utopie née de la fin d’un Mur.
« Nos vies sont peuplées d’ombres flottantes » : on lira donc ce Rendez-vous à Parme comme une promenade mélancolique parmi ces ombres. L’intrigue est mince, et c’est délibéré. Après tout, on lit une histoire de « rêveurs debout », une histoire de commencements : « Je n’avais peut-être rien su faire d’autre que de succomber au charme de ce qui survient, l’inattendu, le merveilleux cadeau du hasard. » Et comme dans Chemins, un précédent roman, la narratrice se laisse prendre par le charme des sentiers, des ruelles ou des arcades qui, à Bologne, laissent passer le « cri murmuré ».

Les trois ponts de Comacchio, en Italie
Stendhal a choisi Parme pour son nom plus que pour la réalité des faits, lesquels appartenaient à la chronique des Farnèse dans laquelle il avait puisé, un peu copié, mais grâce à laquelle, surtout, il avait beaucoup imaginé. Les lieux qu’il décrit sont ailleurs, à Modène et surtout dans ses souvenirs italiens. Peu importe, puisque Clélia cultive des orangers sur la terrasse de la prison, que Fabrice invente son alphabet d’amour, et que, enfermé, le jeune héros ne tient pas trop à s’évader. Parme est trop « lisse » pour Laure ; elle lui préfère Ferrare dont la sagesse « est une sorte de philosophie du temps qui passe et ne change rien, ou peu de chose, mais une sagesse timide, quelque chose d’un peu absent ». Ferrare, la ville de Bassani, et d’Un certain Felloni.
Avec Michèle Lesbre, on est dans l’impression, le détail, la nuance. Ainsi quand elle évoque les eaux lascives du Pô, vers les trois ponts de Comacchio, tout près de ce delta qui a servi de cadre à Visconti pour Ossessione et à Antonioni pour Le cri. C’est une Italie brumeuse et silencieuse que la narratrice quitte à Turin, seule pour conclure le voyage : « Il y a des villes pour les chagrins et d’autres pour le bonheur, parfois ce sont les mêmes. » Sans doute faut-il qu’elles soient les deux mêlées, pour qu’on supporte et aime (un peu) le présent.