Comment dessiner aujourd’hui la Carte du Tendre d’une jeune New-Yorkaise ? Catherine Lacey, dans son roman Les réponses, trace un itinéraire inquiet, distancié, mais finalement tonique, à travers jeux de rôle et manipulations, à la recherche du temps perdu du sentiment amoureux.
Catherine Lacey, Les réponses. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Myriam Anderson. Actes Sud, 362 p., 22,80 €
Les lecteurs du premier roman de Catherine Lacey, Personne ne disparait (2016), qui s’achève par la phrase : « Elle s’est presque immobilisée mais pas tout à fait parce qu’elle tremblait et qu’elle tremblera toujours et je l’ai regardée continuer à trembler », retrouveront cette fragilité angoissée du personnage féminin dans la fuite en avant des expédients et remèdes qu’elle met en musique dans son second roman au titre faussement carré, Les réponses. De même, ils reverront les moments récurrents consacrés à la rupture et à la perte de soi, non plus à l’autre bout du monde mais au coin de Broadway. Très en phase avec le New York d’aujourd’hui où elle situe l’intrigue, Catherine Lacey n’a aucune peine à imaginer un monde-reflet où le débordement d’arnaques au divan, le foisonnement des marchands de réponses, le peuple exponentiel des rebouteux de l’âme en péril et autres raccommodeurs du mal-être offrent une matière abondante où puiser.
Tout se défait et s’accélère pour la jeune Mary, sortie de l’Ivy League, qui tente et épuise toutes les options pour voir clair dans le vide de sa vie affective et réparer ses dégâts somatiques. Cousue de dettes pour faire face à une thérapie alternative coûteuse, elle postule fébrilement au hasard des petites annonces et se trouve alors retenue pour une étrange expérience psychique. Ainsi le corps est-il posé d’emblée, étalé sur la table de massage pour de longues séances de trois heures, puis dans un second temps l’esprit s’ébroue en résonance étroite avec le processus de création. L’habileté de Catherine Lacey tient d’abord dans son choix d’une jeune première aux abois, « un sac de peau plein de problèmes », d’une merveilleuse intelligence dans le narcissisme et l’auto-analyse, presque candide, toujours en tension et prête aux vibrations salvatrices. Manhattan devient le lieu emblématique des métropoles contemporaines avec leurs espaces de manipulation en tout genre, leurs offres de thérapie identitaire, tandis que Mary oscille entre les attouchements de la salle de kinesthésie et les entre-deux piégés des entretiens d’embauche, vivant le paradoxe des abandons de soi pour l’espoir fallacieux d’aller mieux. Lieux anonymes, lieux intimes, lieux des dévoilements, tous extorquent les secrets de leur proie : l’engrenage est là, nouvelles portes de sortie mais nouveaux enfermements, le ressort est bandé, comme disait Anouilh au départ de ses pièces grinçantes.
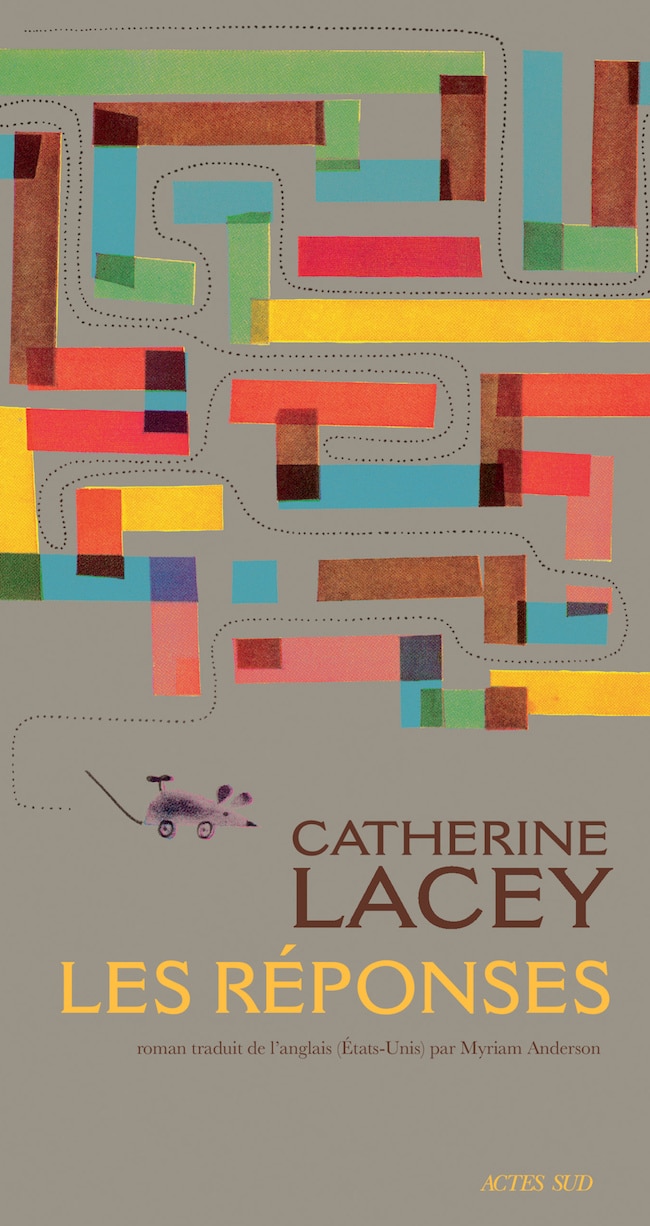
« Parfois, j’ai l’impression que je n’ai que des questions, que je poserai les mêmes toute ma vie. Je ne suis même pas sûre de vouloir les réponses, je ne pense pas en avoir l’usage, mais je sais que je donnerais n’importe quoi pour être quelqu’un d’autre – n’importe qui d’autre – ne serait-ce que pendant une journée, une heure. Il y a dans cette distance quelque chose qui fait que je suis prête à n’importe quoi pour la traverser. » Le roman est donc cette traversée opiniâtre vers une vie autre, vers un impossible retour aux certitudes et aux premiers émois. Il revient sobrement sur des scènes fondatrices impliquant les personnages satellites de Mary qui tous s’évanouiront au cours de ce périple presque immobile, la laissant seule face à ses questions, toujours pressée, éparpillée, manipulée et manipulatrice.
L’écriture de Catherine Lacey impulse une énergie avec ses pluies de questions, ses moments rapides à la première personne, ses monologues intérieurs, ses échos des nouvelles sortant d’un poste de radio. Stress, solitude et chaos mis en mots, il y a peu de descriptions, plutôt des notations brèves de lieux qui ouvrent des aperçus poétiques – un taxi new-yorkais avec ses passagers comme encadrés dans un tableau, un vendeur d’eau à la sauvette, dernière silhouette du roman –, des touches de New York en exposition permanente, mais surtout des paroles intérieures. Quelques facilités dans ce mécanisme obstinément binaire, quelques longueurs dans cette boucle qui ramène à une chambre à soi et une frustration romantique, mais l’ironie sauve tout, équivalent des caméras et capteurs qui mettent la vie en boite dans le studio de production. La parodie, dont celle de la soirée de gala de cinéma où des observateurs intrigués du couple Mary/Kurt imaginent qu’il « s’agissait d’une androïde, puisqu’elle resta d’une immobilité robotique toute la soirée », donne une respiration à cette chronique de la paranoïa ambiante. La Petite Chérie Émotionnelle encapuchonnée tient ses promesses.
À la lisière de la science-fiction, le roman qu’on a pu, à tort, apparenter à quelques Fragments d’un discours amoureux, joue de la répétition et de la minutie pour mieux appréhender les facettes d’une pulsion qui comporte son lot d’atermoiements, d’épreuves et de dérives. Dans le mouvement pendulaire entre dépendance et abandon, Catherine Lacey pose crûment des scènes de viol de la femme-objet aussi bien qu’elle démonte par épisodes le mécanisme des techniques d’un asservissement ambigu, à la fois honni et consenti. Le corps et l’esprit de Mary, qu’elle soit la fille, la patiente ou la servante, sont soumis aux doigts ou aux attentes d’un homme : enfant, elle est sous la coupe d’un père très religieux qui la soustrait au monde pour protéger sa pureté, puis c’est le masseur qui la sculpte à sa guise au cours de longues séances cérémonielles, enfin la star qui l’emploie comme partenaire pour son confort. Elle devient alors partie et copie d’elle-même. Dans sa fonction appointée de « Petite Chérie Émotionnelle » auprès de Kurt Sky, acteur célèbre, Mary joue son rôle ancillaire et fait merveille au service de l’équilibre affectif de l’artiste créateur, également soutenu par un aréopage de femmes poussant à l’extrême la panoplie des rôles genrés dans ce harem de la performance programmée. Vieux débat, certes, mais qui s’ancre ici dans la lente période du montage d’un film : la métaphore est pertinente et pourrait coiffer tout ce roman de la construction et du choix. L’ambiguïté face au statut de cobaye préposée à l’épanouissement d’autrui met en relief la procrastination, la projection de désirs flous toujours inassouvis, mais surtout la sensation de vivre au second plan chez cette jeune femme témoin du flottement d’un homme, metteur en scène de vies fictionnelles à composer et doser pour d’autres spectateurs, un homme connu mais en mal d’intimité. Et chacun vrille dans une composition en abyme à l’infini.

Catherine Lacey, © D. R.
Aux marges de l’avant-garde des mondes parallèles, Mary observe aussi bien les coulisses du monde du spectacle que celle d’une cellule de recherche, car la vedette et le chercheur en biotechnologie sont pris dans un jeu d’emboitements : il s’agit d’élaborer un film et, pour ce faire, de trouver un traitement qui permette d’éprouver, sans les parasites de la vie ordinaire, les seuls sentiments espérés, « une réponse rationnelle face à un monde incertain, une série de réactions neurochimiques qui peuvent être remontées jusqu’à leur origine ». Grâce à cette maîtrise des seules émotions utiles, canalisées par le truchement des petites chéries adjuvantes au service d’un créateur, adviendraient le bonheur sans nuages, la geste artistique épanouie.
Faut-il pour autant classer Les réponses dans la catégorie des « neuroromans », inspirés par la pratique des neurosciences ? « J’étais ailleurs. Je n’attendais rien. Je savais bien que cette façon d’être amoureux n’était techniquement qu’un cocktail de neurotransmetteurs destiné à vous faire sentir invincible et infini – au-delà du langage, au-delà de la logique – mais je savais aussi que l’amour était un truc aussi exaltant que temporaire, un prélude à la douleur. » Il y a belle lurette que les caricaturistes du New Yorker traitent le prologue amoureux sous l’influence des phéromones, mais le roman qui se nourrit de constants décalages touche également aux thèmes de l’isolement et du repli, de l’amitié féminine, parfois instable et si indispensable, de la dépendance à autrui, si bien qu’il se sature de multiples émotions, fines et fugaces.
Le portrait de la mythique femme de trente ans, proposé par Catherine Lacey, reste proche, humain par ses tâtonnements, ces « Je voulais en savoir plus, et je voulais en savoir moins », comme l’avoue Mary, toujours verrouillée et qui tente de faire sauter les verrous. La réponse est sans cesse déplacée, différée, le sujet sans cesse renvoyé à la connaissance de soi, mais le roman s’élargit, devient méditation sur l’art, la gloire établie ou inopinée aussi bien que sur la solitude et le flottement, l’équilibre mouvant de la vie amoureuse. « L’amour au désespoir fait gloire encor d’aimer », écrit Corneille, tandis que Mary, à la toute fin de cette expérience insolite, se juche sur l’escalier de secours, une échelle d’incendie.












