Pour qui croirait que les Géorgiques sont un obscur traité d’agriculture, un texte mineur, virgilien, certes, mais en marge de l’Eneide, la traduction de Frédéric Boyer, œuvre à part entière, fera l’effet d’une déflagration. Ce que l’on y découvre ? C’est que la terre est un mythe : elle l’était sous la plume de Virgile, un mythe âpre, parfois irénique, parfois guerrier, à destination, au moins apparente, des vétérans qu’Auguste remerciait d’un lopin de terre. Elle l’est encore aujourd’hui, quoique différemment bien sûr, puisque l’urgence écologique nous contraint à nous demander quels récits, quels aveuglements nous ont menés là où nous en sommes.
Le souci de la terre. Nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile par Frédéric Boyer. Gallimard, 264 p., 21 €
Certes, tel passage de l’œuvre virgilienne chante le bonheur du paysan comparé aux malheurs des soldats ; ailleurs encore, le poète affirme qu’il entamera bientôt un poème plus martial (l’Énéide encore à venir), et les Géorgiques, qui s’achèvent sur la réapparition des abeilles, peuvent à bon droit se lire comme une œuvre de pacification ; néanmoins, et c’est son originalité, la traduction de Frédéric Boyer s’attache, avec une magnifique et batailleuse énergie, à révéler – quitte à accentuer le trait – quel souffle épique et douloureux, quelle inquiétude, les traversent aussi.
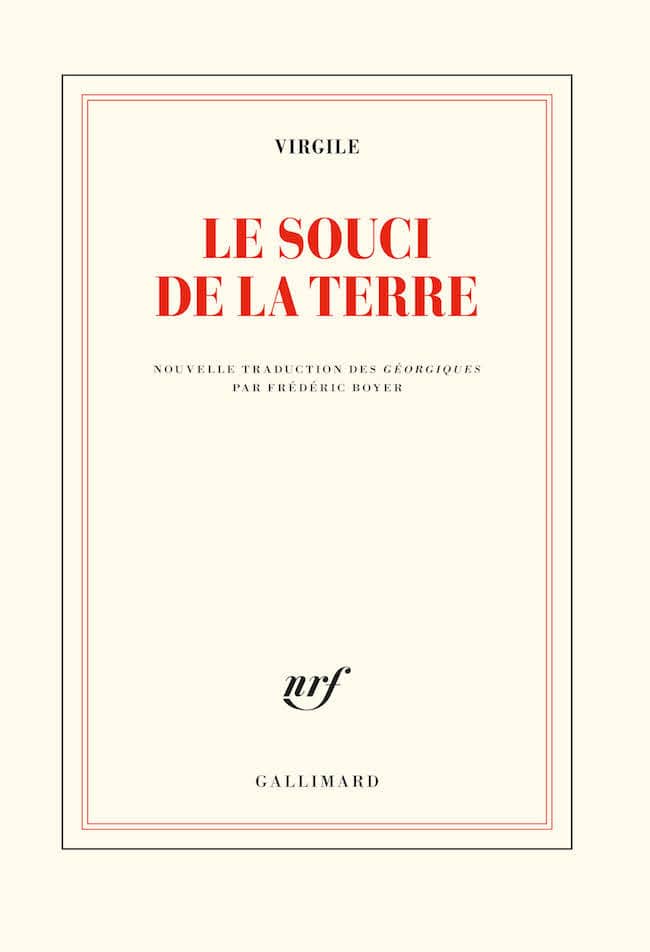
Le labeur du paysan y est, en effet, une guerre : il nécessite des armes, « dire aussi quelles armes pour les paysans endurcis, sans lesquelles ni les moissons ne sont levées » , de la patience, un souci toujours renouvelé à l’égard d’une terre difficile, dans les grandes comme dans les petites choses. Si le genre didactique se teinte d’exhortation, c’est que la nature n’a rien, ou très rarement, d’accueillant, d’apaisant – elle nécessite d’être brisée, contrainte, « vite dans les forêts dompter un ormeau, le tordre avec violence », dominée, « que la terre vaincue ne se désagrège pas » si l’on veut en tirer une subsistance – et encore y faut-il aussi de la chance, quelle que soit la prudence mise en œuvre. Du reste, les animaux comme l’extrémité des terres sont parfois mal connus : et le texte verse, à l’occasion d’une comparaison ou d’une gradation, dans des échappées où se lisent des sauvageries qui dépassent l’entendement : des juments folles d’excitation fécondées par les vents, des humains égorgeant « au plus près » des cerfs « engourdis sous une masse de neige fraîche » (« Joie ! », s’exclame la traduction pour traduire l’adjectif « laeti », heureux), puis regagnant leurs souterrains, pour jouer et boire, les corps couverts de peaux de bêtes (« Joie ! », répète la traduction).
C’est sur fond d’inquiétude et d’enthousiasme face à un monde démesuré, presque maudit (« Le Père lui-même n’a pas voulu qu’il soit si facile de cultiver la terre ») que se déploie l’art de l’agriculture d’une humanité comme menacée par de brusques changements d’échelle imposés à l’époque de Virgile par les guerres lointaines, harcelée par tout ce à quoi il faut penser, ici, pour espérer survivre. Dans cette temporalité des tâches toujours recommencées, le repos est maigre, la mort même n’est pas une option : là où d’autres traduisaient « il n’y a pas de place pour la mort » pour « nec morti esse locum », Frédéric Boyer est le seul, à notre connaissance, à proposer : « il n’y a pas de lieu dans la mort » et la différence est amère. Si la mort la mort est inhabitable, non seulement il n’y a pas d’au-delà accessible où nos morts se reposeraient, mais pas non plus de consolation dans les rêveries sur sa propre mort comme retour fusionnel à la terre, pas de nostalgie ou d’espoir romantique de la terre comme quiétude : le souci de durer encore un peu, ici, est l’unique sel de la vie. Le seul repos possible est celui de l’otium, la disponibilité, nécessaire à la composition poétique.

Buste de Virgile, vers 45 avant J.-C
La traduction en vers libre de Frédéric Boyer, proche de l’ordre des mots latins, opère des choix d’une rare fécondité. Outre l’ adverbe « vite », souvent repris, l’usage des exclamatives « au travail » et « oh », il y a celui de traduire la plupart des formules impératives latines par des infinitifs. Rarement les différentes nuances de l’infinitif francophone auront si bien résonné ; elles vont de l’exhortation quasi militaire au conseil presque murmuré pour soi, ou à une sorte de prise de notes hâtives, pour mémoire, ou bien encore à l’élaboration d’un rêve de bonheur « Alors appeler les vents pour courir / Et voler à travers les plaines ouvertes comme libéré de ses rênes /Et de ses traces ne faire qu’effleurer le sable ».
Ensuite, le choix du vers libre, mais très bien scandé, variable en longueur, permet d’isoler des mots, de jouer de parataxes, de faire varier les vitesses ; et plus encore, le découpage des strophes, très personnel puisque Frédéric Boyer s’émancipe complètement du découpage des paragraphes de l’édition Budé établie par Eugène de Saint-Denis, permet d’isoler sur la page des vers qui, désormais, forment à eux seuls vignette ou poème, souvent poignant : « Le temps fuit en attendant / Il fuit irréparablement/ Pendant que nous détaillons chaque détail de notre prison / l’amour » ; « C’est le destin / Toute chose court au pire / Se corrompt et décroît / pas différent de qui, sa barque sur le fleuve, rame à contre-courant/ Et si par hasard ses bras faiblissent, le lit du fleuve d’un rapide l’entraîne à la dérive ». Ajoutons à cela les couleurs qui se disent avec des adjectifs en latin et qui sont ici, souvent, substantivées, « avec mousse et vert intense des herbes sur la rive », et l’on aura le portrait d’une traduction enthousiaste, romantique, non par sa nostalgie (encore que le refus de la nostalgie en soit peut-être une forme) mais par l’énergie qu’elle déploie pour arpenter un monde perçu comme précaire, intense, ingrat et précieux.

Simone Martini, Frontispice des Géorgiques de Virgile, 1340
Accordons-nous pour finir un très léger dépliage. Dans l’essai qui précède sa traduction, Frédéric Boyer commente le choix de son titre, Le souci de la terre, par lequel il souhaite donner à entendre le « cura » latin, soin et sollicitude. Le souci de la terre, c’est, nous dit-il, le souci du seul lieu possible, lieu déserté des morts qui n’y reviendront pas et qui font qu’on y chemine parfois, comme à travers des ruines. En ce sens, sa traduction déconstruit le mythe d’un au-delà, fût-ce celui, parfois consolateur, du « retour à la terre ».
Cependant ce que la traduction de Frédéric Boyer nous donne aussi à entendre, c’est que la terre ainsi pensée devient la mesure d’une forme d’humanité. Or on ne peut que remarquer combien cette humanité vivante, laborieuse, dompteuse d’arbres et de chevaux, est virile. Bien sûr l’agriculture chez Virgile est un travail d’hommes, voire un exercice de virilité comparable parfois à celui de la guerre — et il est légitime et nécessaire que cette association se retrouve dans la traduction. Mais lue dans un français contemporain qui fait le pari un peu romantique du lyrisme et de l’enthousiasme, alors que depuis longtemps l’agriculture n’est plus seulement à taille humaine, et que l’évocation d’outillages (les « claies », les « hoyaux ») ne peut manquer d’éveiller quand même un peu de nostalgie, cette association du travail agricole manuel et d’une forme de virilité dure au labeur, marquée par la figure du Père, ne peut manquer d’interroger un peu. Et si les Géorgiques de Frédéric Boyer peuvent nous aider à mieux habiter la terre, c’est peut-être aussi en nous invitant, par leur beauté propre, à reconnaitre dans cette association l’expression, elle aussi, mais différente, d’un mythe littéraire et culturel.











