The Dragonfly Sea est le nouveau roman de l’écrivaine kenyane Yvonne Adhiambo Owuor, auteure du magnifique Dust (La maison au bout des voyages, Actes Sud, 2017). Entre le conte, le roman de formation et la world fiction, ce récit d’un voyage qui conduit Ayaana de Pate, son île au Kenya, invisible sur la carte du monde, vers la Chine tentaculaire a pour protagoniste la mer.
Yvonne Adhiambo Owuor, The Dragonfly Sea. Knopf. 512 p., 15,97 €
Mer caressante, apaisante, câline, mer terrifiante, ogresse qui dévore ses enfants. Métonymie de l’absence, porteuse de messages cryptés des disparus, la mer est aussi une métaphore de la connaissance à laquelle accède Ayaana : « le savoir est un océan, il n’a ni murs ni toit », est-il écrit sur le leso vert et blanc qu’elle offrira à son retour à sa sévère tutrice chinoise, Shu Ruolan. La mer réunit et sépare les personnages du roman d’Yvonne Adhiambo Owuor. Alors qu’ils pensent la maîtriser, elle écrit leur histoire – comme celle des libellules migrantes portées par les vents entre l’Asie et l’Afrique. Ce sont des êtres marginalisés par leurs sociétés, abandonnés, comme Munira, la mère d’Ayaana, victimes d’accidents au cours desquels leurs proches ont péri, comme Lai Jin, le capitaine du bateau qui emmène Ayaana vers d’autres rives. De leurs blessures ils ont appris à faire des armes, mais aussi à lire celles inscrites sur le corps des autres, telles les marques de brûlures sur le visage de Lai Jin, qu’Ayaana enduit de henné, y dessinant une infinie tendresse pour conjurer l’adversité.
Musulmane, la population de l’île est hospitalière de tradition. Elle est exposée d’un côté aux répercussions du djihadisme – qui y fait des recrues, à l’instar du camarade de classe d’Ayaana, Suleiman –, de l’autre à la globalisation, et en particulier aux investissements chinois dans les infrastructures, notamment la construction de routes. L’un turc, l’autre chinois, les deux hommes qui se disputent Ayaana symbolisent les visées impérialistes de leurs pays respectifs sur le Kenya. Les intérêts économiques sont euphémisés, enjolivés par l’invention de liens culturels sur fond « biologique » : de père inconnu, Ayaana aux yeux bridés est élue « Descendante » d’ancêtres chinois qui auraient accosté six cents ans plus tôt dans l’île, et se voit décerner à ce titre une bourse d’études en Chine. Une histoire vraie qui a inspiré ce roman.
Le voyage, qui occupe une bonne part du récit, devient le lieu de tous les possibles mais aussi de tous les dangers : vents, tempêtes, pirates. Le navire est le théâtre de scènes tantôt dramatiques tantôt cocasses : dans la soute où les passagers se sont réfugiés surgit une Delaksha Tarangini en élégante robe de chambre camélia chaussée de ses Louboutin conçues comme arme de légitime défense antipirate. Arrêtant le temps, les moments d’existence suspendue, les frayeurs partagées, l’assistance mutuelle, sont aussi des vecteurs d’intimité, dont naissent des affinités électives, abruptement interrompues par la fin de la traversée.
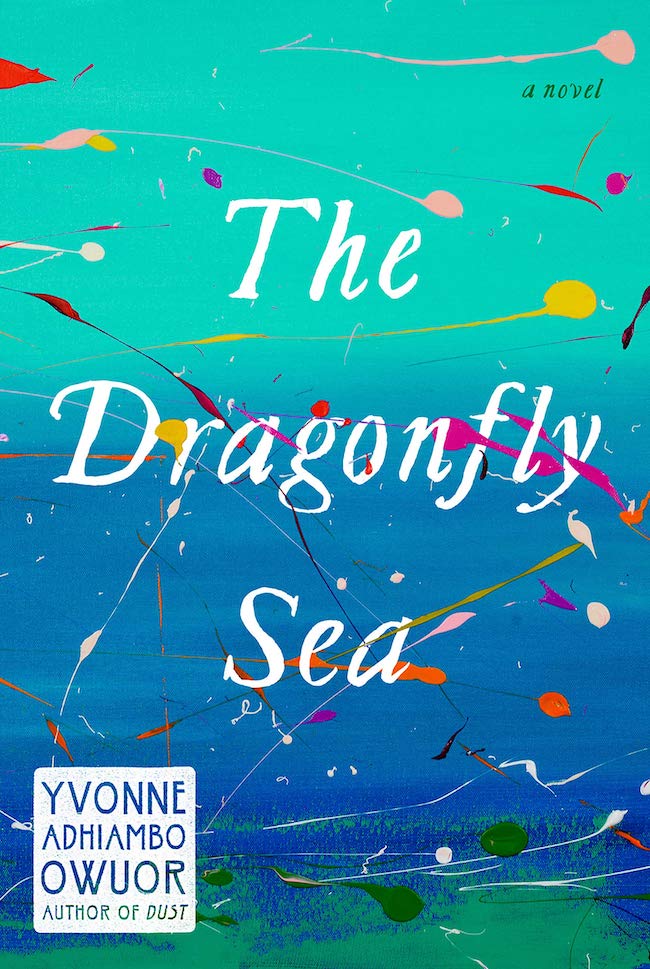
Roman de formation, au cours duquel Ayaana fait l’apprentissage de la féminité entre rites initiatiques et dressage du corps, ce récit porte aussi sur la condition des femmes et les violences dont elles sont l’objet. Les promesses non tenues d’un prétendant qui s’est volatilisé ont fait de Munira une fille mère. Elle cède à la tentation de livrer, pour quelques liasses qui leur ouvriraient le monde, sa fille de dix ans à un riche pédophile – perplexité de la mère lorsqu’elle réalise que c’est sa fille et non elle-même que convoite le prédateur cossu ! –, avant de se ressaisir, non sans qu’Ayaana ait subi des violences indélébiles. Devenue une jeune femme, Ayaana est victime de harcèlement de la part de son prétendant turc qui l’a emmenée en vacances à Istanbul dans sa puissante famille.
De ces meurtrissures, les femmes tirent force et indépendance. Inversant le rapport de force entre les sexes, Munira aura deux époux, père et fils : impatiente Pénélope, elle épouse Muhidin après avoir longtemps attendu le retour de Ziriyab, son premier mari, fils de Muhidin, lequel rentre de plusieurs années de détention après la disparition de Ziriyab. Abandonnant la médecine chinoise avec son rôle de « descendante », Ayaana décide de préparer un diplôme en études de sciences nautiques pour retrouver le père qu’elle s’est choisi, Muhidin, disparu en mer : elle est une des trois femmes sur les dix-sept étudiants du programme de l’Université maritime de Xiamen. Et c’est un métier d’homme qu’elle exerce lorsqu’elle rentre à Pate, après s’être fait faire une coupe à la garçonne : la construction et réparation de vaisseaux. Ayant rejeté son riche prétendant turc, elle épousera l’homme démuni qui a traversé l’océan Indien depuis la Chine pour la retrouver.
Mais Ayaana est aussi dépositaire des secrets des parfums, élixirs, soins du corps auxquels l’a initiée sa mère. Ses flacons l’accompagnent dans ses pérégrinations autour du monde, et son corps dégage une fragrance de rose et de jasmin qui embaume le roman du Kenya à la Chine, talisman qui assure l’identité de sa personne alors même qu’elle en acquiert une nouvelle en s’immergeant dans la langue et la culture chinoise. Odorat, toucher, vision, son, goût (découverte de la cuisine chinoise, puis turque), les sens par lesquels Ayaana appréhende son environnement constituent un dispositif narratif qui donne vie, sur la page, à ses émotions, ses désirs, ses répulsions.

Yvonne Adhiambo Owuor © D. R.
Exactement au milieu du roman se trouve une superbe description phénoménologique de l’expérience faite par Ayaana de l’étrangeté en terre inconnue, expérience de dissolution en même temps que prise de conscience de la couleur de sa peau qui trahit sa présence comme corps étranger : « Every way she turned, someone was watching her. Now she shrank, as if to become invisible. Futile : she was taller than most of the crowd. There were some tourists, too – Westerners, with the look of the perennially surprised. Her eyes scanned above heads as if self-programmed, scanning for images and any likeness of the familiar. She was mute in her hunt. When she looked at the signs, it was as if she were blind, and for the first time in her existence, she became conscious of the shade of her skin. »
Cette description, qui évoque les romans de formation africains, délocalise cette expérience du monde occidental – significativement absent de cet univers romanesque, hormis une brève allusion à la concurrence sino-américaine en Afrique – vers l’Extrême-Orient, tout en résonnant avec la littérature postcoloniale. Mais ici l’immigration implique l’apprentissage d’une langue étrangère ardue, et la transformation de l’être qui, de retour dans son île, réalise que ses pensées vagabondent en mandarin. Reste la mer, l’unique « chez soi », comme lui a dit Muhidin au téléphone lors de leur dernière conversation.
Polyphonique, écrit dans un anglais chatoyant, parsemé de mots, phrases ou citations en kipate (dialecte swahili de l’île), mandarin, arabe, turc, persan, français, portugais, latin, le roman est également peuplé de livres, de Shakespeare et Jane Austen à Orhan Pamuk et José Eduardo Agualusa (The Book of Chameleons), mais aussi Han Song (High Speed Railway) et le poète persan Hafiz, qui accompagne Ayaana comme son parfum de rose. Insatiable lectrice, Ayaana conquiert sa liberté par la connaissance. La petite fille avide de savoir a retenu la leçon de son père adoptif et premier professeur : « books are emissaries from other worlds », « les livres sont les émissaires d’autres mondes ».












