De la « découverte » de l’Amérique par Colomb, on connaît l’imaginaire médiéval de conquistadors imprégnés de pensées eschatologiques et prophétiques, à la recherche de mythiques cités d’or. On sait moins en revanche que, dès ses débuts, l’entreprise de conquête (conquistar) fut aussi un projet de peuplement (poblar). C’est ce que rappelle le livre d’Alain Hugon.
Alain Hugon, La grande migration. De l’Espagne à l’Amérique, 1492-1700. Vendémiaire, 412 p., 24 €
De cette « découverte », on retient d’abord la date, étape – plutôt que prélude – d’un processus de « mondialisation ibérique » entamé dès le début du XVe siècle par les navigateurs espagnols et portugais le long des côtes africaines. On retient aussi la geste conquérante de ses épigones – Núñez de Balboa vers le Pacifique, Cortès au Mexique, Pizarro au Pérou – et le cortège de violences et de destructions qui nourrira la légende noire espagnole. Mais, sous la bannière des rois catholiques et de leurs descendants, ce sont surtout des dispositifs d’encadrement migratoire qui furent institués. Leurs structures devaient se maintenir jusqu’à l’effondrement du système, au tournant du XIXe siècle, sous l’effet conjugué de la libéralisation du commerce et des nouvelles libertés concédées par la Constitution espagnole de 1812.
Spécialiste de l’Espagne, de Naples et de la diplomatie européenne au XVIIe siècle, l’historien Alain Hugon met le cap à l’ouest dans son dernier livre consacré à cette Grande migration espagnole vers le Nouveau Monde. En détournant la référence à la « migration de masse » vers l’Amérique qui caractérisa le XIXe siècle, le titre signale l’intensité et l’antériorité d’un phénomène qui transforma les sociétés hispaniques péninsulaires et coloniales dès le XVIe siècle.
Combien de candidats au départ, embarqués sur le Guadalquivir à Séville ou dans la baie de Cadix, accostèrent sains et saufs sur les rivages de la mer des Caraïbes ? Avec précaution, Alain Hugon avance le chiffre d’un demi-million d’hommes entre 1492 et 1700. Il est vrai que les séries documentaires (les permis d’embarquement) sont lacunaires et bravent les statisticiens trop téméraires. De plus, une multitude de passagers clandestins échappaient à l’opération politique de mise en liste qui incombait aux officiers de la Casa de Contratación. Cette institution, créée à Séville en 1503, supervisait le commerce transatlantique avec le consulat des marchands de la ville. En concertation avec le Conseil des Indes de Madrid, elle jouait aussi le rôle de « centrale d’émigration », statuant sur les demandes de séjour ultramarin et définissant les critères d’admission au voyage.

Vue du Palais de l’Alcazar de Madrid, résidence des rois d’Espagne, où était installé le Conseil des Indes jusqu’en 1701, par Felix Castello (entre 1630 et 1640)
L’originalité du livre de Hugon réside dans l’attention portée à la figure de l’émigré, cet individu situé, dont « on sait d’où il vient et d’où il part », à la différence de l’immigré selon l’auteur. Pour restituer les motivations des candidats aux Indes, les procédures auxquelles ils devaient se plier, les conditions matérielles du voyage, et pour mesurer les effets de leur absence sur les proches demeurés en Europe, l’historien a puisé dans les Archives de Séville et de Cadix. En parallèle, il a exploité une ressource bibliographique aussi riche qu’utile à l’histoire des sensibilités en contexte migratoire : des recueils de lettres écrites par les résidents des Indes à leurs parents d’Espagne.
De ce portrait de groupe émergent des voix particulières, comme celles de Francisco Noguerol ou de Catalina de Erauso, examinées au fil de plusieurs chapitres. Sans jamais faire acte d’obédience à une chapelle historiographique, l’étude enrichit deux domaines connexes. L’histoire atlantique, d’une part, façonnée par des circulations volontaires et forcées, la déportation d’esclaves depuis le golfe de Guinée vers les colonies ibériques étant concomitante et inséparable des déplacements analysés par Hugon. L’histoire des mobilités, d’autre part, l’ouvrage récusant le tableau obsolète d’une Espagne immobile et à l’horizon borné, comparée aux puissances de l’Europe septentrionale.
Cette grande migration doit en effet s’entendre comme un défi spatial. S’installer à plusieurs milliers de kilomètres de sa communauté d’origine – 11 000 km séparent Madrid de Santiago du Chili – était un pari incertain. Dans l’esprit des migrants, le « labyrinthe administratif » qui les attendait, le coût des papiers et de la traversée, l’inconfort des navires, les risques de tout perdre et les sacrifices familiaux, étaient compensés par des représentations campant les Indes en pays de Cocagne. Les promesses de « cette terre où l’on ne regrette pas l’Espagne », comme l’écrivait un émigré à sa sœur, cultivaient les espoirs des émigrés et de leurs familles dépendantes des transferts de fonds. Pourtant, les gains n’étaient pas garantis et il arrivait souvent que l’argent se volatilisât sur le chemin du retour, extorqué par des corsaires ou des intermédiaires malhonnêtes. La figure de l’indiano, affichant triomphalement sa réussite à son retour en Espagne, éclipsait les rentrées piteuses ou en catimini.
L’Amérique aimantait donc des individus au sort peu enviable mais disposant d’un pécule suffisant pour s’offrir le billet. Leur profil type dévoile une majorité d’hommes jeunes, non bridés par un statut marital – même si certains fuyaient une épouse non désirée qui n’hésitait pas à mobiliser la justice pour ramener au bercail le mari défaillant. En théorie, le célibataire était persona non grata aux Indes. Néanmoins, la plupart des migrants arrivaient seuls et élaboraient des stratégies matrimoniales transatlantiques pour combler le déficit de femmes sur place. Pour les couples désunis par les mers, les destinées conjugales étaient diverses : oubli, abandon, réunion heureuse, séparation. Malgré leur circulation aléatoire, les lettres étaient l’instrument indispensable pour combler l’absence, confier sa tristesse et administrer la vie familiale et les patrimoines. Avec délicatesse, Alain Hugon retranscrit la gamme d’émotions que produisait l’éloignement.
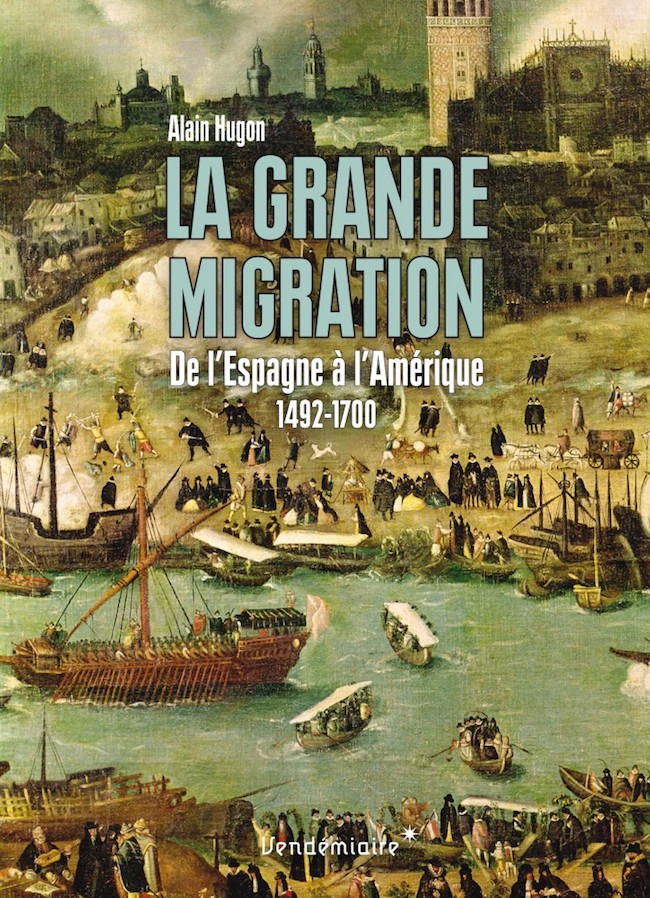
Ces pratiques ressemblaient à celles des familles dispersées dans la péninsule, traversée d’incessants flux migratoires. De ce fait, il importe de ne pas exagérer la singularité de l’Amérique dans son rapport à l’Espagne et de soumettre le concept de distance à une critique systématique. La distance parcourue – réelle et perçue – pouvait sembler plus grande à un Galicien des montagnes recruté comme domestique dans une maison aristocratique de Séville qu’à un juge de Valladolid dépêché quelques années dans un tribunal américain. À ce titre, si l’élasticité donnée à la notion d’émigré a l’avantage de souligner la pluralité des conditions des passagers, elle pose aussi problème. Quoi de commun entre le vice-roi, l’officier, le juge visiteur ou le clerc envoyés outre-Atlantique pour une mission temporaire et le paysan d’Estrémadure ou d’Andalousie misant toute sa fortune pour y construire une nouvelle vie ? Amalgamer ces trajectoires tend parfois à obscurcir les logiques migratoires à l’œuvre. Il reste que, dans tous les cas, les départs étaient étroitement encadrés et surveillés.
Tout au long de la période, la politique migratoire de la Couronne d’Espagne s’adossa à des normes contraignantes rassemblées dans une Compilation des lois des Indes. La rigidité de l’arsenal législatif était en réalité atténuée par les hésitations des monarques que l’on peut résumer sous la forme de trois paradoxes. D’abord, la volonté de peupler les Indes se heurta dès la seconde moitié du XVIe siècle à la crainte de voir l’Espagne se vider de ses forces vives et s’appauvrir dans un contexte de crise. Ensuite, les interdictions qui frappaient célibataires, époux s’absentant sans le consentement des conjoints, étrangers, descendants de juifs ou de musulmans, se trouvaient contournées. Il était aisé de gagner les Indes clandestinement ou d’obtenir un blanc-seing en échange de pots-de-vin versés aux employés de la Casa de Contratación.
Toutes ces dispositions visaient à sanctuariser les colonies et à les préserver des populations jugées indésirables – des certificats de pureté de sang étaient requis pour écarter les nouveaux chrétiens et les hérétiques. Il s’agissait de promouvoir l’ordre moral en privilégiant une émigration familiale, en facilitant l’installation de Frères prêcheurs et d’inquisiteurs veillant à ne pas introduire en Amérique les livres mis à l’index. L’effort déployé par ces autorités était fragilisé par la réputation des sociétés coloniales en Europe. Dans le Nouveau Monde pullulaient les « polissons », ces passagers qui s’y infiltraient illégalement, pareils aux gouttes de pluie (aussi appelés llovidos, du verbe llover, pleuvoir), pour échapper à la justice et corrompre les bonnes mœurs. Comme le conclut Hugon, ces craintes – fantasmées ou réelles ? – expliquent la constance avec laquelle la Couronne d’Espagne fit peser les mesures répressives sur les candidats au départ plutôt que sur les immigrés à l’arrivée.
À notre époque où l’Europe a fait de la Méditerranée l’une des frontières les plus meurtrières au monde, on perçoit au fil de cette lecture des échos contemporains. Alors que les laissés-pour-compte du Siècle d’or s’efforçaient de quitter la péninsule, depuis l’Afrique les migrants actuels rêvent d’y trouver refuge. Entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui, l’extrême disjonction des situations interdit toute comparaison simpliste et inappropriée. Il reste qu’entre ces deux périodes les côtes andalouses et les mers ont constitué pour les plus malchanceux un cimetière des espérances. C’est l’un des mérites du livre d’Alain Hugon que de suggérer les contrepoints souvent tragiques de ces grandes migrations.












![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)