L’actuel président des États-Unis diffère de son prédécesseur du début des années 2000 en ce que celui-ci était entouré de conseillers de haute tenue intellectuelle. Une bonne partie d’entre eux se disaient inspirés par la philosophie politique de Leo Strauss : un retour aux classiques grecs contre l’historicisme moderne. Ces débats politiques paraissent bien loin et ceux qui, comme Adrien Louis, s’intéressent à Leo Strauss le font désormais en termes purement universitaires.
Adrien Louis, Leo Strauss, philosophe politique. CNRS, 352 p., 25 €
On ne peut feindre d’étudier la pensée de qui s’est défini comme « philosophe politique » en faisant abstraction de ses implications directement politiques. L’ambiguïté de la position politique de Leo Strauss va de pair avec celle du mot « libéral », entre les États-Unis et la France. Quand il parle de « démocratie libérale », devons-nous vraiment traduire par « conservateur » ? Ce n’était pas si clair il y a vingt ans. Du côté des Fukuyama, Wolfowitz, Kristol, Kagan ou Podhoretz, beaucoup des intellectuels proches du président Bush II tenaient à faire savoir qu’ils venaient de la gauche et, quand on les disait « néoconservateurs (neocon en américain), le préfixe « néo » n’était pas quantité négligeable. Dans son livre publié pour le vingtième anniversaire de 1968, Guy Debord aussi s’était référé à Thucydide, tandis que Castoriadis et Foucault manifestaient leur intérêt pour une « relecture » des Anciens.
Quand Leo Strauss défend le classicisme antique contre l’historicisme moderne, l’enjeu est donc plus complexe qu’il n’y paraît à première vue : ce n’est pas une nouvelle mouture de la vieille querelle des Anciens et des Modernes. Leo Strauss ne prétend pas qu’un penseur moderne comme Hobbes serait condamné par le siècle où il vécut à ne pas saisir les enjeux de la philosophie politique. L’auteur du Léviathan s’attacherait d’ailleurs moins à « critiquer les normes traditionnelles, et en particulier les normes aristotéliciennes », qu’à « chercher une méthode d’application de ces normes ».
Se référer aux classiques, plus d’ailleurs Xénophon ou Thucydide que Platon, c’est considérer que la politique est rationnelle, en ceci du moins que les débats qu’elle suscite sont, mutatis mutandis, éternels. C’est retrouver l’état d’esprit de Thucydide déclarant en préface à son Histoire de la guerre du Péloponnèse qu’il espère avoir, avec ce livre, dégagé un « acquis pour toujours ». De ce point de vue, la position de Machiavel n’est pas radicalement différente : les enseignements du Prince sont, eux aussi, un acquis pour toujours. Certes, les exemples que prend le Florentin sont directement inspirés par les réflexions que lui inspirent les guerres d’Italie et il conclut sur un appel à l’unité des Italiens. Mais César Borgia n’est pas seulement le personnage historique qu’il a connu, c’est aussi une figure comme il peut s’en rencontrer à toute époque, tout comme celle du traître Alcibiade.
Cet aspect du débat a été obscurci par le surgissement du thème de « l’état de nature ». La tonalité rousseauiste qu’il a prise a masqué sa signification première, qui ne se distinguait pas de celle de la rationalité. C’est dans l’état qui ne serait pas « de nature » que la rationalité ne parviendrait qu’imparfaitement à s’appliquer. On est là devant une tout autre distinction que celle, banale chez les Anciens, entre la nature et la convention, car joue ici l’historicité. Quand les Anciens opposent la nature et la convention, ils tracent une limite entre deux domaines. Leurs débats portent sur le lieu précis où cette limite doit être tracée. Dans la conception moderne de l’état de nature, celui-ci est irrémédiablement perdu dans la réalité politique actuelle. L’Histoire a eu lieu. La question devient alors de savoir si le mouvement de l’Histoire change quelque chose d’essentiel à la compréhension du politique. Leo Strauss appelle « historicisme » le fait de le penser et il s’y oppose pour des motifs à la fois philosophiques et politiques, lesquels se conjuguent à ses yeux dans la notion de relativisme.
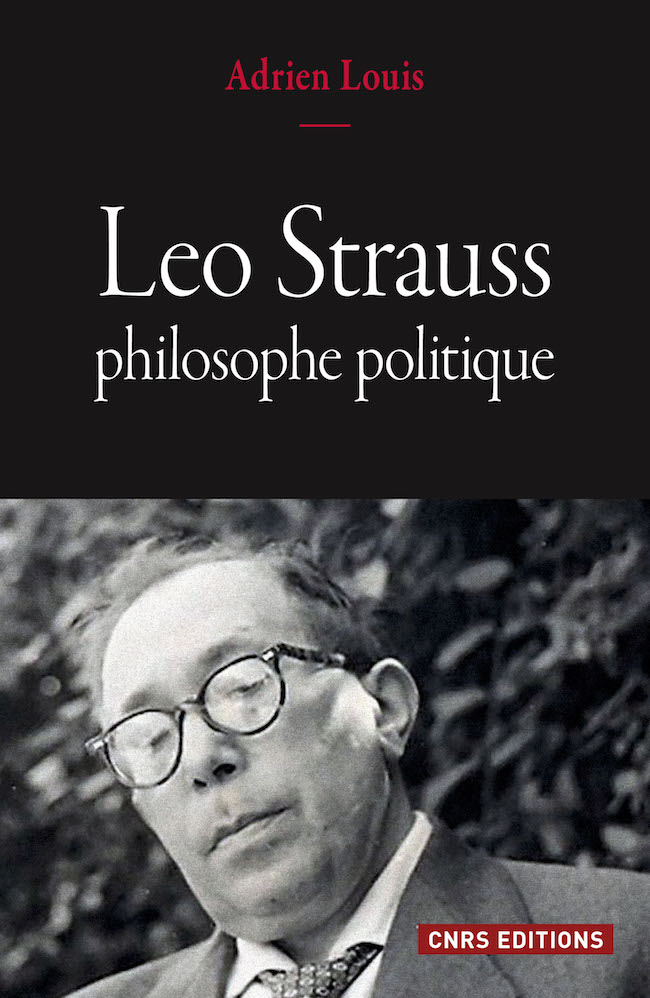
Le fait est que le propre d’une conception historiciste est de considérer que les vérités (du moins dans le domaine considéré) sont relatives à l’époque. Un exemple évident serait la théorie aristotélicienne de l’esclavage, présenté, dans le premier chapitre de la Politique, comme une donnée de nature. Face à cela, l’historiciste a beau jeu d’avancer qu’une telle analyse est évidemment marquée par son époque et ne peut plus être tenue pour vraie. Ce à quoi une réponse pourrait être que l’exemple est un peu trop commode : en tirer argument pour réfuter toute la théorie politique aristotélicienne n’aurait guère plus de sens que de rejeter le cartésianisme parce que l’auteur des Méditations métaphysiques niait la circulation du sang et la notion même de vitesse (finie) de la lumière, ce fort peu de temps avant que l’une et l’autre ne soient démontrées.
Le rationaliste est fondé à juger peu probante, quoique incontestable, l’existence de points à propos desquels il est légitime de mettre en avant la relativité historique. Il peut en effet lui opposer une cohérence d’ensemble de la pensée, bien plus importante intellectuellement que ces aspects mineurs marqués par leur époque. De son côté, l’historiciste insistera au contraire sur l’importance manifeste de ces points, qu’il refusera de considérer comme mineurs. Autant dire qu’il n’y a pas moyen de trancher de façon claire et définitive ce débat philosophique.
C’est que l’enjeu véritable est directement politique. Leo Strauss refuse l’historicisme parce que celui-ci lui paraît intrinsèquement lié au progressisme politique, à la gauche donc. Et même, plus largement, à une modernité intellectuelle dans laquelle il englobe aussi bien le Nietzsche de la deuxième Considération inactuelle que Freud. Même s’il rechigne à se définir comme conservateur, il est résolument hostile à ce que représente le progressisme. En conséquence, il choisit les classiques, c’est-à-dire une politique sub specie aeternitatis.
Que ce choix soit fondé sur une vision injuste, voire caricaturale, de l’historicisme, c’est difficilement contestable. La conception hégélienne de « la raison dans l’Histoire » n’est pas exactement un relativisme, et il n’est même pas assuré que la qualification s’applique à Marx. Adrien Louis remarque à juste titre que c’est avant Hegel que le peu suspect de socialisme Benjamin Constant a caractérisé le mouvement historique par l’irréversibilité de ce qui a eu lieu. On peut aussi mettre en avant l’Incarnation, ce moment historique délimitant de façon absolue un avant et un après la venue de Dieu sur terre, l’entrée de l’Éternel dans la temporalité. Parler d’historicisme et assimiler celui-ci à une pensée « progressiste », c’est faire bon marché de cette rupture sur la base de laquelle le christianisme a fondé la pensée de l’Histoire. On peut aussi reprendre les arguments que Kojève opposait à Leo Strauss au début des années 1950 à propos de la tyrannie. Mais enfin Strauss a bien le droit de faire le choix qui est le sien et qui n’a rien d’absurde.
Ce choix suscite néanmoins quelques difficultés sur lesquelles Adrien Louis attire à juste titre l’attention. La principale, qui fait l’enjeu même de son livre, est d’analyser ce « singulier paradoxe », ce « déroutant hiatus » : le désintérêt de ce « philosophe politique » pour les problèmes politiques de son époque. Cet ancien disciple de Heidegger qui a quitté l’Allemagne à l’avènement du nazisme n’a évidemment aucune sympathie pour une telle tyrannie, non plus que pour celle que subissaient les Soviétiques. Mais point n’est besoin d’une grande culture ni d’une profonde réflexion philosophique pour formuler de tels jugements, auxquels il se borne s’agissant de la politique réelle de son temps.
Reste à savoir ce que vaut une telle objection. Le paradoxe dénoncé peut être tenu pour un affleurement de la contradiction entre l’ordre de la rationalité et celui du politique. Dans ce cadre, Strauss choisit l’exigence de rationalité, quitte à délaisser l’actualité politique. À considérer les choses ainsi, c’est le projet même d’une « philosophie politique » qui devrait être mis en cause : le champ de la philosophie et celui de la politique gagneraient à être disjoints. À se vouloir politique, une philosophie perdrait en rigueur sans gagner en efficacité, tandis qu’une pensée politique digne de ce nom ne pourrait prétendre à la philosophie que dans un sens très atténué de ce mot.












