Les textes sacrés aussi ont une genèse, et François Déroche, professeur au Collège de France, reconstitue dans Le Coran, une histoire plurielle. Essai sur la formation du texte coranique les étapes de la « canonisation » du « texte coranique », à partir de l’étude minutieuse d’anciens manuscrits, datant des tout premiers temps de l’islam, et jusqu’ici négligés. Philippe Cardinal, dans un très ample article, détaille les volets de cette enquête passionnante sur l’écriture du Coran, dont les enjeux sont essentiels.
François Déroche, Le Coran, une histoire plurielle. Essai sur la formation du texte coranique. Seuil, coll. « Les livres du nouveau monde », 304 p., 23 €
Ainsi qu’il le rapporte dans l’avant-propos de son ouvrage, c’est alors qu’il occupe son premier poste, au sein du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, dans le courant des années 1970, que François Déroche découvre, « de manière fortuite » assure-t-il, les manuscrits du Coran qui y sont conservés. La fréquentation de ces documents incite assez vite le jeune agrégé de lettres classiques, frais émoulu de l’École normale supérieure, à s’intéresser au « processus de formation du corpus coranique ».
François Déroche est frappé, d’abord, par la très grande ancienneté de quelques-uns de ces manuscrits, « témoins écrits d’un état du texte coranique remontant aux premières décennies de l’islam », et surpris, ensuite, que ceux-ci ne soient pas étudiés – leur dimension strictement paléographique exceptée – dans la perspective d’une meilleure connaissance des processus ayant conduit à l’établissement du Livre sacré de tous les musulmans.
C’est peu de dire que le sujet qui intéresse François Déroche à l’aube de sa carrière universitaire – celui de « l’histoire de la mise par écrit du Coran » – ne préoccupe guère la communauté des orientalistes et des arabisants dont il deviendra plus tard l’un des représentants les plus éminents, titulaire au Collège de France d’une chaire d’Histoire du Coran, taillée à la mesure de son parcours de chercheur. « Alors que je faisais mes premiers pas dans ce domaine, écrit-il, des islamologues confirmés s’efforcèrent de me dissuader de m’aventurer dans ce qui leur paraissait être une voie sans issue ».
De fait, du point de vue de l’islamologie – telle qu’on la pratique en Occident –, il était couramment admis que cette question de la genèse du texte coranique avait été pleinement traitée par les travaux de l’immense savant qu’avait été l’Allemand Theodor Nöldeke (1836-1930) – et ceux de ses disciples –, portant notamment sur la chronologie du Coran. Dans la lignée de ces travaux s’étaient par la suite inscrites les pénétrantes analyses de l’un des meilleurs spécialistes français en la matière, Régis Blachère (1900-1973), auteur d’une Introduction au Coran (1951), et d’une traduction « critique » du Livre sacré, laquelle fait montre d’un scrupule philologique avéré. Rien ne semblait pouvoir être ajouté aux conclusions de ces maîtres…
Du point de vue des sciences traditionnelles islamiques, les choses étaient encore plus claires, dans la mesure où tout questionnement relatif à la généalogie du texte coranique ne pouvait que se heurter au dogme de son origine divine : dans le Coran, c’est Dieu qui parle, la révélation étant transmise à Muhammad par l’intermédiaire de l’ange Gabriel. Il est énoncé à différentes reprises, dans le Coran même, que les révélations reçues par Muhammad émanent de Dieu lui-même, qui les a fixées sur une Table sacrée constituant l’archétype céleste du Livre. Au regard de la tradition musulmane, « le surgissement premier du message coranique n’a rien d’humain ni d’historique. C’est avant tout un événement miraculeux, une grâce ou un « don » de Dieu qui a choisi Muhammad pour en être l’unique récepteur », écrit l’anthropologue marocain Mohamed Sghir Janjar, dans un article intitulé « Que savons-nous du processus historique de formation du Coran ? », paru en 2016, dans la revue Évangile & liberté. Et cet auteur d’ajouter : « la tradition islamique n’accorde au Prophète que le rôle passif de transmetteur de paroles divines incréées », cela « contrairement aux traditions juive ou chrétienne qui, tout en reconnaissant le caractère « inspiré » des Écritures, accordent aux hommes la responsabilité de la formulation des significations divines dans le langage de leur temps ».
Une démarche « historico-critique »
On comprend, dès lors, à quel point peut être sensible l’approche de François Déroche : « L’essentiel de mon propos », écrit-il, « porte sur la façon dont le message de Muhammad a été reçu dans les débuts de l’islam, sur la place qui était alors laissée à la variation ». Ce terme de « variation » recouvre, pour François Déroche, l’ensemble des divergences rencontrées dans les manuscrits et comprend « les variantes qui, elles, concernent strictement le texte ». L’idée même de variation, de variante, est insupportable à l’orthodoxie musulmane qui, dès l’origine, s’est employée à les circonscrire au maximum, n’admettant pour telles, bien évidemment, qu’un certain nombre de versets dits « abrogeants » et « abrogés », lesquels, conformément à la volonté même du Prophète, se substituent les uns aux autres, suivant en cela un protocole bien défini. Ces versets ont donné lieu à une abondante littérature spécifique, plusieurs d’entre eux revêtant une particulière importance du point de vue de la doctrine, tels ceux qui régissent la consommation du vin ou le châtiment de l’adultère.
« Historico-critique », la démarche de François Déroche est de celles que les institutions islamiques de recherche et d’enseignement ont de tout temps ignorées, rejetées. Aux yeux du courant dominant de la pensée islamique contemporaine, un tel type d’approche participe tout simplement d’« une construction idéologique érigée par des orientalistes occidentaux malveillants », ainsi que le regrette Mohamed Sghir Janjar, pour lequel « la formation du Coran est, sans doute, le meilleur indicateur pour mesurer le fossé séparant ces deux univers intellectuels ».
On rappellera brièvement que le Prophète de l’islam appartenait à la tribu mecquoise de quraysh dans le dialecte de laquelle il s’exprimait. La prédication de Muhammad s’est étendue sur une durée de vingt-deux années (610-632), d’abord à La Mecque jusqu’à l’Hégire (622), puis à Médine, jusqu’à sa mort (632). Les exégètes du Coran ont ensuite classé les sourates selon qu’elles appartiennent à l’époque mecquoise (elle-même subdivisée en trois périodes) ou à l’époque médinoise. Même si l’ineffable grandeur du Livre – que la tradition islamique a érigée en un autre dogme, celui de l’inimitabilité du Coran – peut être sensible à chaque page du texte, ce sont souvent les sourates de la première période mecquoise qui, par leur puissance incantatoire, leur tension intérieure, leur rythme haletant et leur tour hallucinatoire, viennent à fasciner le lecteur non musulman quand il les découvre.
Une transmission orale
Pendant ces vingt-deux ans, tant à La Mecque qu’à Médine, le message coranique a consisté, avant toute chose, en une transmission orale, dont le premier mode de préservation a été, à l’évidence, la mémoire humaine. Avec ce message, était apparue une nouvelle catégorie d’hommes, les « récitateurs » (en arabe, qurrâ’), qui en mémorisaient certaines parties ou bien la totalité, au fur et à mesure de sa révélation. Après examen des sources médiévales et, particulièrement, des chaines de transmission (isnâd) remontant toutes à Muhammad, il s’avère que le nombre de ces hommes « était en fait assez réduit », puisque, au moment de la mort du Prophète,« seuls trente-huit Compagnons [contemporains du Prophète ayant vécu dans son entourage] avaient mémorisé de manière partielle ou complète le texte du Coran », écrit François Déroche. Quelques-uns d’entre eux sont à l’origine des différents modes d’énonciation du texte, tels qu’ils sont encore pratiqués aujourd’hui, de ces différentes « lectures » (qirâ’ât), lesquelles ne concernent, il faut y insister à cause de l’ambiguïté de ce dernier terme, que la récitation, autrement dit la reproduction orale du texte. La tradition a fini par admettre quatorze de ces « lectures » dont les divergences ne portent jamais sur le fond du texte, mais seulement sur sa prononciation, sur l’articulation de certains phonèmes, sur les pauses qu’il convient de ménager entre les phrases ou les versets, etc. Ainsi, certaines de ces différences dans l’énonciation du texte font entendre jusqu’à nos jours des dialectalismes remontant à l’époque de ces contemporains du Prophète.
Passage à l’écrit
Il semble bien que ce soit sous le califat d’Abu Bakr (632-634), premier calife et successeur immédiat de Muhammad, qu’ait commencé à se faire sentir la nécessité de consigner par écrit l’ensemble du message coranique. La mort au combat, lors d’une même bataille, celle d’Aqrabâ (633), de plusieurs Compagnons parmi ceux qui savaient le Coran par cœur fait craindre à l’un des plus illustres d’entre eux, Umar ibn al-Khattâb, que le texte ne vienne à disparaître.
Dès lors, un jeune Médinois, Zaïd ibn Thâbit, se voit chargé de la lourde tâche de mettre le Coran par écrit. Pour ce faire, Zaïd ibn Thâbit a recours, d’abord, à la mémoire de ses contemporains, mais aussi à des fragments écrits, lesquels avaient été recopiés, du vivant de Muhammad et dès la fin de l’époque mecquoise, sur des supports hétéroclites (tessons, pierres plates, pétioles de palme, omoplates de chameaux…), par le petit nombre de ceux qu’on appelait les « scribes » ou « copistes » du Prophète – dont Zaïd ibn Thâbit avait lui-même fait partie et dont la tradition a conservé les noms. Cependant, si des recueils avaient ainsi pu être constitués avant la mort du Prophète, ils n’étaient de toute évidence que très partiels.
L’entreprise que mène Zaïd ibn Thâbit témoigne aussi, il convient de le noter, de la place que commence à prendre l’écriture, dès les premières années de l’Hégire, dans le contexte d’un État islamique naissant. C’est au calife Umar ibn al-Khattâb (634-644) – lequel a succédé entretemps à Abu Bakr – que Zaïd peut remettre les « feuilles » (suhuf) constituant la première recension complète du texte coranique. Dans les années qui suivent, semble-t-il, d’autres Compagnons effectuent de semblables compilations pour leur usage personnel.
Quelques années plus tard, sous le califat d’Uthmân ibn Affân (644-656), troisième successeur de Muhammad, alors que le jeune État est en pleine expansion, ce besoin de disposer d’une version écrite fiable paraît devenir plus nécessaire encore. En pleine campagne d’Arménie (vers 645), le commandant en chef des armées constate, en effet, que des divergences sont apparues parmi les combattants sur la façon de réciter le Coran lors des prières en commun. Il est vrai que la troupe commence à compter dans ses rangs de nombreux non-arabophones, convertis de fraîche date. Alarmé, le commandant en chef va trouver le calife, ainsi que le rapporte la tradition, et l’exhorte à prendre des mesures pour éviter que le Livre ne devienne l’objet de désaccords parmi les musulmans, à l’instar de ce que connaissent les communautés juive et chrétienne.
Uthmân va d’abord faire ce que font les chefs d’État quand se pose à eux une question d’intérêt public, c’est-à-dire former une commission. Loin d’enterrer le sujet, celle-ci, composée d’hommes choisis pour leur sagesse et leurs compétences, tous Mecquois, va être à l’origine du Coran, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les membres de la commission, à la tête de laquelle Uthmân a naturellement et judicieusement placé Zaïd ibn Thâbit, repartent de la compilation que celui-ci a naguère établie et la comparent, verset après verset, à celles qui ont commencé de circuler par ailleurs.
Constitution d’une « vulgate uthmanienne »
Cette entreprise de recension du texte coranique aboutit à la constitution de ce qu’il est convenu d’appeler la « vulgate uthmanienne », c’est-à-dire à un texte dont on peut dire qu’il s’est imposé à la tradition musulmane autant qu’il a été imposé par elle. Dès lors, la position intangible de l’orthodoxie musulmane consistera en cela que le Coran uthmanien contient les paroles non falsifiées de Dieu, ce credo constituant « l’affirmation d’une authenticité absolue qui repose sur l’absence de variation par rapport au message originel », ainsi que l’écrit François Déroche.
Selon la tradition islamique, le calife Uthmân est celui « qui permit à la jeune communauté des croyants de disposer très tôt d’un texte de référence jouissant d’un statut officiel », écrit encore l’historien. Quelque quinze ans après la mort du Prophète, autour de l’an 25 de l’Hégire (647 de l’ère commune), Uthmân ordonne que soient réalisées plusieurs copies de cette recension et qu’elles soient envoyées dans plusieurs provinces de « l’empire » naissant. Dans le même temps, Uthmân donne également l’ordre que soient détruites toutes les copies du Coran réalisées antérieurement.
En cette époque de pleine expansion, où les armées de l’islam ont déjà soumis l’Égypte et lancent des raids en Ifriquiyya, où elles ont conquis la Syrie et l’Iraq et menacent Byzance, où elles se sont emparées des territoires de la Perse sassanide et poursuivent leur marche vers l’Est, « disposer d’un recueil des révélations devenait un enjeu de premier ordre », écrit François Déroche. Un enjeu qui pouvait constituer aussi une tentative pour mettre au pas certains Compagnons du Prophète parmi les plus turbulents, enclins à mettre leur proximité avec le message coranique au service d’ambitions politiques, et souvent en conflit avec le pouvoir. Toutefois, « la tradition musulmane conserve le souvenir d’un certain nombre de recensions rivales, en plus de celle qui, soutenue par le pouvoir, allait devenir le texte canonique », poursuit François Déroche.
Des recensions rivales
Au nombre de ces recensions rivales, peut notamment être citée celle d’Ubayy ibn Ka’b, dont il semblerait qu’elle ait compté 116 sourates au lieu des 114 admises dans la vulgate, sans que l’on sache exactement aujourd’hui à quoi ces deux sourates supplémentaires pouvaient correspondre. Ou encore celle d’Ibn Mas’ûd, qui en comptait 111, puisqu’elle n’admettait ni la première sourate du texte canonique (la Fatiha), ni les deux dernières. D’autres différences semblent avoir affecté l’ordonnancement des sourates et, plus strictement aussi, le texte. La tradition a également conservé le souvenir moins prégnant d’autres recensions, comme celle d’Abû Mûsâ Al-Ash’arî ; et des sources chiites font pour leur part état d’une hypothétique recension due à Alî ibn Abî Tâlib, gendre et cousin du Prophète, laquelle aurait compris plusieurs passages faisant mention des droits d’Alî à la succession de Muhammad.
« L’initiative qui fut prise rapidement de soutenir à des fins de canonisation un texte précis constituait un pas décisif », note François Déroche. Elle permettait que soit promue « une version unique du Coran dont l’orthodoxie assure qu’elle est celle-là même qui fut révélée à Muhammad ». Les versions concurrentes dont il vient d’être question n’en disparaissent pas pour autant. En tout cas, pas immédiatement, puisqu’il apparaît que plusieurs d’entre elles, à commencer par celle d’Ibn Mas’ûd, ont continué à se répandre dans certains cercles, ou certaines parties du monde musulman. Il est ainsi fait état de diverses circonstances dans lesquelles des mesures ont dû être prises, sous le califat abbasside, pour interdire la vente, la copie et l’usage de la recension d’Ibn Mas’ûd. Au début du Xe siècle, le lexicographe Ibn Shanabudh reçoit une bastonnade pour avoir utilisé, lors de la prière, cette version du texte coranique. Pour sa part, l’encyclopédiste Ibn Nadim mentionne le fait qu’il en a lui-même consulté, à la fin du Xe siècle, différents exemplaires. Et la tradition de rapporter encore qu’une copie de la recension d’Ibn Mas’ûd fut très officiellement brûlée sur ordre des autorités, au début du XIe siècle.
Autant que faire se pourra, la tradition s’emploiera à minimiser l’importance de ces recensions concurrentes dont on ne dispose plus aujourd’hui des versions intégrales. Elles ne subsistent plus que sous la forme de citations, de groupes de mots ou de versets, dans les traités de grammairiens, d’historiens ou d’exégètes du Coran.
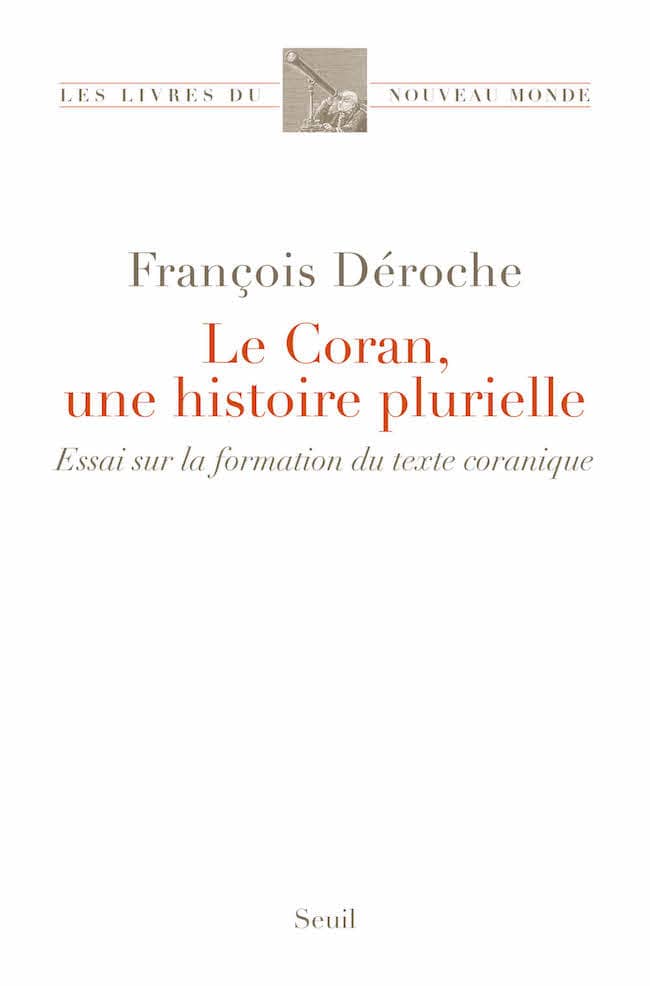
La tradition arabo-islamique
Mais quelle est cette tradition arabo-islamique à laquelle on s’est maintes fois référé dans le courant des lignes qui précèdent ? Ce terme constitue une appellation commode pour un ensemble colossal d’ouvrages qui comprend les exégèses et les commentaires du Coran, les recueils de hadiths, les biographies du Prophète, les généalogies tribales, les récits de conquêtes et les traités d’histoire, les manuels de droit et de jurisprudence, les grammaires et jusqu’aux recueils poétiques avec leurs commentaires. Cette production pléthorique a été le fruit d’« une pratique historiographique [qui] est apparue effectivement très tôt en islam et s’est poursuivie sans interruption jusqu’à l’avènement des nouveaux modes d’écriture historique inventés par la modernité », écrit Mohamed Sghir Janjar.
Pour le philosophe marocain Abdou Filali-Ansary, ce « trop-plein » de récits historiographiques a eu pour conséquence de persuader des générations entières de musulmans « que le “nécessaire a été fait” et que le travail d’évaluation et de filtrage requis a été accompli dans les meilleures conditions [et que] nous disposons ainsi d’une version authentique, indiscutable, des faits et des textes qui comptent ». Dans un tel contexte, poursuit Mohamed Sghir Janjar, « la grande majorité des musulmans contemporains paraît […] prise au piège de la non-distinction entre les faits historiques et le récit qu’en donne la tradition ».
Toutes les études relatives à l’histoire de l’établissement du texte coranique, qu’elles aient émané de la science islamique ou de l’orientalisme – et ce bien que leurs approches respectives fussent foncièrement différentes –, se sont ainsi fondées sur les disciplines traditionnelles (exégèse et commentaire, étude des hadiths, de la sîra (vie du Prophète), de la grammaire, de la rhétorique, etc.) qui ont, au cours des siècles, connu une inflation prodigieuse. Quand il s’est agi, au début du XXe siècle, pour les ulamâ’ de la mosquée d’Al-Azhar, de mettre au point et d’imprimer une édition du Coran qui pût être utilisée universellement, ils ont « exclusivement fait appel à des traités relatifs aux différents aspects du Coran, en aucun cas aux manuscrits des débuts de l’islam », remarque François Déroche. Cette version du texte – qui comprend dûment 114 sourates et 6 236 versets –, publiée en 1923 au Caire, tient lieu de vulgate. Conforme à la recension uthmanienne, elle s’est très largement imposée dans le monde musulman, « réussissant en définitive à réaliser presque complètement le dessein qui, selon la tradition, avait déterminé la décision du calife Uthmân », écrit encore le professeur au Collège de France.
Des manuscrits anciens
De manière plus inattendue, cette même révérence à l’égard des savoirs islamiques classiques est à l’œuvre dans les travaux de recherche menés par les orientalistes sur la genèse du Coran. Dans Le Coran, une histoire plurielle, François Déroche a, pour sa part, « tenté d’aller plus loin en confrontant ce que nous disent les auteurs musulmans médiévaux aux nombreux manuscrits anciens du Coran qui ont été conservés ». Force est de constater – de façon très étonnante, là encore – que « la transmission manuscrite du Coran n’a pas été explorée avant une date relativement récente », ainsi qu’en atteste l’historien.
« Jusque récemment, note-t-il également, l’idée qu’aucun manuscrit arabe n’était antérieur au IXe siècle était défendue ». Par conséquent, les chercheurs estimaient que les « enregistrements écrits du Coran des premiers temps de l’islam n’avaient pas été conservés, ou encore, s’ils avaient connaissance de manuscrits attribuables à cette période, que les données qu’ils pouvaient contenir ne présentaient qu’une utilité limitée pour des recherches », constate-t-il encore. En d’autres termes, lorsque de tels fragments de manuscrits existaient, ils pouvaient être conservés avec le statut de reliques, ou encore faire l’objet de commerce de la part de bibliophiles ou d’amateurs, tant musulmans qu’européens, mais n’intéressaient en aucun cas la science !
« Sous la lumière de l’histoire »
Alors que l’orientalisme était très généralement convaincu que les manuscrits ne pouvaient rien apporter de substantiel à l’histoire du Coran, François Déroche était enclin à penser, d’une part, que de tels documents, contemporains des premières décennies de l’islam, existaient bel et bien, et, d’autre part, qu’ils étaient susceptibles d’éclairer la genèse du texte coranique d’un jour nouveau. Cette intuition, fort peu partagée au demeurant, pouvait assez légitimement apparaître comme une conséquence du fait que la geste muhammadienne et la religion islamique sont objectivement nées « sous la lumière de l’histoire », selon la formule efficace du grand historien marocain Abdallah Laroui, et cela « à la différence des deux plus anciennes formes de monothéisme (judaïsme et christianisme), dont les souvenirs des débuts [sont] enfouis sous des strates de récits mythiques », ainsi que l’écrit l’anthropologue Mohamed Sghir Janjar. Si les jours du Prophète ont pu être si bien décrits, si la plupart de ses Compagnons, comme des membres de son entourage, et bon nombre de ses contemporains, tant à La Mecque qu’à Médine, nous sont parfaitement connus, non seulement par leurs noms, mais encore, le plus souvent, par maints détails de leurs vies, c’est grâce à cette relative proximité temporelle.
Bien persuadé que cette proximité devait avoir favorisé la conservation de certains Corans parmi les plus anciens – ce que confirmeraient les plus récentes techniques de datation physico-chimiques ou au carbone 14 –, François Déroche s’est d’abord employé à identifier de tels manuscrits, comme le codex Parisino-Petropolitanus, ainsi nommé pour la raison que ses feuillets (feuilles de parchemin, en l’occurrence) sont principalement répartis entre les bibliothèques publiques de Paris et de Saint-Pétersbourg, certains d’entre eux figurant toutefois dans la Bibliothèque vaticane ou encore dans la Collection d’art islamique de Nasser D. Khalili, à Londres. Ces feuillets, au nombre de 98 – sur lesquels figurent près de la moitié du texte coranique –, ont pu être datés du troisième quart du VIIe siècle, c’est-à-dire qu’ils sont postérieurs d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années seulement au décès de Muhammad.
L’écriture utilisée dans le Codex Parisino-Petropolitanus, comme dans tous les manuscrits arabes de cette époque, dite « hijazi(e) » (du Hedjaz), est particulièrement rudimentaire et défective. La langue arabe comprend vingt-huit consonnes ; or, l’écriture n’en note que quinze (à l’intérieur d’un mot) ou dix-huit (en position finale), si bien que le nombre des consonnes « homographes » est absolument considérable. Des points « diacritiques », placés au-dessus ou au-dessous de ces lettres, permettent de les distinguer. Cependant, l’écriture hijazie se trouve dépourvue de ces points diacritiques, dont l’usage ne se répandra que plus tard. Elle est également dépourvue des symboles permettant de noter les voyelles brèves, comme aussi de tout l’ensemble des signes (dits « orthoépiques ») qui rendent possible l’énonciation d’un texte écrit, et qui apparaîtront plus tard encore. Si bien que le texte d’un Coran copié au moyen de cette écriture se trouve en quelque sorte constitué du seul tracé d’un trait discontinu – dépourvu, on l’a dit, de tous les points, signes et symboles qui viendront par la suite enrichir l’écriture arabe –, formant successivement des lettres, lesquelles n’existent qu’en tout petit nombre (la même forme pouvant être utilisée pour noter jusqu’à cinq consonnes différentes !).
Le dessin « uthmanien »
C’est ce trait, ce script, ce dessin (en arabe, rasm), ce ductus consonantique, et celui-là seulement, qui constitue un texte en écriture hijazie. Si bien que la recension du Coran telle qu’elle a pu être établie à la demande du calife Uthmân – copiée en écriture hijazie et tracée par un calame qui ne peut qu’ignorer les règles d’une calligraphie arabe qui n’existe pas encore – se trouve de facto réduite à son rasm, le rasm uthmanien, l’expression en étant venue à désigner ladite recension. De ce rasm, la tradition allait faire son critère unique et, pourrait-on dire, son étalon, pour toute question relative à la formulation écrite du message coranique. On notera que – pour oraux qu’ils soient – les quatorze modes d’énonciation du Coran admis par la tradition, dont il a été question précédemment, sont tous compatibles avec le rasm uthmanien.
Constitué d’un seul trait discontinu, un texte copié en écriture hijazie – imparfaite et ambivalente comme elle l’était – ne pouvait véritablement être lu qu’à la condition d’être déjà connu. De surcroît, « dans leur façon d’organiser l’écriture sur la ligne », les copistes de ces premiers Corans « reprennent le principe de la scriptio continua de l’Antiquité, en l’adaptant aux particularités de l’alphabet arabe », écrit François Déroche. Particulièrement complexes à déchiffrer, ces manuscrits posent des problèmes de lecture, recèlent de nombreuses ambiguïtés qui peuvent être à l’origine de ces variantes, honnies par la tradition.
De très nombreux exemples de telles ambivalences, de telles divergences, sont relevés par l’auteur, que l’amateur peut suivre dans ses explications, grâce à la vingtaine de fac-similés judicieusement disséminés dans l’ouvrage [1]. Le codex Parisino-Petropolitanus, selon Déroche, « s’insère dans la tradition du rasm uthmanien mais offre des divergences qui reflètent une étape sur le chemin de la canonisation ». Si ce codex avait déjà été l’objet de l’attention de l’historien dans le cadre d’une précédente publication, tel n’est pas le cas d’un autre manuscrit, connu sous l’appellation de palimpseste de Sanaa, lequel a fait partie d’un extraordinaire dépôt de manuscrits, retrouvé en 1973, entre le plafond et le toit de la grande mosquée de Sanaa (Yémen). Dans cette vaste cavité avaient été mis au rebut, pendant de très longs siècles, un nombre considérable de manuscrits coraniques et autres, que le passage du temps avait rendus inutilisables ou obsolètes, mais qui restaient l’objet d’assez de révérence pour qu’on voulût les préserver. Il aura fallu plusieurs décennies pour que cet ensemble soit inventorié, et pour que soient décryptés, interprétés et publiés les plus remarquables parmi ces documents, au nombre desquels figure le palimpseste en question.
Le palimpseste de Sanaa
Ce manuscrit est constitué d’une quarantaine de feuillets, de grand format, copiés sur parchemin, ayant appartenu à un Coran dont le texte a été par la suite gratté, pour laisser place à une nouvelle transcription, « conforme au texte devenu alors dominant », celui de la version uthmanienne ; cependant, la strate inférieure a pu, en grande partie, être restituée. L’ensemble ainsi rétabli comprend tout ou partie du texte de plusieurs dizaines de sourates, constituant une portion substantielle du message coranique. C’est sur cette couche inférieure – qui peut être datée du troisième tiers du VIIe siècle – que se penche François Déroche. Celle-ci, atteste-t-il, « confirme la circulation de versions du texte coranique dont la formulation ne coïncide pas avec la version uthmanienne ». Ce précieux document recèle « un nombre important de variantes qui n’étaient pas connues par les différentes sources médiévales », poursuit l’historien qui s’emploie ensuite à en dresser le catalogue, ces variantes pouvant résulter « de positions différentes en matière d’orthographe ou de délimitation de versets », de recours aux synonymes, d’une évidente licence dans l’emploi des épithètes divines redoublées en fin de verset, etc.
Cependant, malgré ces nombreuses différences – et celles encore concernant la séquence des sourates (laquelle pourrait, en définitive, n’avoir été stabilisée que plus tard) –, le texte, tel qu’il apparaît sur la couche inférieure du palimpseste, montre bien que le rasm uthmanien « avait atteint très tôt une stabilité relativement avancée », ainsi qu’en convient l’auteur. Car, pour frappantes qu’elles soient parfois, les variantes qui ont pu ainsi être relevées ne paraissent pas de nature à changer en profondeur le sens du texte révélé. Ce qui se trouve être en jeu, c’est « une approche du texte bien différente du littéralisme qui s’imposera par la suite », écrit François Déroche. Ce que cette version laisse voir, c’est une attitude, un positionnement à l’égard du texte, donnant « la mesure de la flexibilité du texte coranique encore admise au VIIe siècle ».

François Déroche © Emmanuelle Marchadour
Un hadith célèbre
À maintes reprises dans son ouvrage, François Déroche se réfère à un très célèbre hadith, rapporté, glosé, discuté, interprété par la plupart des traditionnistes (spécialistes du hadith) et dont il existe, par conséquent, de très nombreuses versions. Elles mettent en scène une dispute entre deux Compagnons du Prophète – l’un d’eux étant le plus souvent le futur calife Umar ibn al-Khattâb – relativement à un passage du texte coranique. Ayant fait choix de porter leur différend devant Muhammad lui-même, celui-ci engage chacun d’eux à réciter les versets qui sont en cause. À la grande surprise des protagonistes, et malgré les divergences de leurs « lectures », le Prophète donne ensuite successivement raison à chacun d’eux ! Plusieurs versions de ce hadith s’achèvent par cette observation du Prophète : « Ô Umar ! Tout le Coran est correct tant que tu n’as pas substitué la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde ».
La substance du propos qui lui est attribué, l’attitude prêtée à Muhammad en la circonstance, dénotent une audace tranquille, une distance assumée, alors même que le texte de la révélation se trouve être en cause. Le hadith montre que la préférence du Prophète va à la récitation « selon le sens » (bi-l-ma’nâ) plutôt qu’à la récitation « selon la lettre même du texte » (bi-l-lafz). Se trouve également exprimée « l’idée qu’il était possible de procéder à des substitutions », note également François Déroche. « Celles-ci, poursuit-il, ne sont pas proscrites, mais encadrées ». Autrement dit : elles sont possibles tant qu’on ne remplace pas une chose par son contraire, comme le « châtiment » par la « miséricorde ». « Cette licence », atteste Déroche, « équivaut à légitimer le recours aux synonymes », lequel concernait au premier chef ces paires d’épithètes se rapportant à Dieu que le lecteur du Coran rencontre à la fin de très nombreux versets.
Seize de ces paires apparaissent plus de cinq fois dans le texte coranique. La plus fréquente, ghafûr / rahîm (« Absoluteur et Miséricordieux »), connaît 71 occurrences. Viennent ensuite ‘azîz / hakîm (« Puissant et Sage »), samî’ / ‘alîm (« Audient et Omniscient »), ‘alîm / hakîm (« Omniscient et Sage »), qui sont citées, elles aussi, plusieurs dizaines de fois. D’autres, telles ‘aliyy / kabîr (« Auguste et Grand »), latîf / khabîr (« Subtil et Bien informé »), ghaniyy / hamîd (« Suffisant à Soi-même et Digne de louanges »), etc., apparaissent moins fréquemment. Si ces épithètes n’apportent pas grand-chose au texte – au point qu’on pourrait la plupart du temps les omettre sans en changer le sens –, elles sont cependant essentielles à la rime, à la rythmique du texte coranique, et en cela contribuent à sa spécificité, à son génie. Malgré cette importance, il semble bien qu’« une grande latitude était laissée aux Compagnons pour sélectionner l’une ou l’autre d’entre elles et éventuellement pour en changer si le besoin s’en présentait – tant que le sens n’était pas modifié », écrit Déroche.
« Cette approche du texte coranique a accompagné sa transmission orale, mais également écrite », poursuit-il. Cette licence, cette latitude – relatives au traitement des fins de versets –, sont à l’œuvre sous le calame du copiste de la couche inférieure du palimpseste de Sanaa. En effet, les nombreuses variantes attestées dans cette recension du texte – et qui la différencient de la version uthmanienne – concernent au premier chef des fins de verset. Ce qui n’était dans un premier temps qu’une pratique associée à la récitation serait dès lors devenu, quand il s’est agi de mettre le texte par écrit, « un véritable outil éditorial », selon la pertinente formule de Déroche.
Coran pluriel des origines
Les recensions contemporaines de celle d’Uthman, c’est-à-dire celles attribuées à des Compagnons du Prophète, tels Ubayy ibn Ka’b ou Ibn Mas’ûd, n’ont pas subsisté autrement que sous la forme de citations, de brefs passages du texte, repris dans les travaux de grammairiens, d’exégètes ou d’historiens. La version du Coran inscrite sur la couche inférieure du palimpseste de Sanaa est la seule « dont la formulation ne coïncide pas avec la version uthmanienne » à avoir été conservée. Elle garde « des traces concrètes de la praxis des premières communautés musulmanes en matière de transmission du Coran », ainsi que le « souvenir de pratiques antérieures à la canonisation du texte, voire à sa mise par écrit ». Dans cette version, les permutations affectant le lexique, les changements d’épithètes, pour nombreux qu’ils soient, ne sont pas de nature à modifier le texte en profondeur, à en changer le sens, ainsi qu’on l’a déjà noté. Ils permettent de comprendre quel a pu être le rapport au texte de la révélation pendant la période qui a précédé le moment où le Coran a définitivement été figé dans sa version canonique. Cette flexibilité avec laquelle était appréhendé le message coranique, cette fluidité avec laquelle il était retranscrit, que François Déroche parvient à circonscrire, confèrent ainsi à ce « Coran pluriel des origines », une présence évanescente mais ô combien émouvante. C’est en cela que réside principalement le grand intérêt d’un ouvrage qui parvient à saisir, avec autant de finesse que de précaution, une dimension du Livre que le passage du temps et le pouvoir des hommes avaient oblitérée.
« Tant que Muhammad était présent pour valider ou infirmer une récitation et qu’aucune recension écrite complète du texte coranique ne pouvait être opposée à la parole, le caractère multiforme de la révélation pouvait se maintenir sans grandes difficultés », écrit Déroche. Cependant, « la circulation d’exemplaires écrits vint sans doute constituer un obstacle à la flexibilité du texte », poursuit-il. Dès que fut établie la version d’Uthmân, « l’État a apporté un soutien constant et sans faille à « son » texte au détriment des autres recensions, et des représentants de premier plan de l’orthodoxie […] ont œuvré pour écarter ces dernières et affirmer le primat absolu du texte uthmanien », constate-t-il encore. La décision d’imposer à la communauté une forme écrite unique s’est pourtant accompagnée de résistances et, « jusqu’au début du Xe siècle au moins, des questions sur l’authenticité de la version uthmanienne ne manquèrent cependant pas de surgir », observe François Déroche. Malgré celles-ci, et le temps passant, le texte uthmanien, « soigneusement corseté par les sciences coraniques qui en répertoriaient minutieusement tous les aspects était devenu parfaitement authentique ». Ainsi, « le Coran pluriel des origines » avait été réduit à une version unique !
-
On commencera par noter qu’en écriture hijazie un simple « denticule » (qu’on se représente seulement le simple tracé d’un petit chevron, ou encore, celui d’une lettre « i », dépourvue de point, en écriture latine manuscrite), placé à l’initiale ou à l’intérieur d’une séquence de lettres, peut être lu, de cinq façons différentes – à savoir, comme un bâ’ (« b »), un tâ’ (« t »), un thâ’ (« th »), un yâ’ (« y ») ou un nûn (« n ») –, cela sans préjuger, bien sûr, de la voyelle l’affectant. On notera encore qu’une suite de trois de ces denticules, placée au début ou à l’intérieur d’une séquence de lettres, peut bien sûr être lue comme la succession de trois consonnes parmi celles qui viennent d’être énumérées, mais encore – appréhendée cette fois comme un tout – comme une consonne unique, à savoir un sîn (« s ») ou bien un shîn (« sh »), sans préjuger, là encore, de la valeur vocalique pouvant affecter cette consonne.
Dès lors, sur le recto du vingt-cinquième feuillet du codex Parisino-Petropolitanus, un mot – appartenant au vingt-deuxième verset de la sourate X, Jonas – commençant par cinq denticules peut faire l’objet de deux lectures aussi différentes que yusayyirukum (« il vous fait voyager »), d’une part, ou bien yanshurukum (« il vous répand »), d’autre part. On y insiste : le même tracé graphique, le même trait, le même rasm peut être lu de l’une ou de l’autre manière. Selon que l’on retient la première lecture (Huwa lladhi yusayyirukum fî al-barr wa-l-bahr : « C’est lui qui vous fait voyager sur la terre et la mer ») ou la seconde (Huwa lladhi yanshurukum fî al-barr wa-l-bahr : « C’est lui qui vous répand sur la terre et la mer »), le sens peut se trouver sensiblement distinct.
En plus du fait qu’elle ne notait pas les voyelles brèves, l’écriture hijazie ne notait pas systématiquement non plus la présence d’un « â » long par un alif, comme l’usage le voudrait plus tard. D’où un fort grand nombre d’ambiguïtés : ainsi, par exemple, qâla (« il a dit ») s’écrivait exactement de la même façon que qul (« dis ! »). De même, rajul (« homme ») s’écrivait de la même manière que rijâl (« hommes »). Là encore, selon que l’on adopte une lecture ou une autre, le sens du texte peut se trouver modifié.












![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)