Les hasards des parutions autorisent parfois des promenades savantes, guidées par des ouvrages qui dialoguent à travers des concordances de temps et des ponts établis par la lecture. C’est le cas avec un ensemble disparate de livres consacrés à la Renaissance et à l’âge baroque, témoignant tous de la spécificité de la période historique en même temps que des regards portés par notre contemporain sur cette époque charnière de la modernité.
Catherine Magnien et Éliane Viennot (dir.), De Marguerite de Valois à la reine Margot. Autrice, mécène, inspiratrice. Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 276 p., 25 €
Ariane Bayle et Brigitte Gauvin (dir.), Le siècle des vérolés. La Renaissance européenne face à la syphilis. Jérôme Millon, coll. « Mémoires du corps », 384 p., 26 €
Vanini, portrait au noir. Édition et présentation par Boris Donné. Allia, 144 p., 8 €
Guillaume Calafat, Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée, XVIIe siècle). Seuil, coll. « L’univers historique », 456 p., 25 €
La reine Margot « autrice ». Voici l’écriture inclusive qui s’invite au chevet renaissant de la célèbre reine, à travers un ouvrage collectif enthousiasmant. Rien d’étonnant quand on lit la liste des contributeurs et contributrices. Éliane Viennot, codirectrice de ce recueil consacré à la reine de Valois, est en effet l’une des meilleures ambassadrices et spécialistes de cette écriture inclusive, grâce à ses nombreux ouvrages retraçant une histoire critique de la domination masculine dans la langue française. Avec Catherine Magnien, elle dirige un ouvrage permettant une redécouverte du rôle de la fille de France immortalisée par Dumas comme intelligence prodigieuse de la cour de son temps : tour à tour mécène mettant en œuvre des stratégies clientélistes et esthétiques redoutablement efficaces et modernes, autrice et patronne des lettres inventant des figures du moi féminin inédites pour ce XVIe siècle finissant, femme politique détestée par certains et adulée par d’autres, figure diabolisée ou mythifiée dans la houle d’une mémoire complexe et d’une histoire clivée. Marguerite de Valois, à travers le prisme des études de genre, s’inscrit dans une histoire de la féminité aristocratique de la fin du XVIe siècle français, qui fut un moment charnière dans l’histoire politique, sociale et intellectuelle des femmes, entre des héritages médiévaux ambigus et un XVIIe siècle d’exclusion plus systématique. Marguerite de Valois illustre parfaitement cette histoire encore en cours, elle qui sort à peine – et grâce à cet ouvrage notamment – de plusieurs siècles de mépris, allant comme le rappelle Éliane Viennot jusqu’à « autoriser un historien de la Saint-Barthélemy, Jean-Louis Bourgeon, à remettre en doute l’auctorialité de Marguerite sur ses Mémoires ».
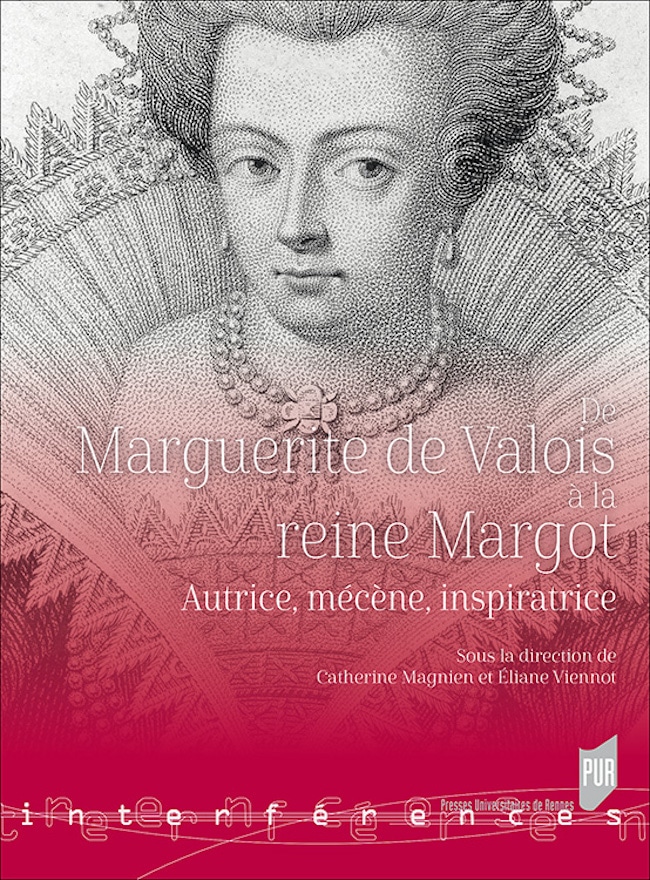
Le livre fait le portrait d’une Marguerite de Valois restée longtemps confinée aux huis clos d’études savantes et engagées, dont un colloque de Nérac célébrant les 400 ans de sa mort en 2015 avait constitué un jalon important. Ce renouveau historique permet une réévaluation salutaire du rôle de la reine – et avec elle des femmes – au sein d’une histoire des lettres et des arts du second XVIe siècle, mais aussi de son rôle politique dans le cadre d’une société de cour dont notre connaissance a été profondément remaniée depuis les études de Jacqueline Boucher jusqu’à celles de Nicolas Le Roux sur la faveur royale sous les derniers Valois. Cette capacité des auteurs et autrices à embrancher leurs démarches dans des débats savants de grande ampleur est le meilleur hommage fait à la défense des études de genre, prouvant par cette rigueur enthousiasmante que celles-ci sont un moyen fécond de montrer que l’histoire est d’abord œuvre d’imagination et de science appelée à se renouveler dans l’intégration des idées formalisées par son présent. Ce renouvellement dépasse ici la question des seules démarches, pour s’attarder à des conclusions inédites. Ainsi en est-il de la découverte de l’univers intime de la reine et de son entourage, articulé à une histoire esthétique et politique déjà connue par ailleurs. Au-delà des débats stériles provoqués par le mot « autrice », pourtant attesté dès la Renaissance, De Marguerite de Valois à la reine Margot témoigne avec force de la valeur scientifique des questionnements contemporains sur le genre. Bien conçus, ils viennent porter la lumière là où on ne la portait pas, pour faire émerger de nouvelles compréhensions d’un passé qu’une mémoire fantasmée avait pu rendre parfois hermétique.
Télescopage des présents et des passés que l’on retrouve dans d’autres ouvrages dédiés à la même période, comme cette compilation de textes consacrés à la question de la syphilis aux XVIe et XVIIe siècles sous la direction d’Ariane Bayle. Sans fuir une histoire de la médecine et du pathologique à laquelle il contribue pleinement, Le siècle des vérolés élabore plutôt un objet complexe au croisement de la littérature, du biologique, de l’économique et du politique, pour faire de la vérole une porte d’entrée vers de nombreux questionnements propres à la Renaissance et d’une grande actualité. L’enquête esquissée ne cesse alors de développer des champs d’investigations proprement passionnants : la dimension mondialisée et sa compréhension par les contemporains en est le premier trait saillant, pour une maladie venue en Europe suite à la conquête des Amériques. Comme en écho aux recherches récentes sur la colonisation du savoir (dont le magnifique et récent ouvrage éponyme de Samir Boumediene), ces textes et leur édition retracent l’itinéraire de la maladie, de l’Hispaniola de Colomb jusqu’aux prostituées des armées espagnoles et napolitaines, transmettant le « mal français » aux soldats ibériques et français qui à leur tour le diffuseront dans l’Europe et bientôt le monde entier. À son tour, la vérole telle qu’elle se raconte dans les textes des contemporains se fait la conteuse d’une réinvention de l’intimité des modernes : première maladie liée au sexe dont les symptômes se portent sur le visage, elle induit un bouleversement de l’intime traversant tous les domaines du social et du culturel. À ce titre, ce recueil de textes littéraires rappelle avec force la place qu’occupa la syphilis dans l’histoire littéraire européenne, permettant même à certains auteurs, tel Patrick Wald Lasowski, d’en faire en 1982 un thème privilégié d’œuvres de la modernité romanesque et poétique du XIXe siècle français.

Derrière la trivialité et le grotesque qui se dessinent immédiatement dans les textes traitant de la vérole affleure le symbole de bouleversements majeurs, liés aussi bien aux progrès « humanistes » qu’à la première mondialisation en marche depuis la fin du XVe siècle. Le lecteur contemporain retrouve chez le vérolé un symptôme ductile des nombreux champs de réflexion que traverse la maladie : l’inimitié politique qui la fait nommer « mal français » par les Italiens, « mal napolitain » par les Français et « mal espagnol » par les Flamands, dans une étrange syntaxe géopolitique et vérolée ; la morale médicale et sexuelle transfigurée par l’apparition sur les corps de pustules honteuses ; l’économie contée par Shakespeare, mise en branle autour du traitement de la maladie (qui participa à l’enrichissement des banquiers Fugger)… La vérole est bien l’une des premières pandémies mondiales, dont les contemporains ont eu une compréhension malgré tout claire. Elle touche à ce titre l’ensemble du globe en même temps que tout le corps social, dans une fluidité proprement baroque du sexuel, du médical et des mœurs. Sans oublier, une fois encore, le poétique, qui trouve dans la vérole plus qu’un sujet, une matière à provocation et à invention dans cette époque du libertinage naissant. Ainsi de Théophile de Viau, qui provoqua par un sonnet consacré à la maladie non seulement un premier « procès du libertinage » (1623) mais aussi des expérimentations littéraires remarquables, entre moquerie du christianisme et affirmation d’une subjectivité fondée sur un art de la débauche :
« Phyllis, tout est foutu je meurs de la vérole,
Elle exerce sur moi sa dernière rigueur :
Mon vit baisse la tête et n’a point de vigueur,
Un ulcère puant a gâté ma parole.
J’ai sué trente jours, j’ai vomi de la colle,
Jamais de si grands maux n’eurent tant de longueur,
L’esprit le plus constant fût mort à ma langueur,
Et mon affliction n’a rien qui la console.
Mes amis plus secrets ne m’osent approcher,
Moi-même en cet état je ne m’ose toucher,
Phyllis le mal me vient de vous avoir foutue.
Mon Dieu je me repens d’avoir si mal vécu :
Et si votre courroux à ce coup ne me tue,
Je fais vœu désormais de ne foutre qu’en cul. »
L’outrance libertine de Théophile de Viau rappelle d’autres références que la simple vérole, notamment le bouillonnement intellectuel critique du christianisme qui émerge dans certains milieux ultra-minoritaires de la chrétienté au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Parmi eux, un personnage relativement oublié dont le poète baroque fut un proche, à tel point qu’on les a parfois confondus : Lucilio Vanini, qu’un court et beau livre dirigé par Boris Donne permet de redonner à voir dans un Portrait au noir qui rappelle la précocité de la pensée « proto-libertine » (à défaut d’un terme plus précis). Carme rapidement défroqué à défaut d’être déchaussé, Vanini se laisse gagner par des idées hérétiques qu’il va piocher dans les écrits sulfureux du début du XVIIe siècle. Il se grime sous une fausse identité et parcourt l’Europe entre Italie, Angleterre, Flandres et France, rencontrant les milieux lettrés et publiant lui-même un certain nombre d’ouvrages faisant scandale malgré ses subterfuges pour contourner les censures. Passant en contrebande des idées hérétiques ou du moins scabreuses, fondées sur une lecture singulière tant des anciens que des plus sulfureux contemporains, Vanini finit par se retrouver mis en procès en 1619 par l’évêché de Toulouse, qui le condamne finalement au bûcher. Dix-neuf ans après Giordano Bruno, Vanini fait figure d’autre victime de la lutte menée par l’Église catholique contre les pensées et les sciences contraires au dogme. Victime moins connue, mais dont le livre montre toute la singularité et l’importance dans une Europe tiraillée entre ses histoires, celle d’une Renaissance crépusculaire et celle d’un Grand Siècle encore à venir.

Ce rappel lumineux de la figure d’un libertin pionnier, mystérieux et ambigu ajoute un portrait à cette galerie de personnages que le hasard de certaines parutions récentes expose sous un jour nouveau. Cette exposition pourrait se conclure par un acteur devenu essentiel dans l’historiographie moderne depuis Fernand Braudel, avec la très belle monographie que consacre Guillaume Calafat à la Méditerranée du XVIIe siècle. Une mer jalousée prend appui sur l’étude des conflits autour de la mare nostrum pour fouiller avec profit une histoire de la souveraineté des mers et des océans née pour une bonne part au Grand Siècle dans sa dimension moderne. S’appuyant d’abord sur des textes juridiques, l’historien restitue les débats théoriques qui ont constitué cet objet politique et diplomatique complexe – surtout à l’heure de la première mondialisation – que sont les eaux qu’on appelle aujourd’hui internationales, autour de l’affrontement de deux conceptions, mare nostrum et mare claustrum. De ces théories conflictuelles fort complexes, Guillaume Calafat tire la substance d’une étude des conflits concrets qui émergent en Méditerranée entre des États dont on connaît les guerres de longue haleine en cette période, Venise, l’Empire ottoman, l’Espagne des Habsbourg ou la France des Bourbons.
Avec cette « mer jalousée », Guillaume Calafat offre l’occasion d’un angle nouveau et fructueux pour comprendre les enjeux maritimes et leurs rapports profonds avec la constitution d’une souveraineté moderne dans le long et grand siècle que fut le XVIIe. Sans s’en réclamer explicitement, il place son sujet dans une démarche d’actualité, à la fois mondiale et comparée, qui invite à son tour le lecteur à être attentif aux nouvelles échelles par lesquelles les chercheurs d’aujourd’hui redécouvrent la Renaissance et l’ère baroque. Ces quatre livres proposent des réflexions historiques qui produisent du sens, alors que la vérole et les idées iconoclastes circulent sur des mers dont les pouvoirs européens font le droit et la police, pavant la voie à d’autres histoires.









![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)


