Comment dire l’absence ? Comment dire l’absence de Pierre Pachet, brutalement disparu le 21 juin 2016, dans son appartement de la rue Chapon ? Ce fut déjà difficile pour nous (nous : Tiphaine Samoyault et Jean Lacoste [1]) qui avions eu le privilège d’assumer avec lui, à la mort de Maurice Nadeau, la responsabilité éditoriale de La Nouvelle Quinzaine littéraire, puis, avec moins de frustrations, celle d’En attendant Nadeau. Il apportait sa caution d’écrivain, d’essayiste, sa connaissance la plus large de la littérature, son refus viscéral des tentations du totalitarisme, sa volonté de dire l’intime, l’intime de ce corps familier qui, à la fin, vous lâche… Il avait un charisme extraordinaire dans l’expression orale, cherchant ses mots pour de fulgurantes intuitions. Un intellectuel de haut rang. Mais combien plus douloureuse, naturellement, cette absence pour les proches, les enfants, en particulier sa fille Yaël Pachet qui consacre un « roman » à ce qui est le récit sans fard d’une relation fille-père, à la fois intense et parfois conflictuelle.
Yaël Pachet, Le peuple de mon père. Fayard, 271 p., 18 €
Yaël Pachet, dans cet essai à la fois poignant et impudique, tente de saisir au plus près cette chose terrible qu’est le deuil, le deuil d’un père, la disparition d’un intellectuel admiré, la fin d’une complicité.
L’ouvrage est qualifié assez étrangement de « roman » alors que tout dit ici sa vérité. Serait-ce parce que Pierre Pachet n’a jamais été tenté d’en écrire un, malgré son penchant pour ce qu’on pourrait appeler la littérature de pensée ? Il avait lui-même entrepris une biographie d’un genre particulier pour dire ses relations avec son père, l’Autobiographie de mon père, « texte étrange », disait-il d’emblée, pour lequel il aurait simplement « tenu la plume » et où il avait donné la parole à son père, avec qui, semble-t-il, les relations avaient été difficiles, tendues, et marquées notamment par un silence, un mutisme difficile à briser, voire une certaine indifférence réciproque.
Pierre Pachet, précoce lecteur de Baudelaire, a fait tôt l’expérience de l’ennui, que sa mère essayait de dissiper par de petits jeux de société, mais qui, selon le père, devait être chassé par une « vie intérieure ». Le fils a obéi à cette admonestation paternelle, il s’est à coup sûr donné cette « vie intérieure » dont il a traqué les manifestations dans la littérature et dans ces réalités mal connues que sont le sommeil, la solitude ou la peur. Yaël Pachet cite ce passage clef de l’Autobiographie de mon père sur l’utilité de la vie intérieure, et l’on peut penser que son livre trouve là son origine et, dans une certaine mesure, son modèle. De même que Pierre Pachet rendait finalement hommage à son père qui avait permis à sa famille de traverser les épreuves de son temps, Yaël Pachet remercie le sien de lui avoir ouvert les voies d’une vie intérieure et le goût de l’écriture. Mais avec une limite, une restriction, à laquelle fait signe le titre même de cet essai, Le peuple de mon père.

Yaël Pachet © Richard Dumas
Le peuple de Pierre Pachet, le peuple juif, est-ce le peuple de sa fille ? Yaël Pachet consacre de belles pages à sa mère, Soizic, l’élégante épouse bretonne de Pierre, « l’amour de sa vie », auprès de qui il est enterré, et qui n’était pas juive. Soizic ou la part chrétienne du ménage. Pierre Pachet, s’il admirait l’Israël des fondateurs, avait une relation assez distanciée avec son identité juive : « il respectait les grandes célébrations, revêtait à l’occasion sa kippa, couvrait d’un geste désinvolte ses épaules avec le châle blanc frangé qu’on appelle talit, l’habit en hébreu ». Mais il ne pouvait oublier que son père, Simkha Apatchevsky, né près de Tiraspol, en Bessarabie, avait fait ses études à Odessa, gagné la France en 1914 et obtenu la nationalité française en 1925. Il ne pouvait oublier que ce docteur en médecine avait changé son nom en Pachet et s’était abstenu de faire inscrire sa famille sur le registre des juifs sous l’Occupation et avait confié ses deux tout jeunes enfants à des institutions catholiques, tout en faisant vivre à Vichy un modeste cabinet de stomatologie. Il ne pouvait oublier que son arrière-grand-père avait été probablement massacré par un Einsatzskommando quelque part près de Jassy en Roumanie. D’ordinaire la mémoire se nourrit d’une part d’oubli, a besoin d’un geste d’effacement pour vivre sainement, mais cette mémoire-là est si lourde à porter qu’elle semble impossible à dire, à exprimer, à assumer. Sans doute est-ce ce que Yaël Pachet a voulu dire en évoquant le « peuple de son père » : c’est reconnaître une distance, comme s’ils étaient « condamnés à ne jamais [se] rejoindre ». Malgré l’intensité chaleureuse de leur relation – le souvenir de ces matins où Pierre réveillait doucement sa fille avec le chat Faustine –, malgré les lectures partagées ou conseillées, malgré les vacances bretonnes ou en Grèce, quelque chose d’indicible semble les séparer.
Il est vrai que Pierre Pachet avait tiré de l’étude des stoïciens – il avait consacré sa thèse à Cléanthe – l’idée qu’il fallait apprendre à accompagner les mouvements imposés ; il appelait « vigilance » cette conscience de soi sans complaisance, cette découverte de l’intime, sans trop s’attarder sur l’idée d’inconscient. Il s’agissait pour lui, dans les différentes expériences d’égarement qu’il avait pu connaître dans sa vie (du haschich à Berkeley jusqu’aux nuits sans sommeil de Jassy, des voyages « loin de Paris » de La Quinzaine littéraire au grand âge), d’interroger chaque fois l’absence. De l’affronter. Avec impudeur, jusqu’à un certain point, mais avec une exigence de vérité, qui se conforte de l’exemple des œuvres littéraires. Il se veut sensible au présent de l’absence, comme l’observe très justement sa fille, qu’il s’agisse de son père silencieux, rationnel, qui eut sans doute, lui aussi, sa « vie intérieure », de sa famille disparue en Transnistrie, de sa mère atteinte par la démence sénile dans Devant ma mère et de son veuvage désemparé. Et cela est sans doute l’héritage que partage le plus volontiers Yaël Pachet, ce souci de l’écriture comme manière salvatrice de dire l’absence.
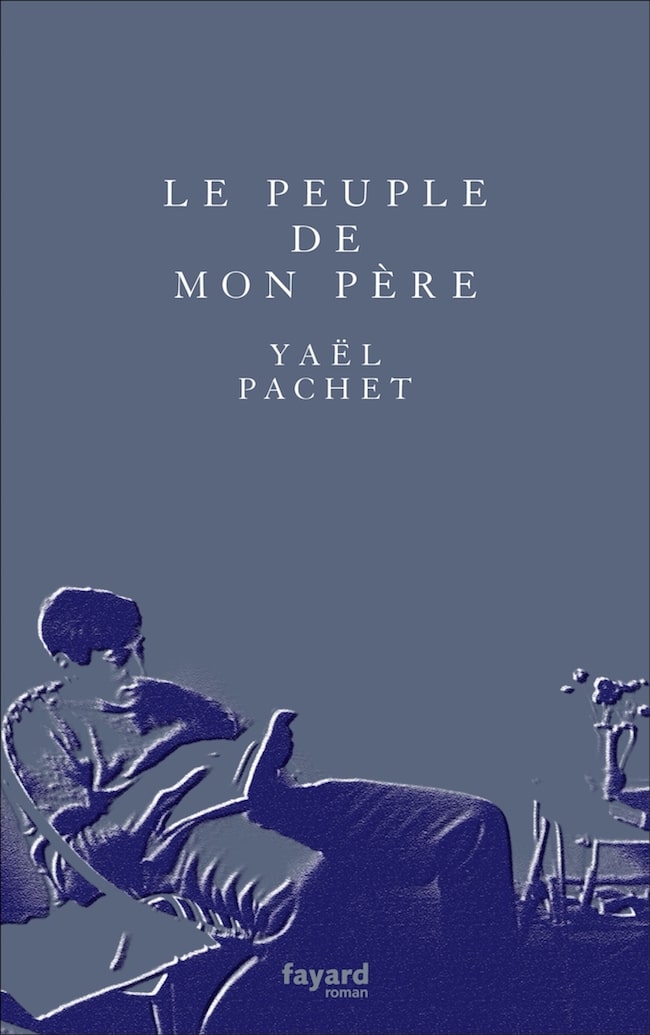
À seize ans, elle avait pleuré en lisant Malone meurt de Beckett sur le conseil de son père ; mais en ce jour de l’été 2016, la réalité est là de ce corps mort, de cette voix devenue silencieuse. Tout le livre converge vers cet instant irréductible, ce qui donne une page profondément émouvante et juste : « J’ai regardé sa mâchoire, ses lèvres à peine entrouvertes, comme s’il allait soupirer, ou dire quelque chose, ou se taire, comme s’il avait mal. Comme si, dans la mort, ou entrant dans la mort, il avait fourni ce dernier effort d’attention, cette dernière impulsion qui lui tenait tant à cœur à habiter le geste, à le faire sien, à l’assumer, à accompagner le corps avec sa conscience, à ne pas se laisser mourir sans interroger cet événement dans son corps, cette fatigue, ou ce choc inédit, sans penser le geste, le faire sien. » « Je veux mourir furieux », aurait-il dit à sa fille, qui, elle, sent son identité « disloquée ».
Assurément nous partageons cette tristesse et saluons ce beau geste d’hommage par l’écriture, ce kaddish sans retenue, cette prière des morts chuchotée au chevet d’un mort aimé. Certaines pages de ce livre d’émotion et de confidences ne pourront être vraiment comprises que par ceux, assez proches, qui n’ignorent pas certains détails de la vie de Pierre, comme telle relation de rivalité avec un certain (bien connu) Pierre M. Pour nous, si Pierre Pachet est vivant, il l’est aussi dans ses essais et dans cette somme considérable d’articles qu’il a publiés dans différentes revues, dont En attendant Nadeau, qui sont pour nous indissociables de son souvenir, comme ces fascinantes captations de séminaires avec Patrick Hochart, disponibles sur un site qui préserve pour nous, et pour tous, une part de sa mémoire.
-
Nous devions ce jour de juin préparer chez lui la maquette du prochain numéro de la revue avec le secrétaire de rédaction, Hugo Pradelle.












