Dans un grand livre sur l’éthique de la pensée, Pascal Engel se demande ce qu’il faut de plus au croire pour savoir. Il montre que les vices intellectuels consistent à ne pas reconnaître nos raisons et nos normes épistémiques, lesquelles sont autonomes par rapport aux raisons pratiques.
Pascal Engel, Les vices du savoir. Essai d’éthique intellectuelle. Agone, 616 p., 26 €
Dans le premier de ses grands livres consacrés à la logique ou, plus précisément, à la philosophie de la logique, La norme du vrai, il y a exactement trente ans, Pascal Engel accordait aux notions de vérité et de signification une place centrale. Il ne se contentait pas alors d’inventorier des formes, il se préoccupait avant tout d’analyser leurs conditions d’application au langage, à la pensée et à la réalité. Il n’est pas inexact, je crois, de dire que son nouvel ouvrage, d’une exceptionnelle densité et d’une admirable érudition, représente l’achèvement, certes provisoire, d’un programme de travail exploré dans d’autres travaux – notamment dans une importante synthèse, La vérité (1998), dans son dialogue avec Richard Rorty, À quoi bon la vérité ? (2005), dans sa ferme réfutation d’une épistémologie contextualiste et relativiste, Va savoir ! De la connaissance en général (2007), dans la savoureuse introduction aux principaux problèmes de la philosophie des sciences, Épistémologie pour une marquise (2011), et, enfin, dans Les lois de l’esprit (2012), qui, à travers une analyse des engagements fondamentaux de Julien Benda, proposait un riche portrait en creux de Pascal Engel.
Si Les vices du savoir poursuit donc un projet d’une rare cohérence, on aurait cependant grandement tort de ne pas mesurer sa radicale nouveauté – nouveauté qui accentue le regret de l’absence d’un index nominum, dont l’auteur n’est évidemment pas responsable. Cette nouveauté réside dans l’élaboration des principes d’une éthique intellectuelle, autrement dit de normes pour la pensée, dont l’indépendance au regard de l’éthique en général et de l’épistémologie est fortement dégagée. Au-delà de cette construction théorique, Pascal Engel montre que s’opposer à la domination des puissants implique, pour la démocratie, une défense intransigeante de la notion de vérité.
Normes et raisons du croire : l’éthique première de la croyance
Si l’autonomie de l’éthique intellectuelle constitue l’affirmation centrale du livre, la distinction entre ses deux niveaux est particulièrement heuristique. Le premier définit les conditions de la conformité et de la correction de la croyance. Pascal Engel défend l’évidentialisme, c’est-à-dire, dans la perspective de William Clifford, la thèse selon laquelle on doit toujours croire sur la base des preuves ou des données disponibles. Si l’auteur s’éloigne de la coloration moralisatrice que Clifford attachait à sa maxime, il ne refuse pas pour autant l’idée que certaines évaluations épistémiques ont une dimension éthique. Sa position défend conjointement l’idée de normes et de valeurs partiellement communes entre épistémologie et éthique et le refus de l’inclusion de la première dans la seconde. C’est l’un des enjeux de ce livre que de montrer la possibilité de la corrélation entre des domaines néanmoins indépendants. Pascal Engel refuse à la fois la coupure radicale entre éthique et épistémologie que propose le positivisme (d’un côté la recherche du vrai, de l’autre celle du bonheur et du bien) et l’unification des deux que proposent des conceptions eudémoniques, dont les conceptions aristotélicienne et chrétienne.
Cette éthique première doit surmonter trois défis : le problème normatif, le problème du volontarisme et le problème de la justification. Le premier porte sur la question de savoir si les évaluations dans le domaine cognitif doivent être envisagées en termes déontiques (c’est-à-dire d’obligations) ou en termes téléologiques (c’est-à-dire de buts). Le deuxième, crucial à n’en pas douter, consiste à se demander si nous pouvons croire volontairement (auquel cas nous serions responsables de nos croyances). Enfin, le troisième concerne les modalités de la justification épistémique (peut-elle emprunter d’autres voies que celle des preuves ou des données qui l’étayent ?).

Pascal Engel © D. R.
Pascal Engel rejette l’idée qu’il puisse exister une acrasie épistémique (une faiblesse de la volonté : je crois ce que je ne devrais pas croire) et défend corrélativement l’argument de la transparence, socle de l’évidentialisme normatif, selon lequel « quand on se demande si l’on croit que P, on cherche spontanément à savoir si P est le cas », argument lié à deux propriétés de nos croyances, « leur rationalité et l’autorité que nous avons sur la question de savoir quelles sont nos propres croyances ». En d’autres termes, la norme de vérité est la meilleure explication de cette transparence de la croyance à la vérité.
Quant à la possible existence d’obligations épistémiques, malgré de nombreuses objections, soigneusement examinées, elle est dictée par la manière dont les normes régulent la délibération sur des croyances, même si ces obligations ne peuvent être assimilées à des prescriptions. Dès lors, la justification épistémique, quoi que puissent en penser les pragmatistes, ne peut faire l’économie de l’affirmation de normes épistémiques, telles que celles de vérité et de savoir. Il s’agit de normes constitutives qui déterminent donc un idéal, autrement dit « ce que la croyance devrait être pour tout individu rationnel capable d’en avoir le concept ».
Les croyances religieuses échappent-elles à ces contraintes ? Pascal Engel estime que l’on ne comprend pas la nature de la croyance si on est obnubilé par la question de la religion. Et, corrélativement, que l’on ne comprend pas bien la nature de la croyance religieuse si on la détache des divers modes et opérations de notre faculté doxastique. L’évidentialisme peut-il s’appliquer à ces contraintes ? Deux types d’objections peuvent être soulevés. Le premier, que Pascal Engel nomme différentialisme, consiste à affirmer que la croyance religieuse est distincte des croyances ordinaires (qu’elles soient quotidiennes ou scientifiques). Le second, assimilationniste, soutient au contraire qu’il y a bien des choses en commun entre ces croyances mais, le plus souvent, refuse le mode de justification propre aux croyances ordinaires (même si la variété des positions n’autorise guère cette généralisation).
L’auteur s’intéresse essentiellement à cette seconde objection : se soumet-elle vraiment à l’évidentialisme ? Dans la mesure où ce dernier est fondé sur le principe de transparence et de cohérence de la croyance, il défend l’exclusivité (par rapport aux raisons pratiques) des raisons épistémiques de croire : on ne peut pas, au sens normatif, croire pour des raisons autres qu’épistémiques. En outre, il refuse la commensurabilité des raisons pratiques et épistémiques. Or l’assimilationniste fait appel à la confiance (il se réfère souvent à des « certitudes primitives »), laquelle recourt légitimement à la raison pratique.
Cette perspective doit beaucoup à la sociologie durkheimienne, qui relègue les croyances au second plan pour privilégier les pratiques. On ne saurait dès lors considérer qu’elle se soumet aux critères de l’évidentialisme puisqu’elle se soustrait à l’exigence de preuves et ne vise pas à déterminer en quoi nos croyances peuvent être des connaissances. Les raisons pratiques de croire, notamment fondées sur l’espoir ou la consolation, ne sont pas de « bonnes » raisons et, en réalité, ne sont pas, du point de vue évidentialiste, des raisons du tout.
À l’évidentialisme normatif, sorte de métaphysique des mœurs, pour utiliser un vocabulaire kantien, Engel adjoint une doctrine de la vertu, soit une éthique seconde de la croyance. Il faut souligner la distance entre l’idée aristotélicienne de vertu intellectuelle et cette éthique seconde, qui met en avant les notions stoïciennes de raison et de normes.
Une théorie des vertus intellectuelles : l’éthique seconde de la croyance
L’évidentialisme normatif est compatible, selon l’auteur, avec l’idée qu’il peut y avoir « une forme d’agir épistémique qui ne nous rende pas complètement irresponsables de nos croyances ». Reste à déterminer comment nous pouvons avoir une connaissance des normes, et des raisons de les accepter ou non. En d’autres termes, quelles peuvent être nos raisons de croire et quel lien entretiennent-elles avec nos raisons d’agir ?
Le point de vue de Pascal Engel se construit contre le pragmatisme, du moins une certaine conception de celui-ci (qui épargne Peirce), dont les thèses principales sont les suivantes :
1. Une raison de croire peut être un motif pour une action (thèse de la commensurabilité selon laquelle on est fondé à comparer les raisons de croire et les raisons d’agir et, corrélativement, à accepter que des raisons pratiques puissent l’emporter sur des raisons théoriques).
2. Les raisons d’agir étant fondamentalement constituées par des désirs, les croyances sont des instruments en vue d’une fin pratique.
3. Les normes et les valeurs sont des expressions de nos désirs et de nos buts.
4. Il ne peut exister de justification qui soit exclusivement épistémique.
5. La rationalité de nos actions comme de nos croyances est essentiellement déterminée par nos buts.
6. Croyances et jugements sont exclusivement des dispositions à l’action.
7. La vérité est une notion mince et non une notion métaphysique substantielle.
À de nombreux égards, nous venons ci-dessus de résumer la vulgate philosophique dominante. Engel lui oppose une éthique dite seconde qui se préoccupe du passage des normes de la croyance à leur régulation dans l’enquête : « Être vertueux […] épistémiquement, c’est d’abord être respectueux des raisons et c’est ensuite être gouverné par les normes épistémiques dans ses enquêtes ».

La vérité sortant du puits, par Jean-Léon Gérôme (1896)
Il faut insister sur la conception de l’enquête défendue par l’auteur. Celui-ci a récemment, ici même [1], souligné la différence entre savoir et enquêter. Le pragmatisme privilégie l’enquête ou, plus précisément, le savoir comme enquête. Pour lui, la connaissance est apprentissage, processus, révision par l’expérience. Aucune certitude n’est ainsi à l’abri des révisions. Il existe pourtant une légitimité de l’enquête, dont on trouve le paradigme chez Descartes, qui ne sacrifie pas les normes à la description de la pratique : il s’agit alors de donner des principes absolument certains et infaillibles sur lesquels fonder la science (voir le chapitre consacré à Descartes). Pascal Engel l’écrivait dans son livre sur Benda : « La valeur de la science n’est pas dans ses résultats, lesquels peuvent faire le jeu du pire immoralisme, mais dans sa méthode, précisément parce qu’elle enseigne l’exercice de la raison au mépris de tout intérêt pratique [2] ». On ne peut donc accepter que les normes qui gouvernent nos descriptions du monde soient évaluées à l’aune de leur utilité sociale et non de leur relation à la vérité.
C’est dans la perspective de cette recommandation que l’auteur se livre à un exercice réjouissant : l’inventaire des vices intellectuels – dans le prologue, il se livre à un pastiche de Dante destiné à nous avertir qu’il va bel et bien parler de cet Enfer. Le vice épistémique peut être défini comme une insensibilité aux raisons ou aux normes. La liste est longue (même si chacun des vices répertoriés ne subit pas le même sort) : la curiosité, la « foutaise », le snobisme, le « penser faux », la bêtise. On peut s’étonner de rencontrer la curiosité dans cet inventaire. Pourtant, elle peut être un vice lorsqu’elle « oriente le désir de savoir et l’intérêt en dehors de tout objectif cognitif épistémique de connaissance, mais aussi quand le curieux n’a aucune idée de ce qu’il cherche ni de ce qu’il est important de chercher ».
Il faut s’arrêter un instant sur la place réservée à la « foutaise » (ou bullshit). Si le menteur respecte la vérité et en observe les règles, le bullshitter n’en a cure. Il dit n’importe quoi, sans se soucier de savoir si c’est vrai ou faux. Donald Trump en est le parfait exemple, comme l’a montré Engel dans un travail antérieur [3]. Mais, au-delà, en nommant fake news toute vérité qui lui déplaît, Trump applique « le critère pragmatiste de la vérité combiné au relativisme : “Est vrai ce qui me plaît, faux ce qui me déplaît, mais vous êtes en droit de dire de même” [4] ». Ce cynisme est celui du postmodernisme pour lequel la vérité n’est qu’un mot et le savoir ne peut prétendre à l’objectivité. En renonçant aux idéaux de vérité, de justification et de connaissance objective, « on se met directement entre les mains de ceux pour qui la vérité n’est plus qu’un colifichet inutile [5]”.
Quant à la bêtise, Pascal Engel en distingue deux niveaux. Un niveau de base, portant sur les compétences et la rationalité (ou plutôt l’absence de compétence et de rationalité de l’agent stupide), qui consiste en des dispositions cognitives n’étant pas sous le contrôle de l’agent (ici déficientes), et un second niveau, réflexif, largement sous le contrôle de l’agent. Comme l’ont décrit des épistémologues de la vertu comme Ernest Sosa et John Greco, ce double niveau se reproduit pour toutes les vertus et les vices. C’est au second niveau qu’appartient le véritable vice intellectuel.
On peut se demander si la sociologie des sciences contemporaines n’illustre pas à la perfection la plupart de ces vices. Mais nous aurions tort de minimiser la responsabilité de Michel Foucault, lequel entend bâtir une éthique de la vérité sans la vérité et une généalogie du savoir sans le savoir. Cette remarque critique est l’occasion de souligner que, contrairement à Foucault qui s’intéressait avant tout au savoir dans les sciences, tout particulièrement dans les sciences de l’homme, Pascal Engel, comme il l’avait fait dans Les lois de l’esprit, accorde à la littérature une importance déterminante dans l’ordre cognitif.
Contre le constructivisme de la justification
Héritière de Kuhn et de Feyerabend, la sociologie des sciences contemporaine attribue, dans l’explication des résultats scientifiques, une place prépondérante, pour ne pas dire unique, aux critères externes, c’est-à-dire au poids des logiques financières, politiques et technologiques. Elle adhère implicitement à l’idée que le chercheur est animé, pour l’essentiel, par des intérêts professionnels. S’il ne fait guère de doute que les scientifiques recherchent une rétribution de leurs travaux, il est plus difficile d’admettre qu’ils construisent une réalité en fonction de leurs convictions personnelles. Si seuls les facteurs de détermination externe jouaient un rôle, il serait difficile de décider quelles observations sont susceptibles de départager des théories scientifiques rivales. On en viendrait ainsi inéluctablement à identifier la vérité au consensus.
Il est, au contraire, nécessaire de défendre l’idée que la vérité est une norme : « Elle est ce que visent nos enquêtes et elle est liée, conceptuellement, de manière essentielle à des notions aussi fondamentales que celles de croyance et de connaissance [6] ». Il est « impossible de fournir une théorie de la justification de nos croyances sans faire appel à la notion de vérité, qui est par conséquent une norme épistémique inéliminable [7] ». Pourtant, la position sceptique, qui menace « la notion même de valeur épistémique », est, sous l’influence des philosophes du soupçon, la philosophie spontanée de notre temps. La responsabilité de Foucault dans cette funeste orientation n’est pas douteuse.
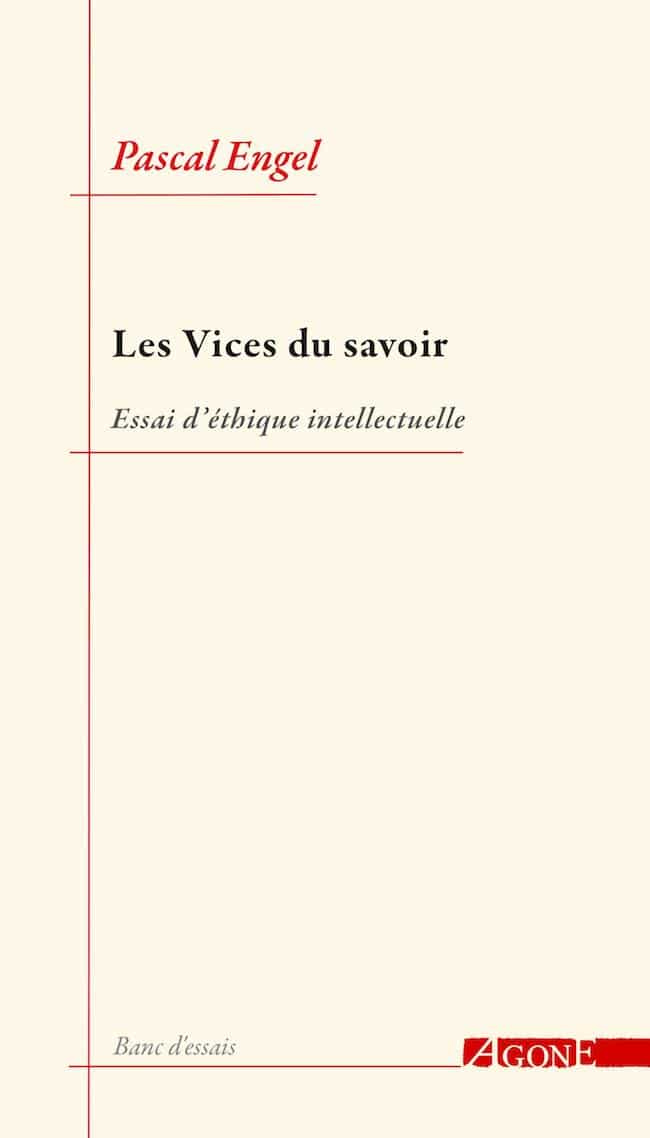
S’il convient de ne pas sous-estimer l’apport de ce dernier dans le domaine de l’archéologie des connaissances, c’est-à-dire dans celui des conditions de production des discours sur la sexualité, la folie ou la prison, on ne doit précisément pas confondre ces questions des conditions d’existence du savoir avec celles, spécifiques à l’épistémologie, qui en déterminent les conditions de vérité. Dans un entretien de 1977, Foucault affirme que « la « vérité » est liée circulairement à des systèmes de pouvoir qui la produisent et la soutiennent, et à des effets de pouvoir qu’elle induit et qui la reconduisent. « Régime » de la vérité [8] ». Dès lors, ce ne sont pas les faits qui nous contraignent mais le « régime de vérité » de la société à laquelle nous appartenons. Ce raisonnement est idéal-typique du constructivisme de la justification.
Dans l’« épistémologie » de Foucault, il n’existe aucune place pour la distinction entre être vrai et être tenu pour vrai. Il est pourtant essentiel de ne pas confondre, comme le souligne Jacques Bouveresse, le caractère historiquement déterminé des moyens dont nous disposons pour décider si une proposition est vraie ou fausse avec « la vérité ou la fausseté de la proposition, qui peut très bien être déterminée sans que nous y soyons pour quelque chose [9] ». Nous sommes donc pleinement d’accord avec Engel lorsque, contre la notion de « régime de vérité », il évoque le triangle assertion-vérité-croyance, qui, précise-t-il, « n’est pas une configuration sociale particulière, produit de conventions, mais la situation de base, celle qui détermine les autres et en est la condition ». Il poursuit : « Les usages de ce triangle peuvent changer : les gens peuvent désirer la vérité et la connaissance, ou la mépriser. […] Mais quoi qu’ils fassent, ce système est en place ».
Engel l’avait rappelé dans un ouvrage antérieur : « Valoriser la vérité, ce n’est pas vouloir croire ce qu’il est utile ou intéressant de croire, c’est valoriser une norme qui est capable de transcender ces intérêts [10] ». Il n’existe cependant nulle obligation de dire ou de croire ce qui est vrai. Ce qui est exigé ne relève pas de la morale. Il s’agit seulement d’accepter, mais c’est essentiel, que « le vrai puisse être la norme de nos pratiques discursives, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les sciences [11] ». Il est certainement plus aisé de défendre les valeurs de solidarité, de tolérance ou de liberté si l’on attribue à la vérité, plutôt qu’une valeur instrumentale, une valeur substantielle. On pourrait même craindre que l’abandon de la distinction entre justification et vérité conduise inéluctablement à la disparition de cette dernière. On voit mal ce que la démocratie aurait à y gagner. En revanche, nous voyons parfaitement l’immense intérêt de ce livre décisif.
-
Pascal Engel, « Savoir et enquêter », En attendant Nadeau, juillet 2019.
-
Pascal Engel, Les lois de l’esprit, Ithaque, 2012, p. 136-137.
-
Pascal Engel, « La leçon de philosophie du président Trump », AOC, 8-1-2019 https://aoc.media/analyse/2019/01/09/lecon-de-philosophie-president-trump/
-
Ibid.
-
Entretien avec Pascal Engel à lire en suivant ce lien.
-
Pascal Engel, La vérité, Hatier, 1998, p. 75.
-
Ibid., p. 78.
-
« Entretien avec Michel Foucault », in Dits et écrits, Gallimard, 1994-2001, p. 160. Un « régime de vérité » est constitué par un système épistémique (les règles de justification des énoncés) et par les dispositifs de pouvoir dans lesquels il s’inscrit.
-
Jacques Bouveresse, « L’objectivité, la connaissance et le pouvoir » in Didier Éribon (dir.), L’infréquentable Michel Foucault, EPEL, 2001, p. 141.
-
Pascal Engel, La vérité, op. cit., p. 78.
-
Pascal Engel et Richard Rorty, À quoi bon la vérité ?, Grasset, 2005, p. 42.












