Hypermondes (6)
Il aura fallu vingt ans pour que Diaspora de Greg Egan, un des plus importants écrivains de science-fiction contemporains, soit traduit. Et on comprend pourquoi : dans ce roman d’exploration spatiale apocalyptique magistralement composé, non seulement l’auteur fonde sa fiction sur des théories scientifiques complexes mais il en fait le sujet même du récit. Rayonnements gamma, neutrons longs et espaces à cinq dimensions, créant suspense et énigmes, invitent à tourner les pages, avec frénésie à certains moments. Parallèlement, à travers une humanité libérée de la chair, Diaspora réfléchit à ce que nous pourrions devenir. Et c’est vertigineux.
Greg Egan, Diaspora. Trad. de l’anglais (Australie) par Francis Lustman. Le Bélial’, 400 p., 22,90 €
En 2975, l’humanité a évolué sous trois formes différentes. Les « enchairés » ont tenu à conserver leur corps, même si des modifications génétiques en ont transformé certains en amphibiens, en volants ou en « onirosinges ». Les « gleisners », eux, ont troqué leur carcasse biologique contre un corps robotique, ce qui leur a permis d’essaimer dans l’espace. Les « citoyens des polis », enfin, ont choisi une humanité numérisée, téléchargée dans des serveurs au potentiel de calcul et de stockage énorme, une humanité virtuellement immortelle, vivant dans les environnements simulés qu’elle désire. Le début du roman de Greg Egan nous fait assister à la naissance d’un citoyen, c’est-à-dire d’un logiciel conscient et intelligent, doté d’émotions et d’un sens moral. Ces pages initiales plongent le lecteur non informaticien dans un environnement inconnu, déstabilisant, dans un texte au contexte absent, à tout le moins effiloché. Il fait la même expérience que « l’orphelin » lancé à la découverte de la polis de Konishi, et peut-être que tout nouveau-né. Pour qui supporterait mal l’expérience, un glossaire à la fin du livre permet de s’y retrouver.
À de nombreuses reprises, le lecteur non physicien ne comprendra pas vraiment ce qu’il lira, comme dans une langue étrangère dont il ne connaîtrait que le vocabulaire courant. Cela n’empêche pas de subodorer, de pressentir, d’entrevoir, et de tout à coup avoir un éclair de compréhension, grâce à une phrase illuminant un espace, une atmosphère, un contexte, que Greg Egan arrive à étendre au domaine de l’infiniment petit – électrons, femtomachines (de 10-15 m) et quarks rouges, verts ou bleus – comme de l’infiniment grand – années-lumière, étoiles habitables et macrosphères.
Le citoyen des polis « orphelin » – le programme dédié l’a créé sans lui attribuer aucune des caractéristiques des citoyens existants – se donne un nom, Yatima, et apprend. Pour des êtres virtuels aux capacités intellectuelles phénoménales, l’amour existe, mais seuls l’art et la science apparaissent comme des champs d’activité durables. Yatima se plonge dans la « Mine de Vérité », une bibliothèque où sont recensés toutes les avancées et problèmes mathématiques en cours. Chaque citoyen peut faire progresser « le front de taille » par ses découvertes.
Diaspora postule qu’à partir d’un certain état les civilisations abandonnent des idées aussi stupides que la guerre et la conquête. Chaque type d’humanité évite donc de s’ingérer dans les affaires des autres. Ce qui n’empêche pas l’émulation, la concurrence. Entre les polis et les gleisners, entre les polis elles-mêmes : Konishi se tourne vers l’abstraction mathématique, Ashton-Laval vers la création artistique, Carter-Zimmermann davantage vers le monde réel, par conséquent la physique. Les interactions restent rares : seuls Yatima et son ami iconoclaste Inoshiro relient les différents groupes en empruntant des gleisners abandonnés pour visiter une communauté d’enchairés. Si la guerre n’existe plus, un cataclysme naturel à l’échelle galactique, menaçant la vie, donc les enchairés, va remettre en cause le statu quo et contraindre l’humanité à un destin commun.
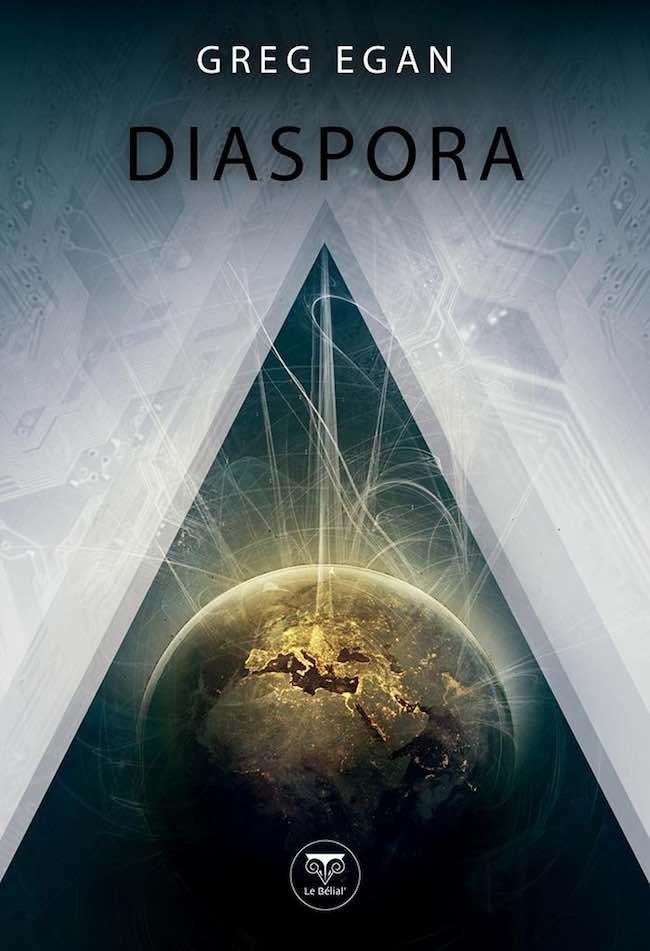
La catastrophe offre à Greg Egan l’occasion d’une description apocalyptique particulièrement éblouissante et d’un panorama des différentes réactions possibles. Yatima y constate avec étonnement que le discours d’un enchairé « semblait faire référence à une famille très virulente de réplicateurs théistes palestiniens ». Diaspora, roman éminemment scientifique, n’est dépourvu ni d’ironie ni d’émotion : le citoyen des polis Inoshiro, après des années passées à tenter de sauver des enchairés – c’est-à-dire à les amener dans les cités virtuelles –, ayant atteint les limites de l’empathie, se réfugie dans un « ensemble hermétique de croyances sur la nature du moi et la futilité de l’effort… y compris la renonciation explicite à tout mode de raisonnement pouvant révéler les failles de son credo de base ». « Inoshiro sourit d’un air béat et tendit les mains. [La] fleur de lotus blanche [qui] s’épanouit au centre de chaque paume » invite à reconnaître le bouddhisme. Yatima préfère émigrer vers Carter-Zimmermann et, pour comprendre le cataclysme, se lancer dans l’exploration spatiale.
La seconde moitié du roman raconte le périple de la polis, sur plusieurs millénaires, ou jusqu’à ce que le concept de temps n’ait plus de sens. On y découvre des mondes et des formes de vie originales, mais on assiste avant tout à une aventure intellectuelle, où les personnages sont sans cesse mis au défi scientifique de comprendre ce qu’ils rencontrent, molécules sous-marines de centaines de mètres de long ou messages encodés dans des neutrons.
Désincarnés, les citoyens sont pourtant loin d’être plats, ils ont leur histoire et leur personnalité. À mesure qu’ils s’éloignent de la Terre, le roman sonde les effets de l’exil et les frontières de l’identité – pour éviter de disparaître ou de se perdre, polis et citoyens se clonent à chaque étape. Orlando, l’enchairé digitalisé au moment du cataclysme, Paolo, son « enfant », Gabriel, le physicien, ou Blanca, l’artiste, ont tous leurs aptitudes et leur mentalité propres, mobilisées à différentes étapes du voyage.
Paradoxalement, la lecture de Diaspora laisse affleurer l’idée que les mots, avec leurs limitations, sont peut-être le meilleur moyen de donner une idée du radicalement différent, d’approcher ce qui est littéralement inmontrable – par exemple, des êtres infiniment petits (et intelligents) tapis dans un espace en quinze dimensions : « On voyait des fleurs sans tige aux multiples couleurs éblouissantes, hypercônes complexes aux pétales arachnéens à quinze dimensions, chacun constituant un labyrinthe fractal de sillons et de capillaires, qui avait quelque chose d’hypnotique. Des monstruosités griffues, des nœuds grouillants de tronçons d’insectes acérés évoquaient une orgie de scorpions décapités ».
Il faut saluer ici la traduction de Francis Lustman, arrivant à exprimer des concepts scientifiques extrêmement complexes tout en conservant la clarté du style, la finesse des dialogues et des réflexions des personnages, l’élégance classique du récit.
Parler de chef-d’œuvre de la science-fiction à propos de Diaspora ne paraît pas excessif tant le roman jongle avec la science la plus pointue, nous offre des personnages complexes et émouvants, des « frœurs » lointains, donne des aperçus de réalités fondamentalement autres, inventés par une imagination exacerbée, s’élance hardiment vers le futur de l’humanité – tant en ce qui concerne le transhumanisme que l’exploration spatiale. Et tout cela dans une forme équilibrée comme une formule mathématique.
Diaspora est peut-être avant tout la célébration en acte de la science et de la raison. « Rien n’est incompréhensible », affirme Paolo. Yatima constate dans les dernières pages : « À la fin des fins, il ne restait que les mathématiques ». Et pourtant Greg Egan écrit des romans.












