Avec Le renard et le Dr Shimamura, son sixième roman et le deuxième traduit en français, Christine Wunnicke produit une très méthodique et très drôle narration en trompe-l’œil : une sorte d’horloge à remonter le temps détraquée, qui permet de revisiter un moment important de la culture germanophone et européenne – rien de moins que l’élaboration de la psychanalyse.
Christine Wunnicke, Le renard et le Dr Shimamura. Trad. de l’allemand par Stéphanie Lux. Jacqueline Chambon, 176 p., 21,50 €
L’histoire que raconte Christine Wunnicke est censée se passer à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, du point de vue du docteur Shimamura, neurologue japonais féru de science allemande. Après avoir soigné des femmes en proie à une « épidémie de renards » dans une province reculée du Japon, il vient avec une bourse de l’empereur étudier la neurologie européenne. D’abord à Paris, alors que Charcot, assisté de La Tourette, se faisait montreur de la « grande hystérie », puis à Berlin, et bien entendu à Vienne, où il rencontre Josef Breuer : celui-là même qui, avec Sigmund Freud, signa les Études sur l’hystérie et retranscrit pour ce faire le cas d’Anna O.

Le neurologue japonais Shimamura Shunishi © D. R.
Quant à Freud lui-même, il apparait certes, mais comme un personnage secondaire, férocement arriviste, intellectuellement peu intéressant et dont le grand mérite est d’avoir traduit Charcot en allemand. Shimamura Shunishi a bel et bien existé (même s’il n’a guère marqué l’histoire de sa discipline, ce qui permet à Christine Wunnicke d’inventer à loisir) et il est vrai aussi que Bertha Pappenheim est le véritable nom d’Anna O. Le lexique de l’époque est là : on croise, côté Japon rural, les incontournables socques et kimonos, la fille très belle d’un riche marchand de poisson, quelques superstitions folkloriques ; côté médecine occidentale, le « tachistoscope » et le « kymographe », ainsi qu’un laboratoire de neuropathologie avec force guillotines pour toutes sortes de cobayes. Mais rien de tout cela n’ancre le roman dans une quelconque vérité localo-historique.
Au contraire, les « référents culturels » agissent comme des accessoires de théâtre et tout est pris dans un mouvement de vrai-faux carnavalesque, avec trompe-l’œil et retournements savoureux. On lit un vrai-faux roman d’ethnologie rurale, avec des renards qui se glissent (en passant par l’oreille) à l’intérieur du corps de femmes désormais un peu lubriques et complètement renardes, au fin fond du Japon d’abord, puis à la Salpêtrière (Charcot lui-même est décrit par le docteur Shimamura comme « rempli de renards jusqu’à la collerette »).
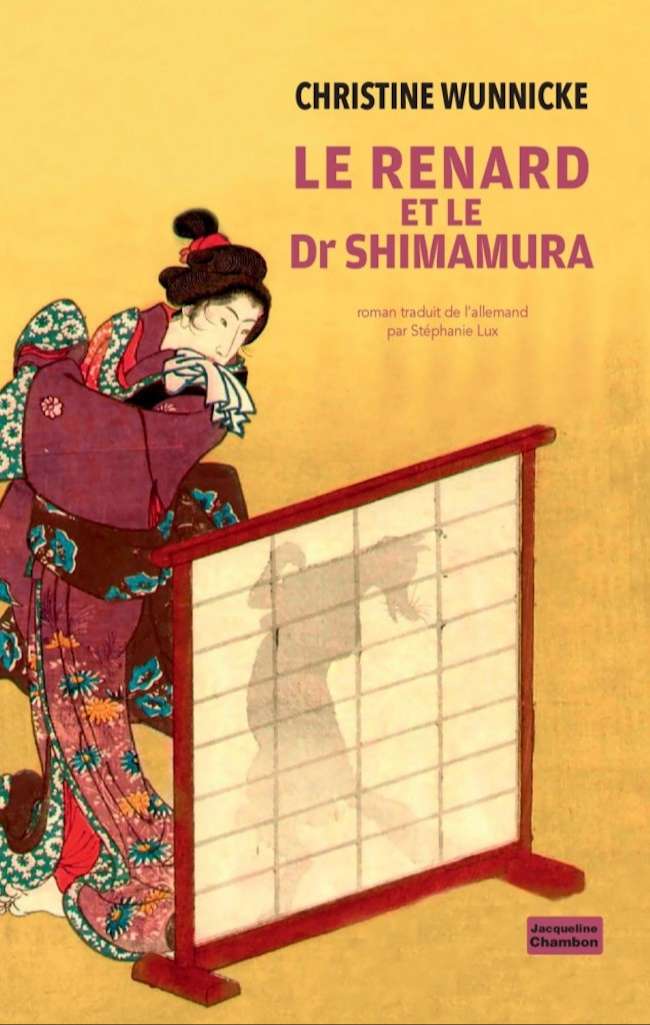
Ensuite, en filigrane, c’est un vrai faux roman policier autour de la mystérieuse disparition d’un jeune et vigoureux adolescent, une nuit d’été, sur fond de frustration sexuelle et de trou de mémoire. Enfin, et surtout, on lit un vrai faux roman de psychanalyse interculturelle, au cours duquel un personnage raconte, sous hypnose, l’affreux récit de son crime (bien sûr passionnel) à un Josef Breuer si sûr de sa germanophone position de surplomb qu’il prend pour factuellement vrai – et tellement exotique – le récit qui lui est fait, sans plus interroger les liens entre fantasme et mémoire, quitte à ce que son malheureux patient le croie définitivement lui aussi. Car, si chez Christine Wunnicke les liens entre la mémoire et les faits sont tout à fait aléatoires, ce n’est pas que la première serait trouée, qu’elle mentirait ou flancherait. C’est d’une part parce que le récit, fût-il de soi, s’appuie moins sur une expérience vécue que sur un autre récit, préexistant, et d’autre part parce que la croyance de l’auditeur entraine celle du locuteur. Alors la machine à remonter le temps achoppe et la mémoire du docteur Shimamura ne cesse de divaguer.
Ainsi Christine Wunnicke revisite-t-elle, grâce au Dr Shimamura, les liens entre hystérie et exploration romanesque, et déroule-t-elle de façon cocasse quelques-unes des mille et une façons d’échouer à dire et à croire autre chose que du dit.












