Le mouvement des Gilets jaunes interroge les politistes mais non sans recours à l’histoire et à la vie des populismes. Plusieurs livres complémentaires permettent de synthétiser la discussion savante, qui remanie ce que tout citoyen politisé et un peu cultivé a su imaginer à partir de reportages, d’images ou des récents résultats électoraux. Le retour aux questions politiques et sociales s’opère donc dans les sages limites d’un ripolinage moins neuf qu’il ne s’annonce. Si l’urgence conceptuelle rend utiles ces livres dont l’objet et les focales sont tous méritoires, il leur manque la possibilité de démontrer la force de ce qui se dit et se répète en chantant, en courant et en dansant : « On est là ! on est là ! on est là !» Soit la présentification immédiate de refus, et cela malgré de sanglantes répressions sur lesquelles on s’interroge nettement moins.
Laurent Jeanpierre, In Girum. Les leçons politiques des ronds-points. La Découverte, 192 p., 12 €
Yann Algan, Elisabeth Beasley, Daniel Cohen et Martial Foucault, Les origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social. Seuil, 208 p., 14 €
Roman Krakovsky, Le populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le monde ? Fayard, 350 p., 22 €
Federico Tarragoni, L’esprit démocratique du populisme. Une nouvelle analyse sociologique. La Découverte, 372 p., 22 €
Prenons d’abord un manuel pour ceux qui n’auraient rien voulu voir ni savoir mais qui doivent comprendre le monde qu’ils régissent sans pour autant faire partie des « grands qui sont au pouvoir ». Leur bréviaire sera d’abord le petit In Girum bourdilien de Laurent Jeanpierre qui tente de définir le mouvement des ronds-points et ses leçons – en creux, faute d’y retrouver les classiques du mouvement social et de nos clivages politiques. Ainsi s’est relocalisée une nouvelle force née d’une impulsion contestatrice dans ces « territoires », ces maillons faibles d’un appareil d’État qui veut bien les gérer mais non point les voir. Médusé, le pouvoir a tenté de ruser après avoir tué les mots de la proximité (les communes, les cantons, les départements donnés en chiffres d’immatriculation, ce que le livre n’aborde pas). Faute d’instituants ou de leaders stables, cette nouvelle forme de protestation se borne à rappeler la violence de l’injustice sociale et l’incohérence politique des gouvernants. Mais rien n’explique cette émergence et cette création d’un « savoir des masses », en perpétuelle évolution, qui n’a rien de dérisoire au vu de la répression toujours plus violente : plus de 2 900 convoqués en justice et, plus grave, des éborgnés, des mutilés qui ont perdu une main, des blessures sans précédent.

Les références, les mots, la méthode ou les considérations de Laurent Jeanpierre ne sont pas faux, seules y manquent la vie et la vivacité des glissements, des reprises qui ont engendré la durabilité du mouvement. Il termine ainsi sur deux hypothèses : noyer le mouvement dans une démocratie locale accrue ou donner le dernier mot à la répression, elle bien instituée.
Bardé de références et de schémas, l’appareil scientifique et institutionnel que déploie le collectif pour Les origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social complète le précédent ouvrage. La radicalité anti-système des émeutiers et manifestants appartient bien à la « société des individus » déjà mise en évidence par nombre d’auteurs et synthétisée pour les enquêtes du CEVIPOF par son directeur, Jérôme Fourquet (L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, 2019). Ce livre fait en outre grand cas de la rupture qui séparerait les « méfiants » des « confiants », face aux institutions et aux politiques. Mais si cette fracture est majeure en période électorale, il semble que l’abus de ce concept présenté comme postérieur aux clivages gauche/droite traditionnels serve plus à les masquer qu’à en avaliser l’effondrement. Le présent recours à Robert Putnam, à James Coleman et en amont à E. C. Banfield (1958) rappelle la vogue de la notion de génération qui évitait jadis de penser en termes de classe. Pour autant, tous les croisements possibles d’attitudes politiques et de sensibilités rendent l’ensemble de cette mosaïque de paramètres stimulant.

Les annexes développent le savoir mobilisé sur toute l’Europe, et même aux États-Unis, et on ne boude pas le rappel de tous les partis politiques et mouvements existants dans une quinzaine de pays de l’Europe politique. Le permanent croisement de variables idéologiques et sociétales au fil de lourds appareils statistiques, les graphiques, permettent d’étayer ce que nous subodorions. Là encore, ce vade-mecum de notre temps conforme ce que doit être une méditation du quotidien, aide à infirmer une idée ou à vérifier une hypothèse.
La tâche de Roman Krakovsky est à risque car il œuvre seul et il tente d’alerter du danger et de la pente « populiste » en Europe de l’Est. Dans une collection qui défend les synthèses, il brasse donc le présent et le passé d’une Europe centrale et sud-européenne, ô combien multiple. S’il cède à quelques simplifications pour la sortie de guerre de 1918, ces années charnière de la fondation de l’Europe contemporaine, sa bibliographie générale est magistrale, et sa volonté de couvrir cet espace sincère. Krakovsky veut nous faire comprendre comment les revendications nationales sont fautrices de dévoiement des patriotismes. Le poids des partis agrariens d’antan puis leurs rapports complexes avec des partis autoritaires comme avec le fascisme et le nazisme, suivi d’une difficile expérimentation du stalinisme, ont toujours perverti les possibles. Dans tous les cas, le simplisme de la langue politique, la réduction de la catégorie de l’opposition à celle d’ennemi de la nation et du régime, ne sont pas propices à la structuration de réflexes démocratiques.
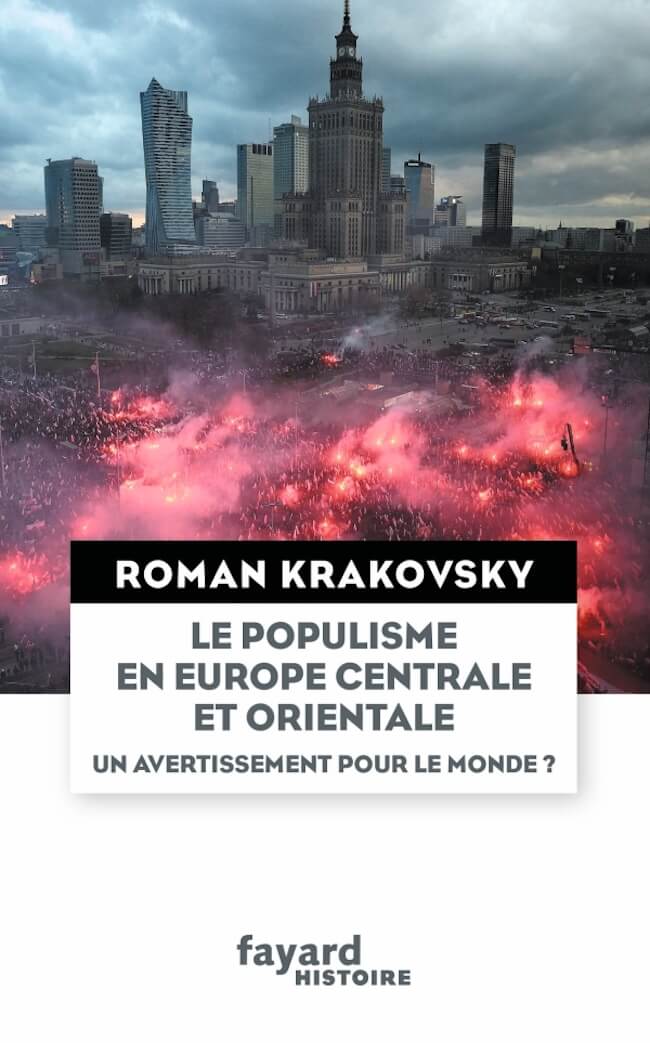
En repartant des narodniki qui allaient au peuple et prônaient la revendication de « la terre et de la liberté » et de la sortie du servage de l’Empire russe, l’auteur passe au XXe siècle pour en venir au poids des présentes complexités. Il esquisse les multiples formes de sortie du communisme, de la Bulgarie aux pays baltes en passant par la Slovaquie ou la Serbie, les gros morceaux de cette géopolitique étant naturellement la Roumanie, la Pologne et la Hongrie. Vaste programme quand l’auteur est autant porté par les craintes que véhicule le politiquement correct (sans vouloir le réduire à cette bannière) devant ces « démocraties illibérales » que par l’analyse précise de la place de droites nationales dures en proie aux libéralismes économiques. Les intérêts contemporains permettent des jeux de force et des rejeux qui se drapent dans la défense de l’intérêt national, rien ne sert de s’en tenir, pour solde de tout compte, à « l’invasion » de migrants. Il n’en reste pas moins que la déception de l’Europe et le mécontentement des couches fort larges qui ne bénéficient pas des rares pôles de développement avérés autour de Varsovie ou de Prague restent dangereux. L’auteur y voit le signe avant-coureur de tous les maux profonds dont pâtit l’Europe (construction politique) et n’a d’autre recours que d’évoquer des figures du passé, tel Ivo Andric (l’auteur nobélisé d’Il est un pont sur la Drina), et de rappeler Misère des petits États d’Europe de l’Est (du Hongrois István Bibó, 1945) ou L’Occident kidnappé (de Milan Kundera, 1983), le passé subi ou assumé n’en finissant pas de se rouvrir.
Plus allègre, plus roboratif – plus optimiste, dirait-on –, est le livre de Federico Tarragoni. Lui aussi développe son argumentaire sur plus de 300 pages mais, en récapitulant une histoire intercontinentale et en scrutant de plus près l’Amérique latine, il se saisit diversement des populismes de gauche et de droite. Il reproche à ses collègues maîtres en « populologie » (science du populisme) d’être généralement trop soumis à un mélange de constats et de jugements subjectifs qui noient les analyses. Ainsi, faute de creuser les concepts et les situations concrètes et vécues, l’anathème fait du populisme un mot fourre-tout sans droit d’inventaire. Le mot peuple, « virtualité en attente » comme il est finalement dit, reste plus encore vacant de ses virtualités dans les discours usuels.
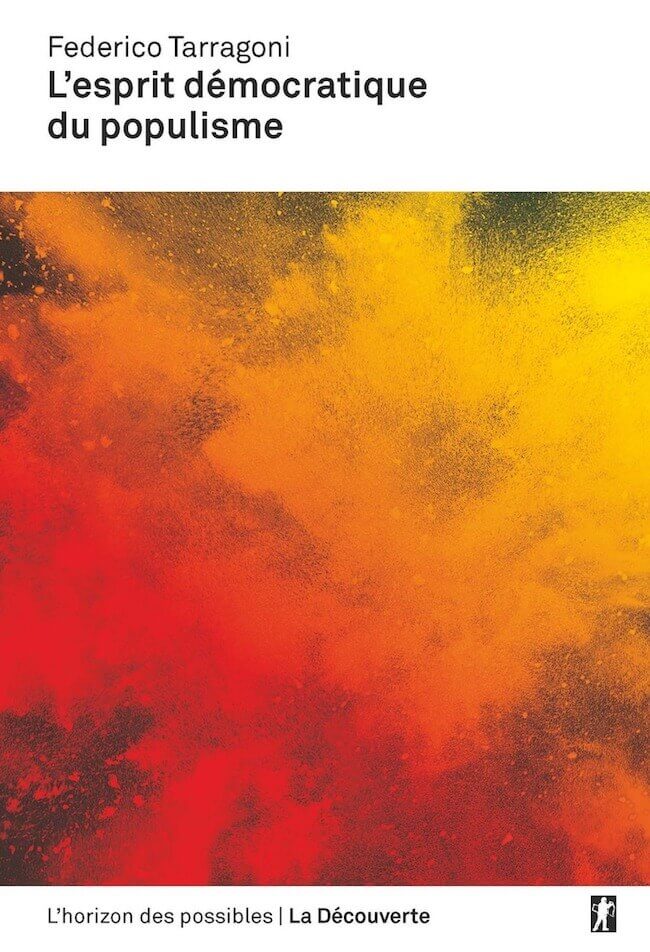
Or, les populismes se déclinent selon leur nature sociale ou pas, le rôle protecteur ou non qu’ils ont pu assurer selon les époques, des variables non réductibles au seul préalable stable : le déficit démocratique des systèmes libéraux antérieurs. Leur solubilité ultérieure dans d’inquiétants autoritarismes et de vrais fascismes est elle-même tributaire d’une histoire mondiale et de conjonctures internationales. L’Amérique du Sud, au vu de la diversité des cas et de ses tempi, éclaire parfaitement le phénomène. Il en va d’abord de la question nationale comme protectrice ou pas, subséquemment de la présence ou non d’une tendance sociale. La disparition de ce facteur sous les coups de l’ultra-libéralisme dé-nature (dirait-on) ces régimes. Le seul recours à quelque chef charismatique est le symptôme, pas le programme, moins encore la raison. Passant des Russes du XIXe siècle aux mouvements agrariens de l’Europe centrale et aux États-Unis de la misère agricole et du People Party des années 1930, Tarragoni reprend les aventures politiques éclatées selon les pays et déclinées en chronologies similaires et dissemblables. Se creuse alors le sens que l’auteur donne aux cas contemporains italiens et espagnols, il parle de « latino-américanisation du vieux continent », ce qui n’annonce ni le meilleur car on sait ce que furent les républiques bananières, ni le pire, ce fantasme sans fond. Cet ouvrage, le plus inventif, le plus riche, le plus synthétique aussi, médite donc un présent ouvert, et on peut lui en savoir gré.





![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)






