Sur les pas oubliés d’Horace Frink, L’œil de la nuit nous invite à redécouvrir l’introduction des thèses psychanalytiques aux États-Unis. À partir de quelques bribes connues, de fragments incomplets de l’existence de ce pionnier de la psychanalyse en Amérique, Pierre Péju imagine son destin. S’il est porté par une écriture engageante et fluide, le livre n’atteint pas l’intensité sensible de certains de ses romans précédents.
Pierre Péju, L’œil de la nuit. Gallimard, 432 p., 22 €
Censé symboliser le représentant d’une époque en pleine mutation et une Amérique confrontée au choc d’une modernité conquérante, le Horace Frink de Pierre Péju peine trop souvent à prendre vie, et son parcours à dépasser une trajectoire individuelle, qui reste plus fabriquée qu’incarnée. Il est dépeint à larges traits, dans un style efficace qui pour autant n’évite pas la surcharge ni parfois les clichés. Présentée comme fondatrice, marquée de blessures, son enfance fait de lui le produit fortuit d’un chevalier d’industrie, talentueux mais véreux, et de la fille d’un médecin cultivé du Michigan. La ruine soudaine du père fait éclater la cellule familiale et, tandis que les parents s’enfuient vers l’ouest dans l’espoir d’échapper à leurs créanciers, Horace et son jeune frère sont confiés à leurs grands-parents. À la détresse de l’abandon s’ajoute le souvenir traumatique de l’incendie où les forges et la fortune paternelles sont parties en fumée, un souvenir qui revient cycliquement visiter la vie adulte de Frink en un leitmotiv lancinant.
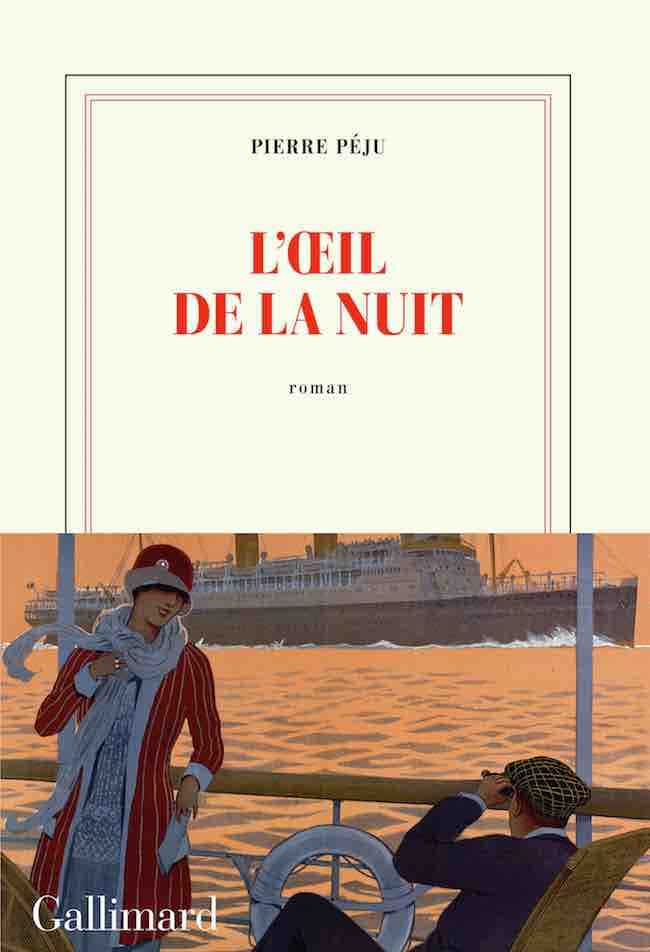
De ces premières années ballotées ne pouvait sortir qu’un homme instable et tiraillé. C’est ce portrait que Pierre Péju s’emploie à dresser. Au contact de son grand-père, Horace s’est dirigé vers la médecine mais, détourné de la chirurgie à la suite d’une mauvaise chute de cheval, il fait le choix de la neurologie et bientôt de la psychanalyse, tantôt sur le divan dans la position du patient, tantôt comme praticien à l’écoute de ses analysants. Dès lors, un mouvement incessant de fascination et de rejet, de confiance et de doute, le porte vers ces théories de l’inconscient qui gagnent l’Amérique. Et cette fascination culmine, en 1909, avec le premier séjour à New York de Sigmund Freud, à qui Horace sert de guide à travers la ville. Cette rencontre avec un homme déjà plus tout jeune, qui découvre l’Amérique flanqué de ses jeunes rivaux, Jung et Ferenczi, est l’occasion de tracer de lui un portrait quelque peu dérisoire, voire farcesque, sans que la nécessité d’une telle parodie paraisse évidente.
Les amours contrastées qui partagent la vie d’Horace Frink et, là aussi, la déstabilisent sont intrinsèquement liées à sa rencontre – intellectuelle, professionnelle – avec la psychanalyse. Si Doris, amie d’enfance et témoin des débuts, épouse compréhensive et sempiternellement miséricordieuse, considère avec suspicion des idées ouvrant sur l’irrationnel, Angelica Bijur, patiente fortunée d’Horace devenue sa maîtresse, accueille avec délice des pratiques qui laissent libre cours à ses tendances manipulatrices. Les deux femmes sont construites en contrepoint l’une de l’autre, l’effacement et l’abnégation de la première répondant au tempérament capricieux de la seconde. C’est ainsi, sans crier gare, qu’Anjelica Bijur rejoint Frink à Vienne, où ce dernier s’est rendu, traversant l’Atlantique, pour entamer une cure psychanalytique avec ce docteur Freud qu’il admire infiniment.

Horace Frink © D. R.
Ce que Pierre Péju évoque de la manière la plus intéressante et la plus subtile, même si la dimension sensible du personnage et l’ensemble de son portrait ne sont pas assez fouillés, c’est la position équivoque – in and out – d’Horace Frink dans le monde ; cette position en déséquilibre permanent, où Frink apparaît tour à tour comme brillant et jamais totalement accepté par ses pairs, accédant aux franges de la haute société et, en réalité, irrémédiablement marginal. Comme nulle part lui-même, jamais chez lui, voué, oublié, à une fin solitaire et tragique. Hormis cette silhouette habitée par l’angoisse qui, malgré tout, se dégage et, selon le vœu de Péju, incarne un certain type d’homme moderne à l’identité vacillante, les poncifs abondent. La psychanalyse, dont on sait pourtant qu’elle intéresse Péju et qu’elle lui est familière, est trop souvent l’objet d’évocations simplistes ; l’Amérique est réduite à un matérialisme caricatural ; Paris, où Frink fait halte, est dépeinte sous des dehors pittoresques, cité cosmopolite et frivole, entre ses ateliers de peintres et ses modèles aux amours faciles, où l’on croise Valery Larbaud à La Rotonde et Sylvia Beach à la librairie Shakespeare and Co. Les protagonistes féminins du roman, de leur côté, manquent de chair.
L’œil de la nuit n’est donc pas le plus réussi des romans de Pierre Péju, qui précédemment a fait preuve d’un réel talent de conteur et dont l’œuvre explore avec curiosité des registres divers. Pourquoi partage-t-on l’effroi d’Étienne Vollard, le libraire de La petite chartreuse, quand, dans une scène marquante, une petite fille se jette sous ses roues pour être percutée par sa camionnette ? Pourquoi la mère de l’enfant, dans sa maternité tâtonnante et difficile, éternellement fuyante, est-elle si convaincante ? Et pourquoi, au contraire, les tourments d’Horace Frink ne nous touchent pas réellement et restent en surface ? Pourquoi Vollard est habité et existe, avec le poids de son corps trop lourd, ses membres maladroits, sa solitude dans un monde peuplé seulement de livres ? C’est difficile à dire mais on ne saurait exclure qu’une certaine facilité d’écriture soit devenue un piège pour un auteur qui, même s’il a du métier, ne parvient pas ici à convaincre.
Reste une silhouette inquiète, perpétuellement au bord du gouffre, et l’un de ces beaux titres dont Pierre Péju a le secret, un titre qui renvoie à l’insomnie glaçante rongeant un homme : L’œil de la nuit.












