On se tromperait en ne voyant en Paolo Rumiz qu’un écrivain voyageur, un reporter marchant ou pédalant, pour découvrir et montrer l’Italie de façon aimable ou divertissante. Appia, son nouveau récit qui paraît en France, est un livre de colère. Contre le mépris que ce pays a pour tout ce qui est au sud de Rome, contre l’incurie de l’État, contre le chaos qu’on a laissé s’installer et perdurer. Mais c’est aussi un livre d’amour pour les êtres rencontrés, les paysages, même défigurés, pour un passé symbolisé ici par une route romaine.
Paolo Rumiz, Appia. Trad. de l’italien par Béatrice Vierne. Arthaud, 528 p., 22,50 €
La colère de Rumiz, on la sentait déjà dans son précédent récit, La légende des montagnes qui naviguent, dans lequel, voyageant dans une Fiat « pot de yaourt », il suivait l’Appenin, du nord au sud, et montrait l’abandon et la désolation que quelques initiatives locales peinaient à compenser. De là à faire de Rumiz un pessimiste ou quelqu’un qui voit tout sous l’angle des victimes, il y a un pas que je ne franchirai pas. Il faut dire d’emblée que lire les récits de Rumiz, c’est s’embarquer, s’émerveiller, rire et rêver. On les lit, d’ailleurs, avec une carte sous les yeux, ou des cartes. Lesquelles manquent cruellement. Pour de mystérieuses raisons, ni la bibliographie ni les cartes [1] permettant de se figurer le parcours ne sont proposées par l’éditeur. Gênant, mais pas rédhibitoire. Rumiz part donc à pied vers Brindisi, en compagnie de quelques curieux comme lui. Parmi eux, Riccardo Carnovalini à qui on doit le guide des vingt-neuf étapes, à la fin de l’ouvrage, grâce auquel on peut se mettre dans les pas des voyageurs et s’arrêter dans quelques lieux très plaisants. La nourriture et la boisson sont souvent évoquées dans le livre et on trouvera quelques noms de pâtes méconnus, quelques recettes comme les freselle à Gallana et des adresses de restaurants ou d’auberges, au cas où.
Oui, au cas où l’on voudrait prendre la Via Appia, de Rome à la côte adriatique et à Brindisi. Cette route parfois pavée, souvent cachée ou effacée par d’autres beaucoup plus récentes, dont l’accès est empêché par des barrières, barbelés, chiens errants hargneux, ronces et autres obstacles, cette route a été celle qui menait à Rome, selon l’adage, mais aussi celle qui partait de Rome. Dans un sens, les voyageurs venus d’Orient, comme Pierre et Paul venus prêcher la nouvelle foi chez les païens de la péninsule, dans l’autre la « Parthica », légion puissante, ordonnée, qui avait besoin d’une route filant droit pour conquérir le monde. Et la Via Appia est, dans certains tronçons, plus droite que le plus monotone des freeways américains. Ce qui n’exclut pas des détours comme on le lit, et comme on peut le voir grâce à la carte tracée à la main par l’auteur, et portant les noms latins des lieux que ses compagnons et lui arpentent.
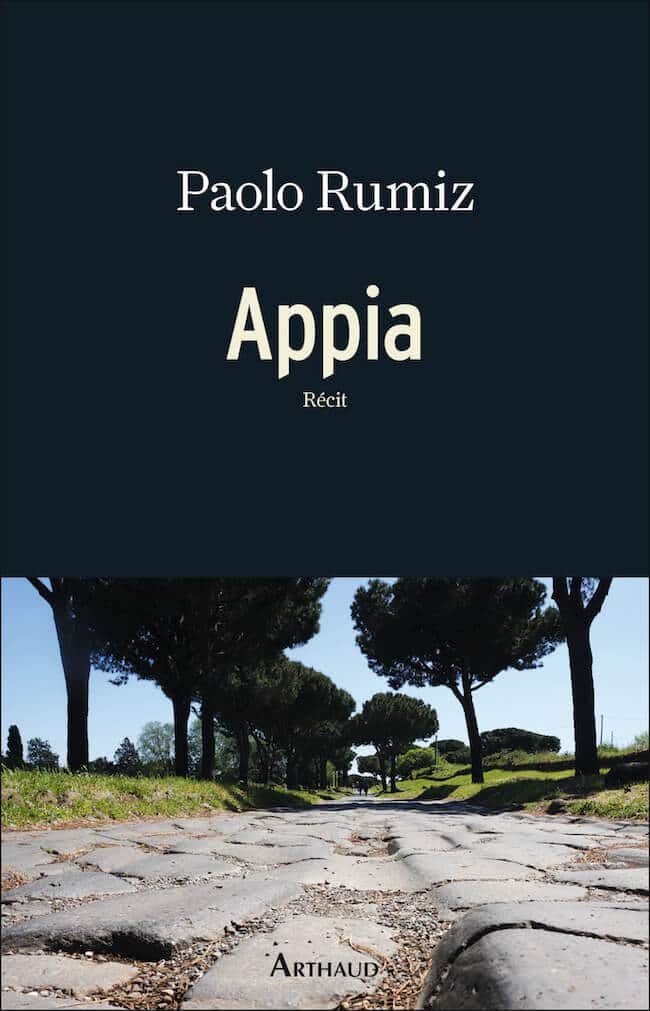
Le voyage se constitue de vingt-neuf étapes d’environ quinze kilomètres chacune. Autant de difficultés, de douleurs, de fatigue, de soif, et de plaisir. Si Rumiz mentionne les bobos divers, les coups de mou et les crampes d’estomac, c’est pour dire que la Via Appia n’est pas le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qu’il n’a pas l’air de porter dans son cœur, c’est aussi pour montrer comment l’écriture nait de la marche, voire des pieds. Lesquels sont humains et fragiles, comme le pays qu’ils traversent. Qu’est-ce que ce voyage, dès lors, sinon « la recherche d’une très ancienne route, ou plutôt une vue en coupe de l’Italie d’aujourd’hui, un carottage dans la stratigraphie la plus profonde de nos vices et de nos vertus ? »
Un pays composite, un chaos et parfois « un festin de démolition ». C’est le premier constat des explorateurs. Outre que la route est souvent masquée par d’autres routes, ou cachée par des obstacles divers, elle est l’objet de convoitises : le pavement a été volé, et posé dans les allées de maisons construites à proximité par des nouveaux riches, des mafieux ou des ignares (la combinaison des trois est envisageable) simplement désireux de montrer ce qu’ils possèdent. Face à ces gens tout droit sortis d’un film de Sorrentino ou d’une berlusconerie quelconque, les archéologues sont des ennemis, des empêcheurs de voler en rond. D’où, dès les premières pages du récit, le parti pris de Rumiz, répondant d’avance aux objections sur son livre : « Un voyage peu ‟patriotique” – diront peut-être certains –, parce qu’il n’omet pas la laideur et lave le linge sale en public plutôt qu’en famille. En réalité, c’est un geste d’amour désespéré envers notre pays et un appel visant à rassembler ce qu’il a de meilleur. »
Ce qu’il a de meilleur est là, après Bénévent, du côté de la Lucanie racontée par Carlo Levi dans Le Christ s’est arrêté à Eboli, du côté des Pouilles, à Oria et ailleurs, dans cette « Italie de l’est », celle qui va de Trieste à Tarente, et que l’auteur met en parallèle avec celle de l’ouest, longée par la Tyrrhénienne, entre Gênes et Reggio. C’est une Italie aux nombreuses influences, aux strates aussi riches qu’un millefeuille : elle est samnite (les premiers à avoir vaincu les Romains à la bataille des Fourches Caudines), elle est grecque, elle est juive (à Venosa, à Oria), elle est arabe, normande, bref, elle ne ressemble nullement à cette Padanie mythique inventée par des démagogues qui hurlent sans cesse à l’invasion. Raconter ce mélange impose aussi une diversité d’angles : « Nous sommes en train de tisser une rhapsodie italienne dans les règles, un tel amalgame d’archéologie, d’enquête, de paysages, d’ethnologie et d’impressions personnelles que je me demande bien comment je vais faire pour coucher tout ça sur le papier. » L’auteur s’inquiète à tort : c’est justement ce chaos qui fait la beauté du livre, cette façon de passer de l’Antiquité au monde moderne, de raconter une rencontre avec les derniers villageois d’un pays de Basilicate, ou avec une archéologue près de Bénévent, qui fait la force du texte. Mais aussi de décrire le désastre de Tarente : une usine ILVA, qui empêche les enfants de jouer dehors, et provoque des milliers de cancers. Les hommes politiques en charge restent incapables d’agir.

Paolo Rumiz © Philippe Matsas/Opale/Leemage
Si j’insiste sur « l’Orient » méconnu ou ignoré de l’Italie, je ne veux pas négliger sa façade du Latium, dont l’écrivain montre à la fois la grandeur et la décadence (terme qui s’applique parfaitement à Capoue, où Hannibal perdit la tête et sans doute plus que cela). Rumiz décrit les marais pontins, asséchés dans les années 1930 pour qu’on y crée des villes comme Sabaudia, Littoria, Aprilia ou Pontinia. Dans cette région, écrit-il, « le fascisme n’est pas un credo politique, c’est une légende ». Aussi terrible que ce soit, il faut prendre en compte cette dimension si l’on veut comprendre l’irrésistible ascension d’un tribun qui fait la tournée électorale des plages, en jouant sur les symboles liés à Mussolini. Les temps italiens sont mêlés, et les codes qui les accompagnent. Quand ils sont perçus, connus. En effet, ce que montre le voyage à travers ce pays, aujourd’hui (le livre a paru en 2015 et le nom de l’actuel ministre de l’Intérieur y apparaît déjà une fois), c’est que l’oubli du passé est assez général : « ce n’est pas le Sud, mais l’Italie tout entière qui a peur de l’Histoire ». Et dans une autre page, Marco, un des compagnons de voyage, pointe le pire : « Le diable, c’est aussi la fin de la mémoire. C’est la chute de la connaissance façon Ulysse. Je suis épouvanté par l’absence de curiosité, par le manque d’éléments ludiques dans l’apprentissage ». Il parle certes des enfants, mais comment ne pas voir que les adultes sont aussi visés ? Sapore, la saveur, n’est pas sans lien avec sapere, savoir. En français, aussi et Roland Barthes l’avait bien montré.
Ainsi, chez les oublieux, s’effacent le nom et l’œuvre positive de Frédéric II, souverain des Pouilles au Moyen Âge dont Rumiz montre qu’il aurait pu incarner les Lumières de façon anticipée. Ainsi s’effacent les « routes, ponts, aqueducs, relais de poste », œuvre des bâtisseurs romains, et le goût des lois, de l’éloquence, hérité des Grecs, et si puissant un temps. Ainsi disparaissent les épigraphes, parfois émouvantes, souvent drôles, qui émaillent les murs sur le chemin, et rappellent certaines séquences du Satyricon ou de Fellini Roma.
Appia est un récit tonique, vivant, pour qui préfère les cartes et la marche au GPS (auquel Rumiz consacre quelques pages bien senties) et à la monotonie des autoroutes. C’est un hymne à l’Italie et, même si le livre paraît en automne, on a envie aussitôt d’aller à l’Irpinia goûter le pecorino carmasciano.
-
On trouvera cependant ces cartes sur la page de son éditeur.












