Pourquoi les histoires de fin du monde se multiplient-elles ? Faut-il les lire comme les constats d’une course à l’abîme inéluctable ? Dans son essai Fabuler la fin du monde, Jean-Paul Engélibert soutient au contraire que les fictions apocalyptiques, loin d’être désespérées, constituent un appel à penser des formes alternatives de société.
Jean-Paul Engélibert, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d’apocalypse. La Découverte, 250 p., 20 €
Dès l’introduction, l’auteur souligne que ces fictions, plus que dans le cataclysme lui-même, se situent dans son après, projetant « dans le futur une pensée du présent. En représentant notre histoire achevée, l’action politique impossible ou dépassée, elles ne renoncent pas à agir. Au contraire, elles inventent une forme contemporaine de tragédie qui place l’humanité sous son propre regard critique ». Selon cette analogie féconde, on pourrait y trouver une double forme de catharsis : parce qu’elles montrent la catastrophe, elles préviendraient contre la route qui y mène et, faisant table rase de la société actuelle, elles installeraient également les conditions émotionnelles et intellectuelles pour penser la suivante. Elles dépasseraient ainsi le « présentisme » mentionné par François Hartog, la croyance à l’impossibilité humaine d’agir sur l’avenir, née de « l’effondrement de l’idée de progrès et surtout la disparition de tout horizon révolutionnaire » dans les dernières années du XXe siècle.
Les œuvres examinées dans Fabuler la fin du monde relèvent aussi bien de ce qu’on classe habituellement dans la science-fiction – Malevil de Robert Merle ou la trilogie MaddAddam de Margaret Atwood – que d’une littérature davantage considérée comme générale – Le dernier monde de Céline Minard, Des anges mineurs d’Antoine Volodine, La route de Cormac McCarthy ou Cosmopolis de Don DeLillo. De même, Jean-Paul Engélibert étudie aussi bien des films d’auteur, Melancholia de Lars von Trier et 4:44 Last Day on Earth d’Abel Ferrara, qu’une série, The Leftovers, ou un film d’animation japonais, Ghost in the Shell. Que de grands écrivains, comme McCarthy et Volodine, s’emparent du thème postapocalyptique montre sa prégnance, mais aussi la porosité des frontières génériques. La fin du monde est partout, comme la SF.

Extrait de la série « The Leftovers ».
Jean-Paul Engélibert montre qu’on peut penser les fictions de l’apocalypse à partir des plus importants intellectuels contemporains, Giorgio Agamben, Deleuze et Guattari, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Bruno Latour et d’autres, afin de mettre en évidence ce qu’elles nous disent de notre société et de nous-mêmes.
Avec la notion d’anthropocène, l’auteur fait d’abord justice de la fatalité climatique. Il « repolitis[e] le concept » en rappelant que l’avènement de l’anthropocène, comme d’un âge où l’être humain affecte radicalement son environnement global, résulte d’« une série de défaites contre les forces du capital ». Il montre que « dès le XIXe siècle, les fictions apocalyptiques répondent à l’entrée dans l’anthropocène », citant Ignis, roman dans lequel Didier de Chousy imagine l’apocalypse comme « l’effet de l’industrie et du progrès ».
« Les fictions de l’apocalypse répliquent aux catastrophes réelles, c’est pourquoi elles se multiplient avec elles ». Cela se vérifie si on pense à la science-fiction française des années 1930, où la montée des fascismes et l’imminence de la guerre ont conduit à des romans apocalyptiques tels Quinzinzinzili de Régis Messac ou La guerre des mouches de Jacques Spitz. Ravage, publié en 1943, illustre parfaitement les thèses de Fabuler la fin du monde : René Barjavel y décrit un cataclysme terrifiant débouchant sur une utopie agraire. À la lecture du très noir La route, Jean-Paul Engélibert émet l’idée passionnante qu’un roman apparemment aussi sombre et désespéré exprime, comme ceux de Minard et de Volodine, « une poétique de l’énergie qui commence avec le refus de toute idée de salut. [Une] énergie tirée du néant qu’on peut appeler l’énergie du désespoir ». Ces « apocalypses immanentes », ce « messianisme sans contenu », permettent de se défaire des carcans et des présupposés du monde présent pour en imaginer un radicalement autre. La fin, d’abord terrible, de La route – la mort de son père livre l’enfant à lui-même, l’abandonne au cadre ultraviolent de la pénurie généralisée – devient, par la grâce d’une rencontre, un espoir possible. Même dans ce monde quasi mort, un futur peut s’écrire. Si l’on sait que McCarthy, âgé de soixante-treize ans ans, a dédié ce livre à son fils de sept ans, on comprend ce qu’il contient de foi en l’avenir, quoi qu’il arrive.

Pour qu’une nouvelle société naisse, il faut un changement dans les priorités. Les récits postapocalyptiques rompent « avec l’ère du calcul qui fait de la valeur d’échange l’étalon de toute chose et de la maximisation du profit la fin de toute action ». Davide Longo dans L’homme vertical et Edward Bond dans ses Pièces de guerre font du sacrifice le moyen de briser le cycle de la violence imposée. Dans les mondes nouveaux mis en place apparaissent des « collectifs hétérogènes, complexes » et fragiles. Ce qui les fait tenir ensemble est la construction, l’attention aux autres – celle de l’enfant de La route aux rares survivants, dans lesquels son père voit avant tout une menace – et l’amour, que l’auteur définit comme « la première forme de l’action […], à la fois résistance à la destruction et force de recomposition. Opposer l’amour à l’apocalypse, c’est affirmer la puissance du romanesque ». L’amour, grâce auquel le cyborg et l’intelligence artificielle de Ghost in the Shell arrivent à changer leurs vies « car il n’y aura pas d’autre monde, mais celui-ci, ses marges, ses interstices – ou ses ruines », écrit Jean-Paul Engélibert, en faisant référence à Nos cabanes de Marielle Macé.
Les fictions de la fin du monde ne se lamentent pas. L’auteur insiste sur cette belle notion que « la littérature ne doit pas consoler » du réel, mais qu’elle pousse à continuer à vivre et à agir même si tout espoir semble perdu. Par nature, la fiction contient la possibilité d’exprimer des paradoxes interdits, par exemple, à « un programme politique ». Les récits apocalyptiques préparent à la perte et affirment la nécessité de l’action après la perte, tout en cherchant à empêcher que celle-ci soit trop grande. Ils n’ont pas vocation à prédire précisément l’avenir, ils affirment plutôt des vérités longues, floues. Ils restent « des œuvres d’imagination, des fantasmagories qui peuvent tout au plus susciter chez les lecteurs des idées, des émotions, des désirs ».
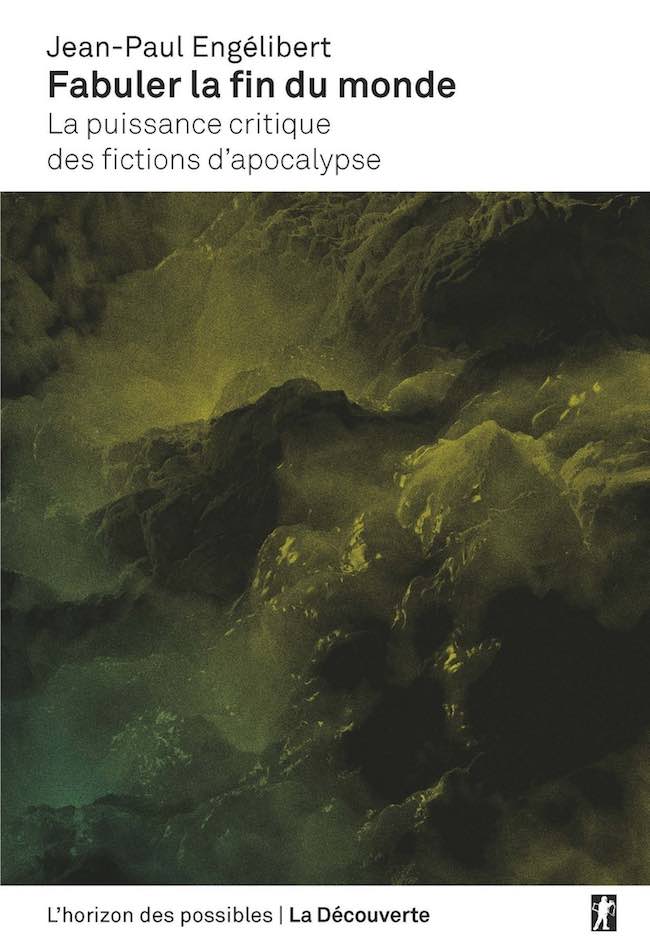
Cependant, « détruire imaginairement notre monde, c’est mettre fin au mode d’existence qu’il implique, c’est rompre le lien à la technique », essayer de le penser hors de ce que l’ultralibéralisme impose comme possible. Si l’on peut décrire une utopie après l’apocalypse, c’est davantage comme horizon que comme achèvement. Les récits de la fin du monde, à travers leur statut de fiction, manifestent que « l’histoire ne se termine jamais : la politique est toujours nécessaire ». Sans proposer de modèle d’action précis, « leur imaginaire rejoint le plus souvent celui des partisans de ce qu’Eric Olin Wright appelle les ‟stratégies intersticielles” de transformation sociale issues, avec plus ou moins de médiations, de l’anarchisme du XIXe siècle ». Ce qui s’exprime aussi, par exemple, dans les romans récents d’Alain Damasio, Les furtifs, ou d’Olivia Rosenthal, Éloge des bâtards.
Fabuler la fin du monde propose une réflexion érudite et extrêmement stimulante sur la manière dont la fiction, y compris dans des œuvres très sombres, utilise ses moyens propres pour participer à l’esquisse d’un avenir possible.










![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

