En 1958, Claude Lévi-Strauss rassemble dix-sept de ses textes pour composer son Anthropologie structurale. Quinze ans plus tard, il réunit dix-sept autres textes dans un ouvrage intitulé Anthropologie structurale deux. Vincent Debaene puise dans la même réserve encore dix-sept articles afin de présenter ce qui constitue en quelque sorte la préhistoire new-yorkaise de l’Anthropologie structurale. L’état « zéro » de ce qui précède, dans l’attente d’un grand livre et de la refondation d’une discipline.
Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale zéro. Édition de Vincent Debaene. Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 352 p., 23 €
Au début des années 1930, jeune agrégé de philosophie, Lévi-Strauss découvre le Brésil et ses Indiens. Moins de dix ans après, il est aux États-Unis, d’abord en tant qu’intellectuel juif « secouru par le plan de sauvetage des universitaires européens financé par la Fondation Rockefeller, puis comme conseiller culturel auprès de l’ambassade de France ». En 1949, il publie Les structures élémentaires de la parenté et, rentré à Paris, pose pour la première fois sa candidature au Collège de France. Celle-ci n’est pas acceptée et cet échec lui pèse beaucoup – comme s’il y avait beaucoup de quadragénaires dans cette prestigieuse institution ! Il est vrai qu’il avait été envoyé au Brésil comme professeur d’université à vingt-sept ans. Tous les textes réunis dans ce volume datent de cette époque new-yorkaise ; ils sont donc antérieurs d’au moins dix ans à la publication de l’Anthropologie structurale.

Claude Lévi-Strauss assis à sa table de travail, une « tête réduite » dans les mains © Jean Marquis/BHVP/Roger-Viollet
Le retour vers Paris n’est pas seulement le choix d’une institution dans laquelle s’investir et d’un lieu où résider. C’est aussi, pour une discipline comme celle de Lévi-Strauss, un choix théorique de première importance, qu’exprime bien la différence des concepts exprimés par les mots « sociologie », « ethnologie », « anthropologie », a fortiori quand cette dernière est dite « structurale ». Les anthropologues américains reprochent à la sociologie française « de manquer de rigueur méthodologique et d’être trop abstraite, insuffisamment attentive aux réalités concrètes du terrain ». Rentrer en France à la fin des années 1940, malgré l’insistance des Américains et de Roman Jakobson pour le retenir, c’était aussi s’engager du côté de la tradition française. Même si Lévi-Strauss se découvre « homme de cabinet plutôt qu’homme de terrain », il ne peut être accusé d’ignorer celui-ci ou même de l’avoir négligé. Un des apports de cet ouvrage est justement de mettre en évidence l’homme de terrain, qu’il avait été et serait sans doute moins ensuite, durant ce que l’on pourrait appeler son époque parisienne.
Soit dit en passant, on s’étonne que, déplorant que le mot « structuralisme » soit devenu trop à la mode, Lévi-Strauss ait renoncé en 1983 à intituler Anthropologie structurale trois le livre qui eut finalement pour titre Le regard éloigné. Comme si la notion même de structuralisme n’était qu’une mode journalistique avec laquelle il n’aurait eu lui-même aucune affinité. Le mot pourtant lui convenait, puisqu’il l’a utilisé pour deux de ses ouvrages fondateurs, du moins l’adjectif structural et le substantif structures. Et il l’a fait par analogie avec la phonologie structurale de Jakobson. On peut comprendre que, par la suite, il ait été irrité par l’usage que firent Lacan ou Barthes de cette notion, puis par son affadissement journalistique. Il reste néanmoins que le mot « structuralisme » avait un sens, comme, dans le domaine pictural, les mots « impressionnisme » et « abstraction », autres créations journalistiques. A contrario, on voit très bien en quoi le mot « post-structuralisme » est dénué de sens, s’appliquant à des auteurs aussi différents que Derrida, Deleuze ou Bruno Latour !
Point encore de structuralisme dans les articles qui constituent Anthropologie structurale zéro – articles qui, contrairement à ce que dit le bandeau publicitaire de l’éditeur, ne sont pas inédits, quoique rédigés en anglais, rarement traduits en français et généralement aussi accessibles que peuvent l’être des articles publiés il y a trois quarts de siècle dans des revues savantes à petite diffusion. Mais pas toujours : celui intitulé « Indian Cosmetics » avait été publié par Claude Imbert en ouverture de son Lévi-Strauss, le passage du Nord-Ouest (L’Herne, 2008). Entre le moment ethnographique des années 1930 au Brésil et celui du théoricien reconnu des années 1960, ce livre nous donne à lire les travaux d’un sociologue français réfugié parmi des anthropologues américains, qui cherche la voie qui fera sa célébrité bien au-delà du champ de l’ethnologie.
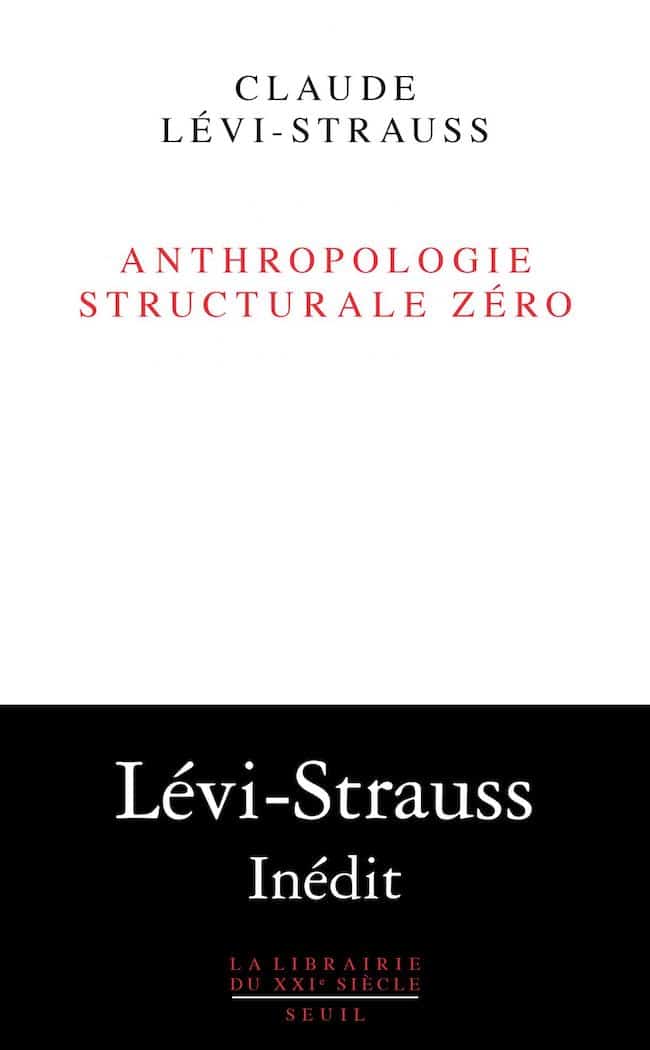
Dans ce nouvel ouvrage fait de textes anciens, le lecteur de Tristes tropiques retrouve des photos qu’il connaissait déjà ainsi que des fragments de texte, des réflexions, des exemples dont il se souvenait et dont il voit désormais comment ils ont été élaborés dans la perspective d’un ouvrage susceptible de figurer dans la collection « Terre humaine ». S’il s’était aventuré dans la masse des Structures élémentaires de la parenté, le lecteur avait vu à quelle élaboration théorique, fondatrice de la démarche structuraliste, avait pu conduire la réflexion sur les relations familiales chez les Indiens nambikwara. Cette petite tribu de probablement moins de deux mille membres ignore sans doute l’usage théorique que fit de sa visite chez elle celui qui y séjourna il y a quatre-vingts ans. Même si elle est peu visible dans la table des matières, elle est très présente dans cette Anthropologie structurale zéro, tant à propos de la guerre et du commerce que lorsqu’il s’agit de décrire « la politique étrangère dans une société primitive » ou « l’usage social des termes de parenté chez les Indiens du Brésil ». Dans chacun de ces chapitres, on retrouve des phrases reprises à l’identique – ce qui n’a rien de surprenant s’agissant d’articles différents publiés à l’origine dans des revues destinées à des publics différents. Et puis, quand on cherche, on ressasse.
Le lecteur d’aujourd’hui est d’abord sensible à l’attachement que cela traduit du « sociologue » (comme Lévi-Strauss se définissait alors) pour cette tribu affectueusement étudiée. Connaissant la suite, il perçoit aussi l’écart entre une description des relations de parenté qui finit par être confuse et la belle clarté qui jaillira de l’invention d’une « anthropologie » pouvant être dite « structurale ».
Au début des années 1950, Lévi-Strauss avait soumis aux éditions Gallimard le manuscrit de son Anthropologie structurale. Brice Parain – le maître en philosophie de cette maison, celui qui avait suggéré à Sartre de remplacer le titre Melancholia par La nausée – lui avait répondu : « Votre pensée n’est pas mûre ». Vincent Debaene ouvre sur cette anecdote sa très belle préface à cette Anthropologie structurale zéro. On pourrait être tenté d’ironiser sur la myopie de Parain en qui, dans le chapitre XVI de l’Anthropologie structurale où il répond avec vigueur à une attaque de Gurvitch, Lévi-Strauss dira voir « un adversaire de l’ethnologie ». Debaene n’a pas cette naïveté, mais le principal intérêt de l’ensemble qu’il publie est précisément de montrer cette pensée pas encore mûre à ceux qui connaissent déjà les chefs-d’œuvre structuralistes. Pour les autres, ce peut être une voie d’accès bien venue.









![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)


