Depuis bientôt trente ans, les éditions Chandeigne réalisent un travail remarquable pour la diffusion en français des littératures de langue portugaise et de la recherche sur les espaces lusophones. Avec ce nouvel opus, elles comblent un vide, puisqu’il n’existait aucune synthèse historique en langue française sur l’Angola. Grâce à cette traduction de A Short History of Modern Angola, paru aux éditions Hurst en 2015, le travail de David Birmingham, professeur émérite de l’université du Kent à Canterbury, pionnier de l’écriture de l’histoire angolaise et de l’histoire sociale de l’Afrique depuis les années 1960, est accessible pour la première fois à un large public francophone.
David Birmingham, Histoire de l’Angola de 1820 à nos jours. Trad. de l’anglais par Gérard Siary. Chandeigne, coll. « Bibliothèque Lusitane », 296 p., 20 €
Écrire une synthèse historique couvrant deux siècles d’histoire d’un territoire aussi vaste que l’Angola moderne sans tomber dans la caricature et la simplification à outrance, voilà qui tenait forcément de la gageure. Il fallait donc tout le métier d’historien et les talents de conteur de David Birmingham pour que cela devienne possible, lui qui nous brosse ce beau panorama de l’histoire moderne de l’Angola avec le recul qu’offre plus d’un demi-siècle de recherches consacrées à l’Angola, à l’Afrique australe [1], au Portugal [2], mais aussi à la Suisse [3].
Ancienne colonie portugaise, l’Angola a accédé tardivement (1975) à l’indépendance, au prix d’une longue guerre de décolonisation (1961-1974) qui a non seulement opposé l’armée coloniale portugaise aux nationalistes angolais, mais a également été marquée par la lutte entre les trois courants du nationalisme angolais [4] pour l’hégémonie sur la nation angolaise et le contrôle du futur État indépendant. Dès l’indépendance, cette lutte fratricide se transforme en une violente guerre civile qui opposera pendant plus de 25 ans le MPLA, au pouvoir depuis 1975, et l’Unita du « rebelle » Jonas Savimbi. C’est d’ailleurs la mort au combat de ce dernier, en février 2002, qui permettra de mettre un terme à la guerre.

Statue Kakongo, Angola ou République démocratique du Congo (XIXe siècle) © Purchase, Louis V. Bell Fund, Mildred Vander Poel Becker Bequest, Amalia Lacroze de Fortabat Gift, and Harris Brisbane Dick Fund, 1996
Depuis la fin de la guerre civile en 2002, le pays a connu une période de boom économique sans précédent, surfant sur la vague haussière des prix du pétrole dans les années 2000, avant de connaître un premier coup de frein dès 2008, puis d’entrer dans une grave crise économique et financière avec la chute des prix du cours du brut dès 2014. C’est durant ces années de boom et d’internationalisation galopante de l’économie angolaise que les inégalités sociales, déjà massives, se sont renforcées, et que des fortunes colossales se sont constituées, comme en témoigne l’ascension fulgurante d’Isabel dos Santos, fille aînée de José Eduardo dos Santos, président de l’Angola de 1979 à 2017, et première femme milliardaire d’Afrique selon le magazine Forbes – la « princesse », comme on la désigne en Angola. En 2017, José Eduardo dos Santos, communément appelé « Zédu », a dû céder la présidence à João Lourenço, un ancien jeune loup de son parti, le MPLA. Depuis son élection, celui-ci n’a eu de cesse de se retourner contre son ancien mentor et sa famille, allant jusqu’à faire inculper et emprisonner José Filomeno dos Santos, fils aîné de « Zédu », pour gestion déloyale et détournement de fonds alors qu’il dirigeait le Fonds souverain créé en 2013 pour soutenir la diversification d’une économie entièrement dépendante de la manne pétrolière. La princesse déchue, quant à elle, est contrainte de gérer ses entreprises et son patrimoine depuis l’étranger pour éviter semblable déconvenue.
Il n’est guère étonnant dès lors que l’Angola ait surtout fait parler de lui pour son lourd passé guerrier, pour ses ressources naturelles ou ses énormes richesses et leur destin souvent très « privatisé ». Le grand mérite du livre de David Birmingham est de mettre en perspective ces dynamiques récentes et de montrer que l’histoire des terroirs historiques qui forment l’Angola moderne, à l’interface entre l’Afrique centrale, l’« Atlantique noir » [5] et l’Afrique australe, est bien plus complexe. Le livre montre aussi à quel point cette complexité sociale, historique et politique est essentielle à la compréhension de la trajectoire actuelle du pays.
Le récit débute en 1820, au moment où la couronne portugaise est sur le point de « perdre » le Brésil, ce qui donnera à la présence portugaise en Afrique australe et occidentale une importance renouvelée – même si le « contrôle » qu’exerce le Portugal sur l’Angola reste très limité jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est la question du commerce qui est au centre de la première partie de l’ouvrage. Un commerce dominé bien sûr par la traite atlantique des esclaves jusqu’à son abolition progressive dans la première moitié du XIXe siècle, traite dont l’auteur montre qu’elle se prolonge en réalité sous différentes formes d’esclavage jusqu’au milieu du XXe siècle : travail forcé, puis travail « sous contrat » qui nourriront l’économie coloniale grâce aux plantations de coton et de café au centre-nord de l’Angola, ou encore de cacao sur les îles des São Tomé et Príncipe.
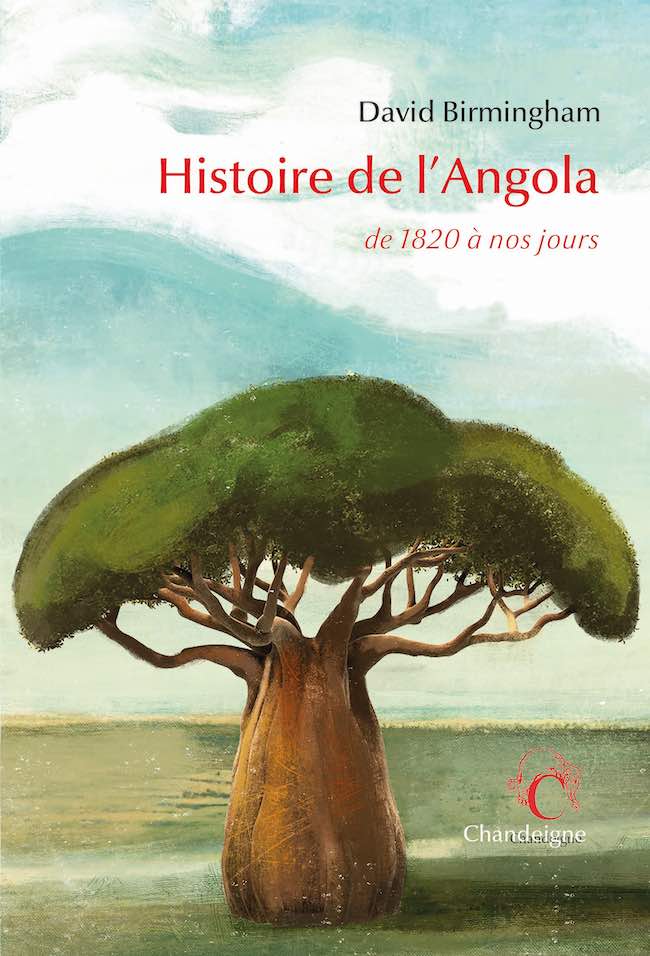
C’est aussi le commerce atlantique qui façonnera durablement la structure sociale de l’Angola. À Luanda, l’ouvrage retrace, à l’aide de plusieurs portraits saisissants, le développement d’une élite marchande, intellectuelle et politique, culturellement et biologiquement métissée. Cette élite créole contrôlera politiquement, économiquement et culturellement l’Angola jusqu’au premier quart du XXe siècle ; et son déclassement racial, culturel, puis politique et économique sera une des matrices du nationalisme angolais tel qu’il se développera à Luanda dans les années 1950. Si les effets du métissage et de la créolisation culturelle se font moins sentir à l’intérieur de l’Angola, Birmingham insiste à juste titre sur l’importance des intermédiaires angolais dans l’histoire de l’insertion du nord (chapitre 3) et du centre du pays (chapitre 4) dans le monde colonial. Là aussi, c’est d’abord dans le commerce que ces intermédiaires se font une place de choix. Mais, à partir de la fin du XIXe siècle, c’est principalement au sein des missions chrétiennes (catholiques et protestantes) qu’émergent plusieurs groupes « d’évolués » qui, eux aussi, joueront un rôle central autant dans la structuration du nationalisme angolais que dans les profondes divisions qui se traduiront par la création de trois mouvements concurrents et se prolongeront dans la guerre civile.
L’importance des métissages et de la créolité dans la fabrique de la société angolaise a pour conséquence notable que, jusqu’au début du XXe siècle, la race et la couleur de peau ne sont pas les critères essentiels qui déterminent le statut social au sein du monde colonial. L’insertion dans les différents commerces de longue distance qui font et défont les richesses des grandes familles angolaises, l’adoption précoce de la langue portugaise comme lingua franca des élites, ou encore le niveau de formation scolaire, sont des marqueurs identitaires plus importants, et ce sont eux qui définissent les contours de l’exclusion sociale. Mais, comme le montre bien l’ouvrage, ces dynamiques changent profondément avec la conquête effective par les troupes coloniales. Celle-ci se fait progressivement, au prix d’un effort militaire colossal, entre 1890 et la fin des années 1910, et elle permet le peuplement progressif de l’Angola par des colons blancs, qui culminera dans l’après-Seconde Guerre mondiale lorsque plusieurs centaines de milliers de Portugais, principalement issus du nord rural et paupérisé de la métropole, seront envoyés en Angola. Ce « blanchiment » progressif, orchestré par la dictature d’António Salazar et l’« État nouveau » qu’il met en place dès les années 1930, aura pour conséquences principales la racialisation des relations sociales, la « mise au travail » brutale d’une partie de la paysannerie par l’institution du travail « sous contrat », l’exclusion croissante des anciennes élites créoles vers les marges du système colonial, et l’apparition de nouvelles élites, notamment formées dans les missions chrétiennes, qui deviennent une des rares voies d’ascension sociale, même si celle-ci reste toute relative jusque dans les années 1960.
Les tensions que génère ce système colonial et le refus obstiné du régime salazariste d’entrevoir une décolonisation négociée culminent en 1961 avec le déclenchement de la guerre anticoloniale. Elles se prolongent après 1975 dans la guerre civile qui, nourrie par la logique de la guerre froide puis par les ressources naturelles (pétrole et diamants) dont regorge le pays, oppose des visions concurrentes de la nation, des représentations antagoniques de ce que devrait être l’Angola indépendant, tout en étant aussi le résultat de l’appétit pour le pouvoir de ses principaux protagonistes. Même si le livre finit sur une note d’espoir avec le changement récent à la tête de l’État, les chapitres consacrés à la deuxième moitié du XXe siècle mettent en lumière les profondes divisions héritées de l’histoire coloniale et postcoloniale du pays.

Statue Chokwe, Angola (avant 1869) © Rogers Fund, 1988
Le mérite principal de David Birmingham dans cet ouvrage réside sans conteste dans sa capacité unique à raconter l’histoire de l’Angola non pas de façon abstraite mais à la hauteur des yeux de ses protagonistes. Il en résulte un récit vif, saisissant, remarquablement bien écrit. Les nombreux portraits et anecdotes dont est émaillé le livre en rendent la lecture agréable tout en conférant au récit un air de « vécu ». En témoigne le portrait, basé sur une courte autobiographie, d’un jeune Angolais du centre du pays, enrôlé dans une plantation locale, puis envoyé à São Tomé avant de rejoindre les côtes du Cameroun en se laissant dériver à bord d’un frêle esquif. Un portrait qui jette d’ailleurs une lumière plutôt positive sur le travail dans les plantations de café et de cacao, et que Birmingham s’empresse de nuancer en se basant sur le fameux rapport Cadbury qui dénonçait, dans les années 1950, les conditions de travail dans les plantations portugaises comme une forme moderne d’esclavage. On retrouve cette passion du récit dans les portraits de femmes, notamment des nombreuses femmes ordinaires qui ont organisé la « survie » du peuple angolais dans les années de guerre civile, portraits à partir desquels l’auteur raconte une version encore trop peu connue de cette histoire.
Un bel ouvrage, donc, qui mérite une diffusion large et qui permettra de mieux faire connaître un pays dont il est si peu question dans l’espace francophone. Le lecteur exigeant pourra regretter le choix de ne pas inclure de notes de bas de page, qui, s’il facilite la lecture, ne permet pas de creuser tel ou tel aspect. Si la bibliographie compense en partie ce manque, elle est très sommaire, et des indications bibliographiques plus précises, par exemple à la fin de chaque chapitre, auraient permis de mieux mettre en valeur les sources (pour la plupart secondaires) dont est tiré le livre. Enfin, on peut regretter parfois que la forme choisie pour le récit prenne le pas sur l’analyse sociologique, laquelle aurait pu permettre un approfondissement de certains thèmes clé. Mais cela se serait peut-être fait au détriment de la lisibilité du livre, un critère essentiel pour un ouvrage dont on espère qu’il donnera envie à certains de ses lecteurs de pousser plus loin la recherche.
-
David Birmingham, Frontline Nationalism in Angola and Mozambique, Londres, James Currey, 1992 ; Empire in Africa. Angola and Its Neighbours, Ohio University Press, 2006.
-
David Birmingham, A Concise History of Portugal, Cambridge University Press, 1993.
-
David Birmingham, Château d’Oex. Mille ans d’histoire suisse, Payot, 2005.
-
Il s’agit du Front national de libération de l’Angola (FNLA), le premier mouvement nationaliste fondé par Holden Roberto parmi les populations bakongo du nord de l’Angola ; du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), qui se formalise en tant que mouvement politique au tout début des années 1960 et qui, sous la houlette de son premier dirigeant, Agostinho Neto, prend le pouvoir au moment de l’indépendance le 11 novembre 1975 ; et de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, mouvement fondé par Jonas Savimbi en 1966.
-
Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Amsterdam, 2017 (1993 pour l’édition originale en anglais).











![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)
