Esquif Poésie (2)
Un grand instant, paru voici quelques mois, rassemble une trentaine de textes qui prennent les formes de la prose ou de la poésie. Il vient de valoir à Olivier Barbarant le prix Apollinaire. Son titre est emprunté à Vladimir Jankélévitch (« Or qu’est-ce que la vie entière perdue dans l’océan de l’éternité, sinon “un grand instant” ? »).
Olivier Barbarant, Un grand instant. Champ Vallon, 135 p., 16 €
Dans l’anthologie parue en 2016 aux éditions Gallimard, dont le titre, Odes dérisoires, reprend celui d’un volume de 1998, figure une brève bio-bibliographie non signée mais probablement rédigée par Olivier Barbarant. Elle cite ses auteurs majeurs, qui sont aussi bien Jaccottet qu’Aragon, Colette que Maïakovski, Claudel que Gide ; affirme qu’« il ne sera jamais moderne » puisqu’ « il ne répugne pas aux sentiments » ; et considère comme poétiques, « quelles qu’en soient les formes », des écrits qui glissent de l’humilité de la méditation à la grande geste de l’histoire, du temps qu’il fait sur un jardin aux déchirements des révolutions, de la métaphysique de l’amour à son évocation sans complaisance.
Le prix Apollinaire est l’occasion de chanter les louanges de ce volume qui restitue une partie de l’œuvre antérieure et qui commence par « Les confidences d’Eurydice », un grand poème. Écrit par un homme plutôt attiré dans ses amours par le masculin, il fait bouger les clivages traditionnels des genres. Quant à Eurydice, provisoire rescapée des Enfers, elle devient, sous sa plume, une jeune femme d’une incroyable insolence, en avance sur les combats féministes actuels, puisque le livre où elle apparaît, Les parquets du ciel, date de 1991. « C’est le retour de la femme enfin dans la parole. » Celle qui « depuis tout ce temps sous la terre » sort « du métro un peu trop peinte et chancelante » sur ses talons hauts et va commencer son séjour parmi les vivants en s’attablant à une terrasse de café et en buvant du vin blanc !
« Après vingt-cinq siècles de silence j’ai de quoi nourrir la conversation
D’ailleurs je ne sais pas si on a noté ou pu avoir le temps mais pour une fois ce n’est pas mon mari qui cause
Son vieux numéro pour tout dire commençait sérieusement à nous lasser
Surtout pour moi imaginez-vous toujours à jouer les contrepoids dans son système d’ascenseur
C’est bien beau d’endormir les monstres et de visiter les sous-sols mais jamais un mot pour les seconds rôles
Et pour chanter les saisons en Enfer il faut savoir peut-être qui l’on y met
Ainsi tout à l’heure dans un wagon j’ai brisé d’un air négligent sa guitare
Plus de pierres à faire frémir on va enfin s’amuser »
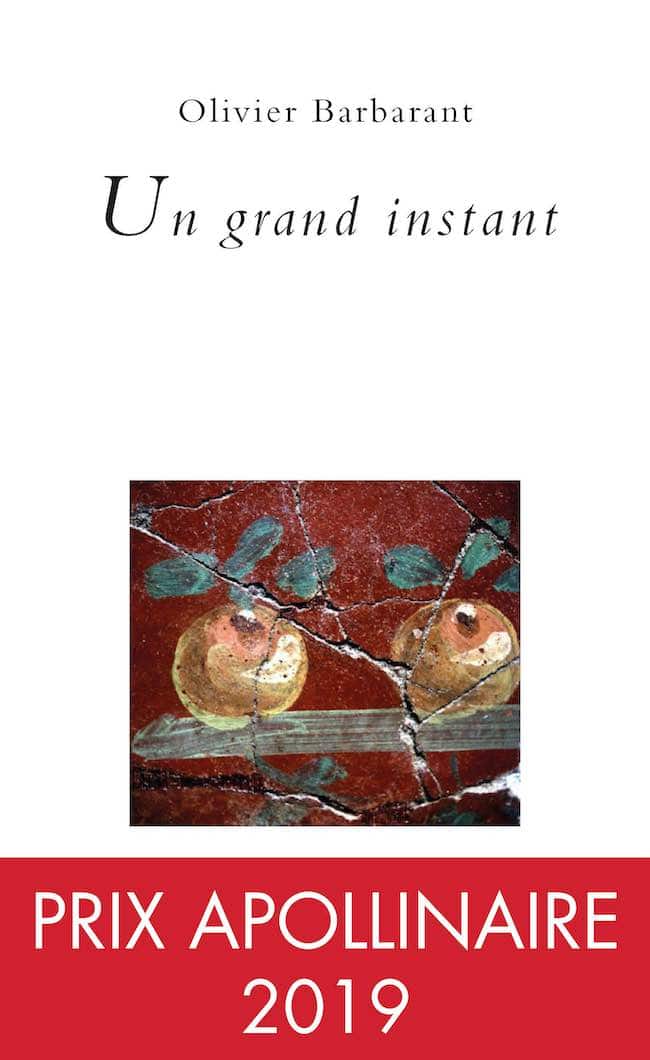
Dans les Odes dérisoires paraît une autre femme au nom mythique de Bérénice. Est-ce à dire qu’elles sont toutes deux inventées et qu’elles n’ont de réel que l’insistance qu’elles mettent à imprégner notre mémoire ? Et de fait, Bérénice, au milieu des amants célébrés par l’auteur – « Je pouvais laisser après moi toute une meute d’hommes » –, peut faire figure d’ombre légère, à peine retenue et presque inadvenue :
« Qu’est-ce qu’on tient entre ses bras quand on les ferme sur la douceur ?
[…]
Qu’est-ce qu’on adore dans un paysage de peau
Dans le premier sourire
La lèvre rose retroussée sur le givre des dents j’invente
Des images glissant comme des bas de robes
Je dénombre de pauvres choses peut-être j’entasse des lieux communs
Un carrefour du cœur qu’importe il paraît
Qu’on ne doit plus parler d’amour mais je n’y crois guère »
La compréhension complice d’une Eurydice condamnée trop longtemps à jouer les seconds rôles, le surgissement bouleversant d’une Bérénice enfin aimée loin du « surplis des toges », l’invocation à Anna Akhmatova, qui savait « tenir le mal dans les rives de ses vers » et une brève évocation d’Ophélie, bref, l’incontestable et lumineuse présence du féminin est d’autant plus délicieuse chez Olivier Barbarant qu’elle n’est pas si fréquente dans la poésie, du moins sous cette forme. Elle donne à ses écrits une dimension supplémentaire, un tremblé, une incertitude bien venue : « Ce qui hésite seul existe », écrit d’ailleurs le poète, capable de trouver un juste équilibre entre les extrêmes, « la tessiture à mi-chemin de la merveille et du malheur » ; d’adopter un ton familier : « Je deviendrai élégiaque que ça ne m’étonnerait pas » ; « et je refroisse un peu ému mon tralalère » ; de bâtir des phrases laisses pour dire la liesse comme la souffrance : « Même la folie d’Ophélie si je m’écoutais j’en ferais des javas ».
Un grand instant s’ouvre sur l’« eau lente et cachée » de la rivière de l’Aube, dont le « beau bras d’eau », à Ramerupt, est suffisamment troublé par la craie pour que les corps s’y baignent nus « sans déranger l’ordre public ». Pour cela, peut-être, il donne une sensation de fluidité, avec de grands moments de calme et de respiration, concrétisés par l’espace accordé aux titres des poèmes, seuls sur la page blanche, ou ramassés, d’une condensation extrême, comme par exemple dans « Naissance du printemps rue Lafayette » où les statues de la gare du Nord ont des visages à la fois inexpressifs et « chargés de la violence tapie par quoi se reconnaît le sacré ».
Passent dans les phrases, dans les vers rimés ou non, dans les versets, les paragraphes, dans les alexandrins égarés parmi les proses (« C’est un coin de Paris bâti comme un village »), la beauté des rencontres et des soifs amoureuses, un paysage urbain au lever du soleil, la saleté des agonies, l’horreur des migrations, le soi qui se défend d’être avalé par le chaos…
Le ton, souvent, est à la modestie, au scepticisme, il arrive que l’auteur s’exprime, parlant de lui, à la troisième personne, comme s’il était un autre. Parce qu’il est obligé d’exercer le métier d’être ému, dans ses articles de critique, ou d’en savoir autant qu’une bibliothèque lors de prises de parole en public au cours desquelles on lui demande ce qu’il faut lire et ce qu’il pense sur tel ou tel sujet, il se dédouble et se moque de lui-même. « Il est célébré — un peu. On le pose dans un train, on l’accueille dans une gare, on le réinstalle à une tribune. Il parle et on l’applaudit. »
Probablement constitué à partir d’extraits du journal de l’auteur (je n’ai pas pu me procurer celui qu’il publia en 1999 aux éditions Champ Vallon, Journal imprécis, 1986-1998), mais condensé et sans date, Un grand instant propose les temps forts, profonds, « de pure présence », « où vivre s’illumine », et qui, pour être « grands », n’en sont pas moins « dérisoires » : « Toute une vie : des gouttes d’eau, un peu de perles ». C’est dans cette opposition, cette apparente contradiction, que se situe la poésie d’Oliver Barbarant, qui « maugrée » le « miracle » et préfère la neutralité du mot instant au lyrisme presque religieux du si beau mot d’épiphanie, rendu célèbre par James Joyce. Parce qu’il n’attend « nul rédempteur », qu’il a grandi dans un foyer attaché aux valeurs républicaines et à la laïcité, dont son père, Jean-Claude Barbarant, fut un ardent défenseur au sein de la FEN (Fédération de l’Éducation nationale) ?

© Delphine Presles
Ainsi chargé, le frêle esquif de la poésie ne sombre pas et arrive à bon port, comme les pauvres embarcations de migrants plus chanceux que d’autres. « Ceux-là dont je parle ont fini cependant par toucher aux pays des brumes vraies, des briques qui tiennent aux maisons, des mers grises. Ils ont bâti des cabanes avec des débris, fragiles comme des goûters d’enfants. »
Loin de Barbarant l’idée d’une poésie militante. La sienne se tient plutôt à hauteur d’humain, honteuse « des larmes dans les cils » quand elle évoque la clocharde qui chante devant une vitrine en portant « un petit carton réclamant à manger / avec des fautes d’orthographe » ou « les corps sous les housses / orange ou blanches ». Elle tourne autour d’une « source en feu » et préfère « l’abondance des détours et des voiles ». Bien que sa faim, son ambition soit d’« écrire un poème […] en forme d’apocalypse », elle ne capture que « le pauvre fantôme d’un chant qui ne sera jamais que l’ombre / De celui qu’on porte en soi ».
Voilà bien tout l’attrait d’un poète qui n’a de goût que pour la banalité fastueuse et la pérennité des grands instants, rendus tels par l’amour des corps et de la poésie quelquefois apte à garder la trace du « mur de bambous que le vent froisse, l’instant libéré de l’horloge, du décompte, le présent arrondi, un merle au bec jaune qui s’ébroue sur le banc ».
« Tous les vrais poètes sont en H », déclare-t-il avec drôlerie, en épigraphe au dernier texte : Homère, Hugo… ou Haudelaire et Haragon. D’Eurydice renaissante au pessimisme presque heureux de la fin homérique en passant par Rémi, Hadad et quelques autres, la boucle est provisoirement bouclée : Olivier Barbarant a composé un tout de ses « moments brisés », de ses « instants de pure présence », avant de nous quitter sur un salut au vieux Sieur H : « Quand il fut ainsi dans la nuit, quand il n’eut plus de la beauté que le sel rongeur du remords, il sut que sa formation était accomplie. Il pouvait compter sur l’éblouissement, il pouvait compter sur sa perte ; il pouvait composer l’Iliade : il le fit. » Le paragraphe clôt le volume et résume en deux phrases à la fois la fascination pour le poème majuscule et l’acceptation douloureuse de son impossibilité. C’est dit. Olivier Barbarant ne se prend pas pour Homère et sa poésie n’est pas « hénaurme ». Elle ne nous en est que plus nécessaire.












