En se concentrant sur de petits éléments qu’on néglige d’ordinaire, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne de Mika Biermann et Trois réputations de Jérémie Gindre illustrent l’un et l’autre l’art de la forme brève pour dire une vie. Que ce soit celle d’une figure considérable de la peinture ou celles des anonymes réfractaires imaginés par Jérémie Gindre, ces vies tiennent à une position face au monde, et singulièrement devant la nature, l’espace. Mika Biermann comme Jérémie Gindre usent d’une fantaisie pince-sans-rire et d’une écriture aussi précise que simple en apparence pour montrer la richesse d’existences peu communes.
Mika Biermann, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne. Anacharsis, 96 p., 12 €
Jérémie Gindre, Trois réputations. Zoé, 128 p., 15 €
Se limiter à trois jours permet sans doute à Mika Biermann de présenter, non la vie de Paul Cézanne, mais son Cézanne à lui. Le plus souvent désigné par « Peintre Paul », son héros vit avant tout ce que c’est qu’être peintre, profondément, au quotidien, loin des grandes phrases sur l’art. Nous suivons un Cézanne déjà âgé, qui n’a plus besoin de peindre pour vivre, mais qui y pense pourtant tout le temps, un Cézanne ermite, ours, obsédé par le travail, rejetant tout ce et tous ceux qui l’en éloignent. On voit son fils Paul lui rendre visite ; le docteur Gachet qui ne peut s’empêcher de parler, surtout de la peinture du « Hollandais » que Cézanne déteste ; son ami Auguste Renoir, dont il juge les natures mortes « blettes, ses portraits mièvres et ses paysages mous comme du coton qu’on met dans ses oreilles pour dormir ».
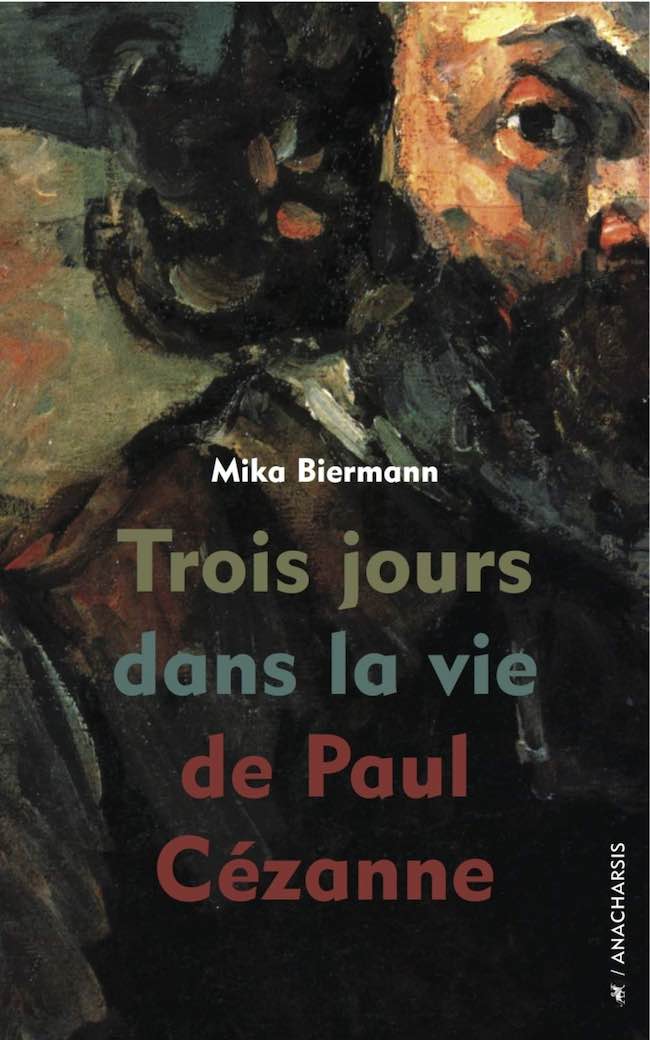
Peintre Paul repousse tout le monde parce qu’il doit aller sur le motif, le cou scié par le chevalet, suant sous le soleil de Provence. La nature n’est pas idéalisée : « Marcher dans la campagne n’est pas un vrai plaisir. Un devoir, plutôt, et comme tout devoir ça n’en finit jamais. Il les a pris tous, les sentiers, on n’arrive jamais nulle part ». Le peintre est également représenté sans complaisance : « C’est un vieil homme à la moustache épaissie par la morve, à la barbe raide de graisse de mouton, à la corolle de cheveux blancs s’écartant des oreilles comme les orties s’écartent du chou-fleur, aux dents gâtées par l’insouciance du fumeur, aux yeux chassieux où les images du monde ne rentrent qu’à reculons. […] Le monde a déposé sa poussière sur l’homme ; il chaloupe en marchant. Son inaptitude à vivre le fait sourire comme un idiot », mais Peintre Paul n’est jamais ridicule. Si Mika Biermann use de son talent burlesque, éprouvé dans Un Blanc, Booming ou Roi., c’est pour nettoyer comme à la térébenthine les croûtes de vernis déposées par la postérité, nous rendre l’artiste vivant, l’homme proche, représenter la création dans sa réalité, sans apprêts : un vieux type bougon qui dort mal, qui a envie de tuer les fillettes lui expliquant que les ciels doivent être bleus, mais qui peint envers et contre tout.
Sous le crâne du misanthrope, le monde s’agite, il s’intéresse à d’autres êtres. Dans la garrigue, il rencontre une sphinge, un faune, le Minotaure et Pégase, même une muse, sans qu’on puisse savoir si tout se passe dans sa tête, s’il voit ainsi de banals paysans ou vagabonds, s’il s’agit de « vrais » sphinge, faune, minotaure, ou de métaphores de l’art bien cabossées, comme lui : la sphinge ressemble à « un chat qui vomit », le faune est « délabré ». Peintre Paul aime aussi les chiens. On en croise plusieurs, le début du récit livre une saisissante représentation canine du monde, avec tout l’art de l’image condensée propre à Mika Biermann. Le lecteur s’amuse et se sent bien parce qu’on lui fait toucher, à l’intérieur des contraintes de l’art ou de l’âge, une vraie liberté.
Peintre Paul fait une autre rencontre davantage lestée du poids de l’existence : une jeune femme pauvre, battue, pour qui il ne pourra pas faire grand-chose, sinon finir ce paysage du bois du Pissou derrière lequel elle vit. Peindre, encore et toujours. Faire ce pour quoi il est fait, et ce qui lui permet d’exprimer son humanité. Ces Trois jours dans la vie de Paul Cézanne sont, le temps de moins de cent pages, une ouverture sur la lumière, l’humour et la force de la création, inextricablement mêlés à la trivialité de la vie. Toutes choses qu’on devrait retrouver dans J’, le grand roman familial de Mika Biermann, à paraître aux éditions P.O.L à une date indéterminée.
Si l’on oublie que Peintre Paul est célèbre, sa vie ressemble à celle des personnages de Jérémie Gindre. Trois réputations se compose de trois longues nouvelles, chacune sous-titrée « Vie et mort de… » et traitant de trois personnages qui s’entêtent à suivre leur voie à l’écart de la société des hommes, si peu enviable que cette voie puisse sembler. Trois vies dans une nature dure et intranquille : les Alpes, une île tropicale aride, le désert mojave.
Chaque récit est raconté par une voix, à la fois familière et admirablement composée. La sœur aînée de Jeannie Plantier parle à un journaliste ; le neveu du voisin et employeur de Bill Ronson raconte l’histoire à son chien ; la biographie d’Epke Janssen est narrée par ce qui ressemble à un guide touristique. Des voix qui teintent le récit d’une légère ironie, et qui laissent aux personnages leur part d’énigme.

Jeannie a consacré sa vie au refus du barrage qui, en créant le lac de Serre-Ponçon, engloutit son village. Contrairement à tous et en particulier à son père, elle tiendra bon. Paradoxalement, elle trouve un apaisement dans l’appel de la foudre (la nouvelle s’intitule « Foudre sur conifère »), en accord avec une personnalité intense. Émigrant, Epke Janssen n’a pas trouvé sa place en Amérique, sinon sur la petite île de La Blanquilla, où il s’est bâti un palais du facteur Cheval caribéen, « Castel Chiflo », le château du fou. Chercheur d’or, Bill Ronson n’a reçu, en guise de trésor, que sa barre à mine à travers le crâne. Il a survécu, son trou dans la tête est devenu objet d’intérêt et de curiosité (« Un trou célèbre »).
Tenus pour fous par ceux qui les côtoient, ces trois personnages vivent à bien des égards comme des clochards. De chaque côté du château tropical d’Epke, les histoires de Jeanne et de Bill se répondent : tous deux croient à la puissance de la foudre, écrivent des lettres et subissent des accidents liés au feu et aux arbres. La police détruit leurs pauvres campements pour les chasser – scènes qui évoquent irrésistiblement la situation des migrants d’aujourd’hui – et ils angoissent leurs contemporains. Mais Bill est-il plus incohérent que l’administration qui lui interdit d’acheter le terrain désertique sur lequel il vit parce que sa mère était suédoise ?
Sans prétendre en percer le mystère intérieur, Jérémie Gindre montre la grandeur de ces vies d’apparence misérable, leur dignité, leur cohérence, leur capacité à agir – même dans le chaos que Jeannie et Bill portent avec eux, même dans la marge et le dénuement. « Au cours de sa vie recluse, il avait développé une doctrine austère, basée sur la rancune et le dépassement de soi », est-il écrit d’Epke Janssen. Des existences qui se déroulent dans et par la nature. Sur la montagne où Jeannie subsiste dans un dépouillement radical, à La Blanquilla dont l’aridité guérit la tuberculose d’Epke, dans le désert mojave où Bill grave des pierres et dont, Moïse inversé, il est chassé.
Explorer tout ce que l’art doit à l’obstination – Mika Biermann a une formation de peintre et travaille au musée des Beaux-Arts de Marseille, tandis que Jérémie Gindre est artiste plasticien –, montrer par la narration ce que l’explication ne peut dire, amener le sourire aux lèvres, enchanter durant quelques heures, le temps d’une veillée, c’est ce que font ces deux livres. Et ils laissent des images rémanentes : Cézanne, le pinceau levé devant son chevalet, Jeannie Plantier brandissant un bâton de ski au sommet d’un mélèze, Epke Janssen sculptant des planètes de pierre à l’abri des remparts de son château, Bill Ronson écrivant sur le désert à la barre à mine.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








