Censés dissoudre le lien social ou renforcer l’individualisme marchand, les droits de l’homme seraient la cause des maux actuels les plus variés. Éloignés de toute tentation polémique, la politiste Justine Lacroix et le philosophe Jean-Yves Pranchère ont entrepris une dissection méthodique de ces condamnations, anciennes ou contemporaines. Ramassé et incisif, leur ouvrage s’interroge sur les circulations surprenantes entre ces critiques émanant d’intellectuels aux positions parfois diamétralement opposées. En attendant Nadeau a rencontré les deux chercheurs et s’est demandé avec eux si les droits de l’homme rendaient idiot.
Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, Les droits de l’homme rendent-ils idiot ? Seuil, 112 p., 11,80 €
Alors que les libertés fondamentales paraissent enracinées dans les démocraties libérales, vous présentez votre livre comme une défense des droits de l’homme. Pourriez-vous évoquer les facteurs qui les mettraient en danger aujourd’hui ?
Justine Lacroix. Les facteurs ne se situent pas principalement dans le champ qui nous a occupés, à savoir le champ intellectuel ou celui de la philosophie politique. Ce qui met en danger aujourd’hui les droits de l’homme en Europe, c’est l’émergence, d’une part, de régimes autoritaires dans certains pays de l’Union européenne et, d’autre part, l’action conjuguée de deux phénomènes. D’abord la demande grandissante de sécurité, qu’on observe depuis une quinzaine d’années. Mais aussi le refus grandissant de l’immigration. Cela conduit, même dans nos démocraties dites occidentales, à une mise sous pression de certains des principes de l’État de droit.
Comment expliquez-vous ce basculement, à première vue inattendu, dans un pays comme la France ?
Jean-Yves Pranchère. Ce qui permet de parler d’une érosion des droits, c’est la cohabitation dans un même espace physique de gens qui en réalité n’appartiennent pas aux mêmes espaces de droits. Par exemple, la cohabitation de la personne cinquantenaire de classe moyenne, qui a bénéficié toute sa vie des protections de l’État social, et du SDF dont on ne va tout de même pas dire qu’il jouit d’une prolifération de droits… Un diagnostic sur l’état des droits ne peut pas séparer la question des libertés publiques et celle des droits sociaux.

Justine Lacroix et Jean-Yves Panchère © J. Panconi
Quelle serait votre définition minimale des droits de l’homme ?
Jean-Yves Pranchère. Les droits de l’homme sont les droits fondateurs de ce que Claude Lefort appelle l’espace social démocratique. De ce point de vue, ils sont d’abord des droits civils et politiques qui définissent les conditions à partir desquelles est possible l’espace social auquel des individus peuvent participer librement et à égalité. Qu’on soit de droite ou de gauche, cette définition est la même. Mais l’exigence de l’égalité civile et politique fait immédiatement surgir la question des conditions sociales de sa réalisation. C’est ici que vont se départager des interprétations minimalistes des droits de l’homme, par exemple libertariennes – le droit de propriété est le seul droit absolu, on s’en tient là – et des interprétations qu’on qualifiera de démocratiques et de socialistes (au sens d’un socialisme démocratique) selon lesquelles, si les droits de l’homme ne se prolongent pas dans un droit social, ce défaut de réalisation va rétroagir négativement sur les libertés politiques et défaire la démocratie. Claude Lefort a pu ainsi montrer que, dès l’origine, les droits de l’homme appellent les droits sociaux comme leur condition même d’existence.
Justine Lacroix. Les droits de l’homme sont les conditions de notre participation au débat sur l’organisation de nos sociétés. Conditions qui supposent la liberté d’association, la liberté d’expression, ainsi qu’une certaine forme de propriété de soi, qui ne se confondent pas forcément avec l’appropriation capitaliste. Habermas parlait d’une « co-originarité » des droits de l’homme et de la démocratie : ils ne sont pas dissociables.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les principales critiques des droits de l’homme dans le champ intellectuel ?
Justine Lacroix. La première, c’est l’idée que les droits de l’homme sont indissociables de l’ordre marchand. Cette critique venait à l’origine plutôt de l’extrême gauche anticapitaliste, mais elle est aujourd’hui recyclée dans d’autres mouvances puisqu’on voit désormais de jeunes conservateurs marier anticapitalisme et conservatisme dans une commune opposition aux droits de l’individu. La deuxième idée, qui est un grand classique de la pensée conservatrice, consiste à dire que les droits de l’homme sont facteurs de dissolution des communautés familiales et des réseaux d’entraide, de tout ce qui fait sens du point de vue social.
Jean-Yves Pranchère. Alors que, dans notre précédent livre (Le procès des droits de l’homme. Généalogie du scepticisme démocratique, Seuil, 2016), nous avions tenté de montrer dans l’histoire des critiques des droits de l’homme la présence de positions idéal-typiques correspondant à des dispositifs théoriques incompatibles, ce livre-ci part du constat de la répétition des mêmes arguments (et donc de la présence d’une même matrice théorique) au sein des critiques contemporaines, en dépit de la diversité des positions politiques. Régis Debray se veut de gauche, Pierre Manent assume une position conservatrice, Marcel Gauchet se définit comme un républicain soucieux de la volonté générale. Ces prises de position se distribuent sur l’échiquier politique mais la masse argumentaire est à peu près identique et produit un étrange (et inquiétant) effet de consensus. On voit des partisans d’un capitalisme nationaliste reprendre la critique des droits de l’homme comme forme du néolibéralisme, tandis que des idéologues qui se prétendent anticapitalistes et libertaires, comme Jean-Claude Michéa, répètent une critique des droits de l’homme platement communautarienne, pour ne pas dire autoritaire.
Historiquement, on a pu observer à partir des années 1980 une coïncidence entre la dégradation des droits sociaux et la valorisation des droits de l’homme dans le discours politique. Que pensez-vous de cet alignement ?
Jean-Yves Pranchère. Je pense que c’est un effet d’optique. Si on reprend les choses dans l’ordre, les premiers laboratoires du néolibéralisme n’ont rien à voir avec les droits de l’homme : ce sont le Chili de Pinochet, l’Amérique de Reagan, l’Angleterre de Thatcher. On est là face à des politiciens qui n’ont aucune affection pour les droits de l’homme ! Ils acceptent l’usage de la torture en Amérique latine et soutiennent l’apartheid en Afrique du Sud.
Justine Lacroix. Ni aucune sympathie pour les droits des femmes ou des homosexuels.
Jean-Yves Pranchère. Ce qui fait l’alignement, c’est la chute du mur de Berlin, qui impose le lexique des droits de l’homme comme langage commun du refus de l’oppression. Au même moment, l’amplification de la construction européenne produit toutes sortes de progrès tangibles, y compris sociaux. On n’est pas encore dans une phase univoque de délitement de l’État social. Mais, dans la seconde moitié des années 1990, quand les sociaux-démocrates sont au pouvoir partout en Europe et qu’ils ne retravaillent pas les traités, les tendances libérales et sociales entrent en divergence. Ce sont les années des succès électoraux du néolibéralisme de gauche, à la Blair ou à la Clinton. Les années 2000 seront le début de la montée en puissance, intensifiée dans la dernière décennie, d’un abandon progressif des droits de l’homme par les porteurs du projet néolibéral. George W. Bush parle encore le langage des droits de l’homme mais il mène déjà une politique qui est contraire à ce langage : qu’on pense à Guantanamo et à Abu Ghraïb.
Justine Lacroix. On a longtemps pu penser que libéralisme politique et libéralisme économique étaient indissociables. Mais cette phase a été relativement courte et on voit un divorce s’opérer aujourd’hui entre ces deux concepts. Beaucoup de régimes autoritaires et conservateurs sur le plan des mœurs pratiquent une forme de libéralisme économique. Viktor Orbán par exemple, mis à part quelques mesures, respecte les règles économiques qui sont attendues par l’Union européenne.
Selon vous, l’une des faiblesses des critiques des droits de l’homme, c’est qu’on ne voit pas sur quelles politiques concrètes elles pourraient déboucher. Il n’y a aucune alternative politique aux droits de l’homme ?
Justine Lacroix. Là où les critiques ne sont pas cohérentes, c’est quand des arguments contre ce qui forme le cœur des droits de l’homme sont suivis, en dernière minute, de l’affirmation selon laquelle « nous sommes évidemment pour les droits de l’homme » ! D’où une complainte lancinante sur un individu qui serait soi-disant atomisé, couplée à un appel à renouer des liens sociaux dont les modalités ne sont guère précisées. Il existe une incantation à restaurer le sens du collectif tout en méprisant tout ce qui peut se dessiner comme nouvelles formes collectives aujourd’hui, qu’il s’agisse du foisonnement associatif ou des nouvelles formes d’engagement.
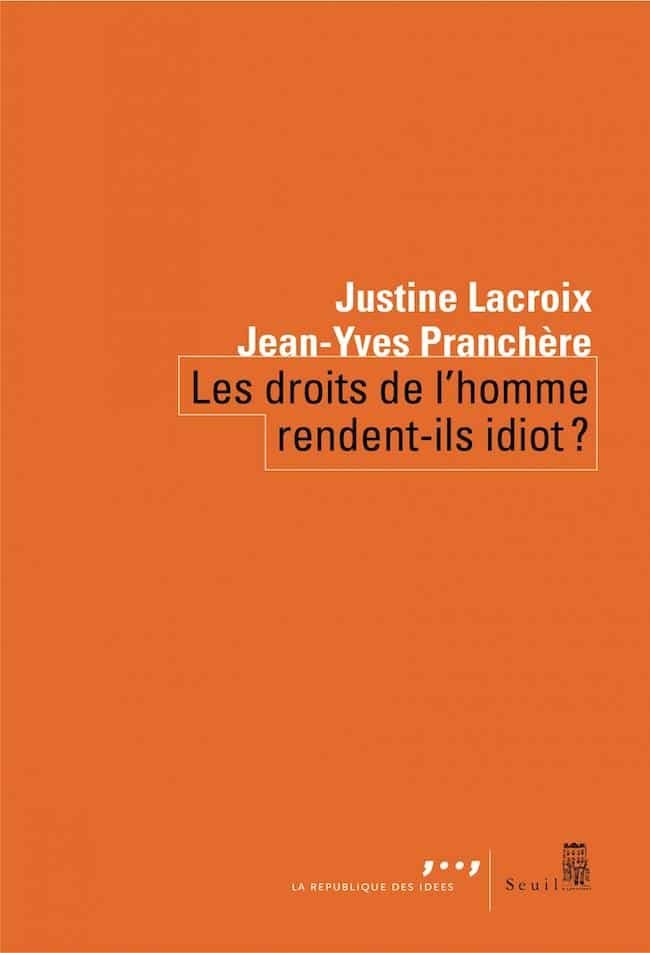
Vous parlez du foisonnement de la vie associative mais, sans non plus souscrire à l’idée d’une irrésistible montée de l’individualisme, on observe quand même ces vingt-cinq dernières années une érosion des formes d’engagement dans la vie collective. Comment faire pour défendre les droits de l’homme tout en s’attaquant à l’illimitation du projet d’autonomie individuelle ?
Jean-Yves Pranchère. Cette notion d’illimitation du projet d’autonomie individuelle n’est-elle pas un leurre qui masque une réalité tout autre, celle de l’adaptation des individus aux réquisits de leur concurrence sur le marché ? N’oublions pas que la visée néolibérale est de remplacer la démocratie politique, jugée dangereuse en raison de ses tendances socialistes, par la souveraineté du consommateur et par une société d’individus qui sont des entrepreneurs d’eux-mêmes. Or, des individus entrepreneurs d’eux-mêmes doivent obéir aux ordres du marché sur lequel ils doivent investir intelligemment le capital qu’ils sont eux-mêmes. Il est étrange de voir là-dedans une autonomie individuelle illimitée, en oubliant d’ailleurs que toute autonomie est autolimitation.
Oui, mais c’est vendu comme tel…
Jean-Yves Pranchère. Mais c’est extrêmement problématique ! Il faut distinguer l’autonomie individuelle de la prise en charge par soi-même de sa propre exploitation, même si la frontière est difficile à tracer.
Justine Lacroix. Quand les critiques des droits de l’homme mettent en cause l’illimitation du sujet individuel, ils s’insurgent contre la propension à traduire toute forme de désir en un « droit à ». Ce n’est évidemment pas tout à fait faux. Il existe bien des « pathologies de la liberté juridique » pour parler comme Axel Honneth. Il existe une tendance dans nos sociétés à considérer que la résolution de tous les problèmes sociaux va passer par le droit. L’autre sens de l’illimitation renvoie à la critique conservatrice qui a été faite de l’extension des droits dans la période récente. Soyons clairs, on parle ici des droits des femmes et surtout de ceux des homosexuels. Pourtant, le choix de redéfinir l’institution du mariage n’est pas, au sens strict, une question qui relève d’un droit individuel qui serait devenu « illimité ». Il s’agit d’un choix politique qui considère que cette institution, définie par des devoirs et des responsabilités, établit un lien entre deux personnes qui peuvent être de sexe différent ou pas. C’est un choix collectif.
Jean-Yves Pranchère. L’expression « mariage pour tous » a pu brouiller ce point en suggérant qu’on ne discutait pas des conditions d’accès à l’institution familiale, mais de l’extension d’une liberté individuelle. L’institution matrimoniale a toujours été un damier à cases multiples. Nous y avons ajouté, à bon droit, une case « mariage homosexuel ».
Néanmoins, la grammaire mise en avant dans ces questions est toujours celle des droits de l’homme. C’est toujours la question des libertés fondamentales qui doivent être respectées.
Justine Lacroix. Il y a un accroissement de la logique contentieuse. Les juristes le montrent. Mais cela répond beaucoup plus à la logique du client consommateur qu’à la logique de l’individu autonome protégé par les droits de l’homme.
Justement, vous écrivez que c’est l’approfondissement de la logique des droits de l’homme qui permet de lutter contre cette logique proliférante du consommateur juridique…
Justine Lacroix. Les droits de l’homme ne sont jamais uniquement les droits de l’individu. Ce sont les droits de l’homme en société. C’est le droit d’entrer en relation les uns avec les autres. Tous les droits qui sont énumérés dans la Déclaration ne visent que ça. La liberté d’expression, la liberté d’association, de libre communication, le droit de contracter mariage… Ce sont les droits de l’homme en société et c’est pourquoi ils peuvent être limités pour préserver la vie collective. Des libertés individuelles pourraient être par exemple limitées au nom de la protection de l’environnement. Il n’y a pas de contradiction avec la logique des droits de l’homme. Le but, c’est de faire vivre un monde commun. On a de plus en plus aujourd’hui une vision tronquée de l’individualisme qui est confondue avec la figure du consommateur égoïste ne se préoccupant que de son bien-être immédiat. L’individualisme est quand même une notion beaucoup plus riche. L’individu n’est souverain qu’en société et qu’avec d’autres.
À ce sujet, vous semblez opérer un retour à Castoriadis à la fin du livre. Le surgissement de cet auteur plutôt associé à des théories révolutionnaires peut surprendre.
Jean-Yves Pranchère. Nous sommes plus proches de Lefort que de Castoriadis. Mais Castoriadis avait le mérite de ne pas dissocier autonomie individuelle et autonomie collective. Les contemporains qui recyclent la critique des démocraties libérales faite par Castoriadis, mais en imputant aux droits de l’homme les maux que Castoriadis expliquait par la dynamique du Capital, falsifient le sens de cette critique (qui voulait radicaliser la démocratie et non la protéger contre elle-même). Cette conception repose sur une dissociation entre autonomie individuelle et autonomie collective que refusait Castoriadis. Si on veut que les droits de l’homme soient une dimension de la liberté collective (qui suppose l’intégration sociale) et ne soient pas un simple cadre de ce que Robert Castel appelait « l’individualisme négatif », il faut poser la question de savoir quel est le type d’autonomie collective qui permet l’autonomie individuelle.
Propos recueillis par Ulysse Baratin et Bamdad Shaban





![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)






