D’un côté, une histoire de la philosophie de l’architecture, proposant de penser celle-ci comme « anarchitecture » et possibilité d’un espace public. De l’autre, une série d’enquêtes sociologiques menées auprès des populations pauvres de Roubaix, où il s’agit de voir comment l’espace périphérique de la relégation est produit en « espace populaire » par ses habitants. Deux théories et pratiques très différentes face au « capitalisme comme logique spatiale ».
Ludger Schwarte, Philosophie de l’architecture. Trad. de l’allemand par Olivier Mannoni. Zones, 528 p., 25 €
Collectif Rosa Bonheur, La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire. Amsterdam, 240 p., 18 €
Le lien entre l’ouvrage de Ludger Schwarte, professeur de philosophie à la Kunstakademie de Düsseldorf (dont Olivier Mannoni a également traduit cette année les Notes pour un art futur aux Presses du Réel), et celui du collectif Rosa Bonheur (université de Lille, laboratoire Clersé) est certes ténu, mais il constitue une porte d’entrée à l’un et l’autre de ces essais. Disons que le second pourrait être l’illustration et le complément bienvenus d’une intuition développée par Schwarte au centre de sa somme, mais que ce dernier n’illustre guère, son texte étant tout théorique : « Les espaces publics ne sont pas seulement ceux où l’on trouve asile face à la force exécutive de l’État. Ils sont aussi, par contrecoup, des espaces de protection contre un climat étouffant, des espaces dans lesquels une autre morale s’applique, comme à la piscine dans laquelle on se dénude, aux thermes où l’on s’assoit ensemble pour suer, ou dans les banquets où l’on distribue et offre de la nourriture. »
Les sociologues du collectif Rosa Bonheur ont plongé dans ces espaces qu’ils nomment non pas publics mais « populaires » (on dira plus tard si l’on peut glisser de l’un à l’autre), en partant d’un questionnement simple et en allant contre les idées reçues : « que font les gens qui ne font rien ? » Pas besoin d’être réellement « pauvre » pour connaître la réponse, il suffit par exemple d’être un intellectuel précaire de la classe moyenne : ceux « qui ne font rien » travaillent, souvent autant et parfois plus que des salariés. Sauf qu’ils ne gagnent pas leur vie avec ce travail, parce que la valeur n’en est pas – ou plus – reconnue et qu’ils en font donc cadeau.

« Le Parlement du public », une idée de Ludger Schwarte réalisée avec les architectes Hütten et Paläste pour l’exposition « Making Things Public » de Bruno Latour et Peter Weibel au ZKM (2005) © Photo Frank Hülsbömer
L’enquête de terrain dans les quartiers défavorisés de Roubaix montre ainsi ce que l’on savait déjà : les chômeurs ne le sont pas par plaisir d’être assistés mais, puisque l’économie marchande et salariée ne veut pas de leur travail et qu’en outre la protection sociale est détricotée année après année, ils développent une autre forme d’économie, dite « de subsistance » : « Précisément parce que les protections propres à la société salariale viennent à manquer, les classes populaires confinées aux marges du salariat se sont organisées, à des degrés divers, pour y produire des ressources de subsistance en lien avec ce qui reste des systèmes institutionnels de protection sociale. Ainsi, des formes de travail orientées par des rationalités plus sociales qu’économiques refont surface. Les liens de réciprocité et les ressources de l’ancrage acquièrent une nouvelle centralité dans la production des modes d’intégration et de sécurisation des parcours ». Bien entendu, Roubaix est aussi un cas très particulier de désindustrialisation brutale ayant créé des masses de « travailleurs “en trop » ».
On va rencontrer au fil des enquêtes divers types de travail, qui créent de nouveaux espaces : au domicile (pour les femmes), à ciel ouvert pour les « garagistes de rue » et dans tous les « espaces délaissés » par la fermeture des anciens lieux de production. Et aussi ce que les auteurs appellent une « centralité », contre l’idée de « ghetto » ou de « communautarisme », mais également contre celle d’« assignation à résidence par les pouvoir publics » : à savoir que « la géographie résidentielle des familles populaires […] est aussi caractérisée par une grande proximité résidentielle avec la parenté ». Ainsi, « Zoubida, dont la famille nombreuse est ancrée à Roubaix depuis trois générations, n’a jamais envisagé d’acheter dans une autre ville », et de même « Soraya […] vit et travaille aujourd’hui dans le quartier de son enfance, où vivaient déjà ses grands-parents ». Une stratégie économique fondée sur la solidarité et la proximité dont on ne peut pas franchement dire qu’elles caractérisent un certain type de cultures ou de religions. Mais si cet espace populaire se perçoit comme « central » et comme « ancrage », il est aussi ouvert et « point de départ », puisque « ceux qui parviennent à conserver un emploi s’installent dans les villes environnantes ».
Au-delà de l’enquête de terrain et de ses mille anecdotes éclairantes, le collectif Rosa Bonheur élabore une théorie de la « morale » de l’espace populaire : en cela, il donne un contenu possible à la morale qu’évoque Schwarte pour définir certains espaces publics, mais sans tomber dans « une vision irénique des solidarités populaires ». La ville vue d’en bas cherche en effet aussi à expliquer l’échec de vingt-cinq ans de « politiques urbaines de métropolisation et de rénovation des quartiers populaires » avec leur « dogme de la mixité sociale ». C’est, arguent les auteurs, que ce type de politique bien intentionnée mine précisément la « centralité populaire » et détruit les structures d’ancrage, car « les dispositifs de responsabilisation sont en réalité souvent des dispositifs de culpabilisation ».
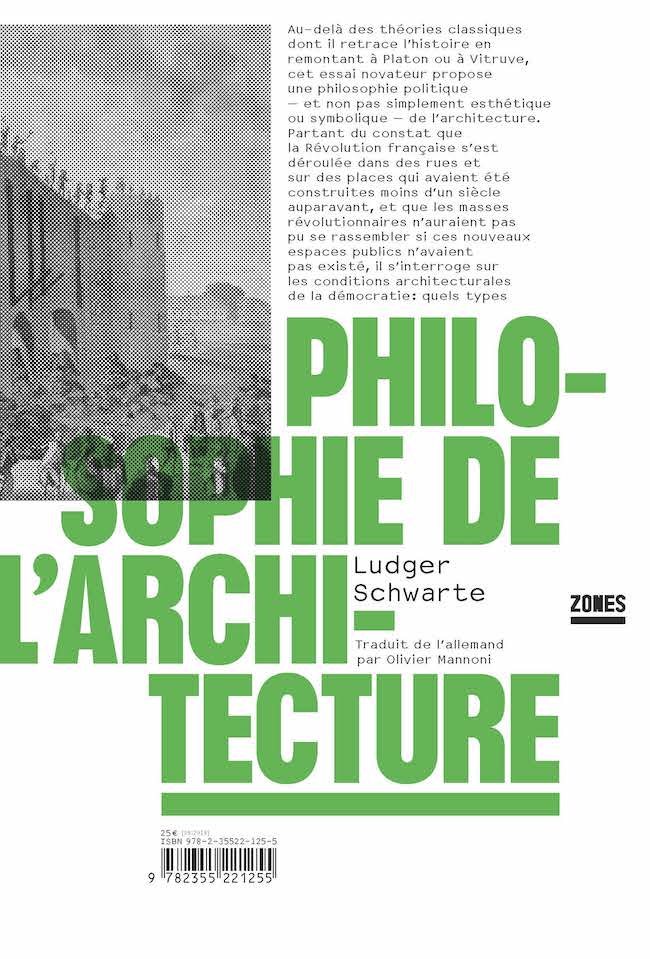
Ainsi le travail de subsistance sera-t-il par exemple jugé illégal ou encadré par des associations pour devenir travail gratuit. Or « le sentiment d’injustice attaché à la perception des discriminations provoque en retour un travail sur soi qui s’apparente à une forme de contre-investissement symbolique, via l’attachement à des valeurs et des principes à même de restaurer une honorabilité et un prestige : le travail, sa division genrée, l’identification au quartier et à sa communauté d’origine, le sentiment religieux sont les supports de production d’appartenances respectables et ont des effets sécurisants ». Cette morale suppose également un « contrat implicite avec les administrations, enjointes à se comporter comme de ‟bonnes autorités » ». C’est précisément ce contrat que bafouent les politiques actuelles fondées (dans le meilleur des cas) sur un schéma progressiste : en réalité, comme l’écrivent les auteurs, l’articulation de cette économie morale populaire et d’une « visée émancipatrice demeure à l’état de potentialité ». S’il y a politique, elle est plutôt de résistance à des gouvernances perçues comme ayant trahi le contrat moral.
Si l’essai des sociologues de Lille dit ce qui est, l’ouvrage du philosophe de Düsseldorf dit, quant à lui, ce qui pourrait être. Aussi bien, on pourra trouver sa perception de l’espace public assez idéaliste – il s’en est défendu dans plusieurs entretiens. L’espace public déborde de fait largement l’espace populaire. Il est un ouvroir plutôt qu’une réalité : « l’architecture de l’espace public […] rend possibles les processus performatifs de toute nature, et pas seulement la manifestation de pouvoir ou la transgression de l’ordre. Dans les espaces publics, les situations expérimentales les plus différentes peuvent se produire. On peut y mettre en scène des parcours de la production d’expériences créatrices de collectifs. Il faut donc considérer comme un modèle d’espace public la place urbaine dont l’élément caractéristique n’est pas le construit, mais justement ce qui n’est pas construit, non pas les encadrements matériels, mais les possibilités de mouvement, d’influence et de privation dans lesquelles peuvent apparaître de nouvelles configurations de la perception ». C’est peu ou prou le noyau de la démonstration de Schwarte, dans laquelle on retrouve des accents ranciériens, et qu’il énonce dès le début – dans une brillante analyse d’Anaximandre, proposant de penser l’arkhè comme ce qui « définit la frontière qui donne sur l’indéfini » : « l’architecture est aussi la négation collective des édifices ».
Philosophie de l’architecture s’ouvre sur une intuition forte : « Les principaux événements de la Révolution française se sont déroulés sur des emplacements et dans des lieux qui n’avaient pas encore cent ans d’âge : dans la cour intérieure du Palais-Royal, sur le Champ-de-Mars, sur les places urbaines, sur les boulevards et dans les parcs, dans les théâtres, les salles de variétés et les restaurants. Aucun de ces espaces physiques n’existait dans le Paris du milieu du XVIIe siècle. Dans quelle mesure l’espace public a-t-il influencé la Révolution de Paris ? » La réponse n’est évidemment pas déterministe. Certes, il existe, comme l’a montré Foucault, des architectures de la discipline et du contrôle : ce que Schwarte, pour le dire très vite, propose d’appeler « l’architectonique ». Mais, avant cela, le philosophe a déplacé le concept d’architecture, qui pour un bâtiment n’est « ni la structure interne, ni simplement la coque extérieure, mais au-delà ce en quoi un corps vient à apparaître et la manière dont il le fait ». Dans un sens leibnizien, l’architecture « manifeste » s’expose toujours à « des forces de perception », elle est toujours un système dynamique comprenant « une face matérielle extérieure et une face perceptive intérieure […] pliées l’une dans l’autre ».

L’avant-garde des femmes allant à Versailles, 5 et 6 octobre 1789 © Gallica/BnF
Ces thèses ne s’énoncent cependant pas aussi simplement et directement qu’on peut ici en donner le sentiment. Elles aussi sont dans les plis : l’ouvrage compte 528 pages et constitue, par-delà la réflexion politique qu’il propose, une somme historique sur la philosophie de l’architecture. Schwarte dialogue avec presque tous les auteurs ayant évoqué de près ou de loin le sujet et analyse leurs thèses, de la philosophe Sylviane Agacinski à la sociologue Sharon Zukin en passant par Nelson Goodman ou Louis-Sébastien Mercier. Après avoir disséqué les formes de « l’architectonique du pouvoir », il en vient naturellement à son opposé, l’espace public comme « anarchitecture », avant de tenter une synthèse sous le titre « Les conditions architectoniques de la démocratie ».
C’est dans la section médiane, celle sur l’espace public, que se rêve le mieux la sortie d’un espace populaire vers un espace totalement démocratique. En examinant l’étymologie de « public », Schwarte remonte au grec « theatron », un lieu de rassemblement où se croisent ceux qui ne doivent pas se croiser selon l’architectonique de la relégation : femmes, esclaves, étrangers, enfants y trouvent une scène et la possibilité de l’expérimentation. Chez Platon, analyse Schwarte, c’est le lieu où « le mélange des genres et l’expérimentation du possible [font] vaciller la hiérarchie ». Ainsi de la place urbaine, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à Tahrir ou Nuit debout : « les femmes et les hommes qui, jusqu’alors, n’avaient aucune signification politique, qui étaient anonymes et sans voix, ces gens que l’on discriminait en les présentant comme une plèbe faible d’esprit, prirent soudain conscience de leur puissance et définirent des formes de vie. Si elles le purent, c’est en raison d’ouvertures d’espace qui leur permirent de se manifester, de se rassembler librement, de se mêler, de se comparer, de se disputer et de raisonner publiquement ».
L’espace public de Schwarte est donc un espace potentiel, au même titre que les sociologues du collectif Rosa Bonheur parlaient d’une « potentialité » de la visée émancipatrice. Comment entendre cette potentialité ? Non pas comme le fruit d’une volonté (on sort du coup du concept d’émancipation) mais comme la rencontre fortuite d’atomes durant leur chute, sans parier sur une perfectibilité ou non de l’être humain : « En tant qu’événements, dépendant de l’actualisation et de l’incarnation, les actes sont, pour l’essentiel, indéterminés. La capacité qu’a un homme à commencer signifie qu’il échappe à toute prévisibilité », conclut Schwarte. « Cette capacité de l’homme et la propension qu’ont les choses à s’engager dans ce commencement leur viennent par l’espace public. Cet espace les rassemble, ils forment en lui un collectif, sans être fabriqués et enchaînés conformément à une fin donnée. »











![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)
