En arabe, « nafar » signifie « exilé économique ». Le livre de Mathilde Chapuis fait bien le récit de l’exil politique d’un jeune Syrien, mais il est porté par le regard d’une jeune femme française à qui l’amour confère le don d’imaginer ce que son compagnon lui tait ou ne lui raconte que douloureusement, par bribes. « Moi qui sur ma chaise, moi qui dans ma tour attends le départ du héros, ou bien son retour, je cherche les épisodes de sa grande aventure sur lesquels je pourrais avoir prise. J’observe, je consigne et j’invente ».
Mathilde Chapuis, Nafar. Liana Levi, 160 p., 15 €
Ainsi revit-elle de l’intérieur – détails du paysage, sensations sous les pieds, faim, soif, odeurs et émotions – la longue attente du clandestin, caché dans les broussailles avant son passage du fleuve Meriç entre la Turquie et la Grèce. L’empathie est telle que le rythme heurté des phrases courtes de Mathilde Chapuis est à l’unisson du halètement de celui qui se cache et fuit. Un détail donne un goût de réalité à son évocation : l’attachement du jeune homme à la veste bleue qu’il porte, achetée peu avant les manifestations en Syrie. Quelques passages expriment la nostalgie de la vie quotidienne avant la guerre : « Il est si agréable de se promener sur al Dablan quand les arbres commencent à bourgeonner. Ce sera très vite la saison des abricots, on fera de la confiture. L’air embaumera bientôt du parfum des roses et une myriade de petites fleurs au parfum envoûtant écloront sur la verdure qui couvre les parois intérieures de ton café. Ici je veux parler du café dont tu es le propriétaire, celui que tu as laissé aux bons soins de tes employés le temps d’aller faire un tour cette après-midi-là. »
Quelques mois après, la répression s’est abattue sur le printemps syrien et des milliers de jeunes ont fui la dictature. La narratrice observe le jeune homme alors qu’il est employé dans un café d’Istanbul. Elle s’étonne de son énergie, de son ballet entre les tables. Et se laisse séduire. Tous deux font halte dans un petit appartement où défilent des personnes censées savoir comment sortir de Turquie.
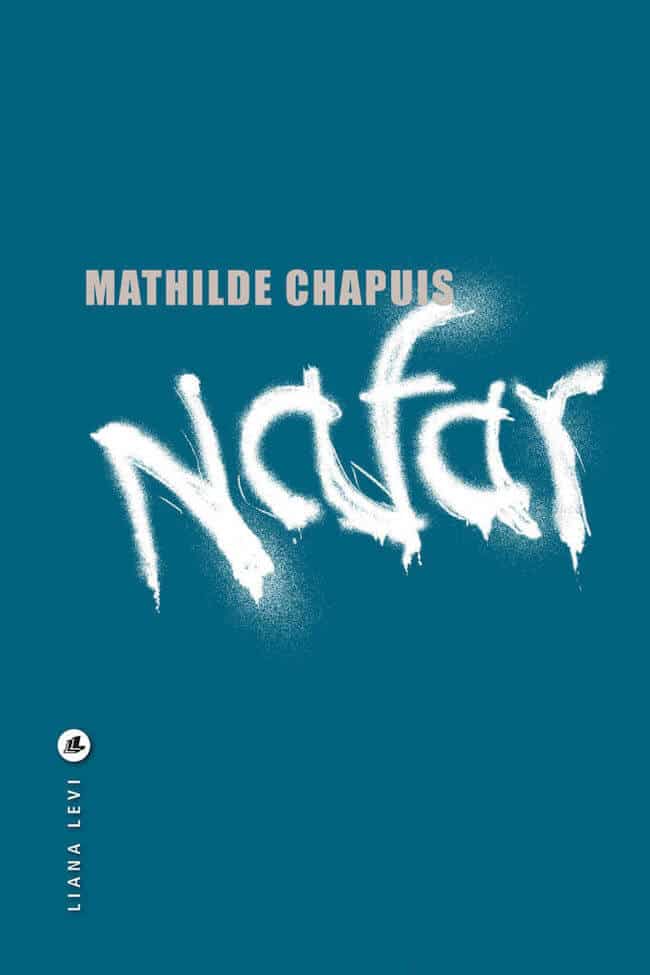
La mégapole turque n’est qu’un lieu de transit que l’exilé ne prend pas le temps d’apprivoiser tant il est attiré par l’Europe et par ce que ce mot porte en lui de promesses. Dans son imaginaire, c’est la Suède qui offre le cadre de vie idéal. Ce rêve est si fort parmi les candidats syriens à l’Europe qu’il peut rendre certains mesquins, jaloux de leur ancienne femme de ménage qui a réussi à se réfugier dans ce pays tant convoité.
Ce destin individuel est évoqué sur une trame à la fois historique et mythologique. La narratrice raconte les échanges de populations qui ont marqué le XXe siècle dans les Balkans. Elle fait le tableau de la ville d’Edirne, l’ancienne Andrinople, capitale de l’Empire ottoman avant la conquête d’Istanbul, maintenant gros bourg dévoré par la proximité d’Istanbul. Elle devient elle-même une figure mythique, entre Pénélope et Iseult : « J’attends de tes nouvelles. J’attends que tu m’appelles et dises : “Victoire !” Ou alors ton retour. Quoi qu’il arrive, je suis là. Je n’ose pas quitter ma chambre, faire quoi que ce soit qui me détourne de ce que tu es en train de vivre. Jamais de trêve. Sur la chaise, face au bureau, j’ai peur que tu ne meures si je cesse d’y penser. » Elle est une sorte de fée douée d’une double vue qui lui permet de voir le passé par les yeux de son compagnon.
Mais elle est avant tout une femme amoureuse qui voudrait profiter du moment plutôt que de le laisser envahir par un désir d’ailleurs qui ne répondra peut-être pas aux attentes. Est-il possible de savourer l’instant ? Aux yeux du jeune Syrien, les tulipes des parterres symbolisent la ville d’Istanbul. Il en offre une à sa compagne et elle devient, cette fleur qui s’ouvre brutalement à la lumière du jour, le symbole du passage de la beauté à l’indignation.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








