Dans Le Figaro Magazine du 3 janvier 2020, le président de la République française se vantait d’être « en train de refonder quelque chose, de retrouver un sens nouveau, une grammaire », et cette « refondation aussi profonde » avait lieu « pour la première fois » en temps de paix. En lisant les Écrits de New York et de Londres de Simone Weil, on mesure l’écart entre le gigantesque effort pour soulever une époque de la génération de l’après-Seconde Guerre et la tentative de masquer sous une rhétorique vide à la Trump la continuation de politiques vieillies.
Simone Weil, Œuvres complètes, V. Écrits de New York et de Londres, vol.1 (1942-1943). Questions politiques et religieuses. Gallimard, 765 p., 49 €
Alors que nous vivons une crise dont la gravité est sans précédent dans l’histoire humaine parce qu’elle touche, non pas à nos idéologies, quelles qu’elles soient, mais, à un seuil bien plus radical, aux conditions mêmes de possibilité d’en formuler, il semble qu’aucun responsable politique, en France comme ailleurs, ne soit à la hauteur de la situation. Ce constat ne relève d’aucune fatalité : la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, dont il est inutile de souligner l’ampleur, n’a pas laissé le monde sans femmes et hommes capables de prendre la mesure de l’événement et de discerner et de susciter un avenir vraiment humain. Parmi ceux-là, la philosophe Simone Weil.
Grâce à l’extraordinaire entreprise, commencée en 1988, d’édition des Œuvres complètes, menée par une équipe de spécialistes, Florence de Lussy, Robert Chenavier et André Devaux, à laquelle s’agrègent au gré des volumes différents collaborateurs, nous avons la chance de pouvoir lire cette pensée dans tous ses chemins, méandres, tours et détours. Édition fondée sur une enquête philologique sûre, démontrant un grand « souci génétique » (dates des textes), elle comprend 16 volumes (3 sont encore à paraître), divisés en 7 tomes, destinés à remplacer les 10 volumes de la collection « Espoir » inaugurée par Camus dans les années 1950.
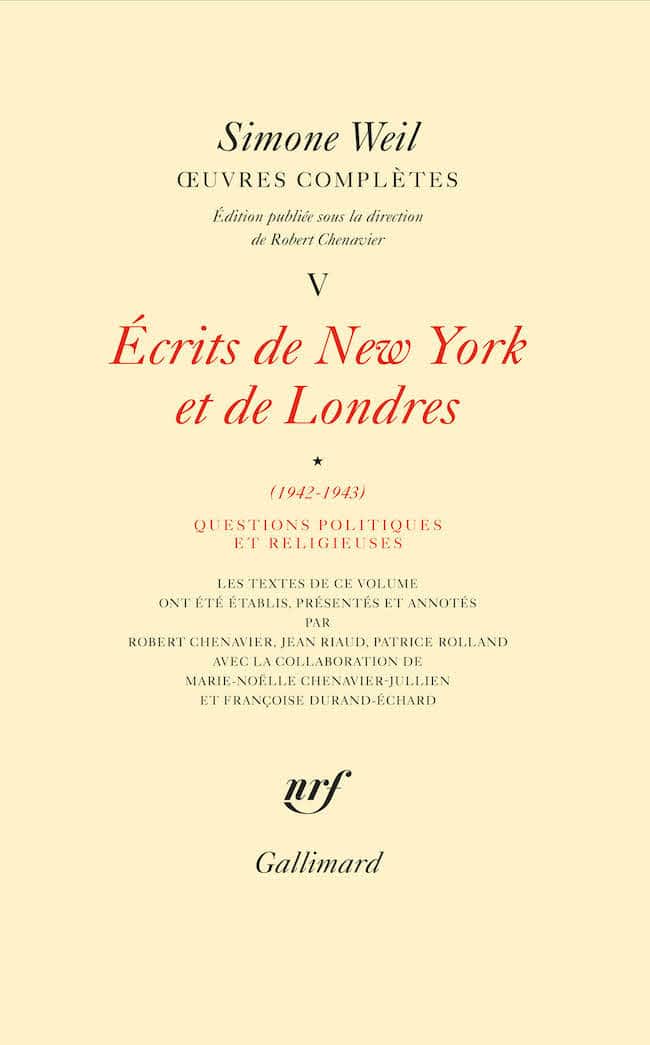
Le volume qui retient notre attention fait partie du tome 5 dont il compose la première pierre, la seconde étant le dossier du livre fameux publié par Camus sous le titre de L’enracinement, mais que Simone Weil avait titré : « Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain ». Les volumes 1 et 2 du tome 5 sont indissociables (pour bien faire, il faudrait y ajouter le volume 4 du tome 6 des Cahiers de New York et de Londres, admirablement édités et publiés en 2006). Avec cet ensemble, nous avons désormais la chance de connaître, au plus près des sources fiables, la pensée de Simone Weil dans les derniers mois de son existence – partie de Marseille pour New York en mai 1942, elle mourra à Londres en août 1943.
On voit dans ce volume la philosophe se débattre encore avec la question pendante de son entrée dans l’Église (la « Lettre au Père Couturier », connue sous le nom de Lettre à un religieux), ce qui ne l’empêche nullement de formuler une remarquable « théorie des sacrements » ; elle contribue à diverses revues et études, persiste malheureusement dans son interprétation du judaïsme comme « idolâtrie nationale ». Mais ce qui frappe, ce dont la lecture nous saisit, qui nous réveille et nous alerte, ce sont les textes destinés à laisser entrevoir ce que devrait être l’après-guerre. En étant commandés par les autorités de la France libre, ces textes lui sont arrachés, obligeant Simone Weil à jouer le rôle d’intellectuel organique, ce qu’elle ne veut surtout pas : « les intelligences entièrement, exclusivement abandonnées et vouées à la vérité ne sont utilisables pour aucun être humain, y compris celui dans lequel elles résident », écrit-elle à Francis-Louis Closon. L’exigence de sa vocation la pousse à vouloir rejoindre les zones de combat, ce qui lui sera toujours refusé. L’auteure de ces textes se dit « finie, cassée » (lettre à Closon de juillet 1943), ayant vécu durant ces mois londoniens comme le dernier stade de la négation (la « décréation ») d’elle-même.
C’est dire de quel fond de souffrance intérieure, qui s’ajoute à la mauvaise santé de la jeune femme, ces textes sont issus. Nul masochisme ou dolorisme ici, simplement la signature d’une grande cohérence anthropologique qui sait que la pensée doit passer par la chair. Non seulement par la participation active à la douleur des hommes, mais parce que tout « désir de l’âme, tant qu’il n’a pas passé à travers la chair au moyen d’actions, de mouvements, d’attitudes qui lui correspondent naturellement n’a pas de réalité dans l’âme ». C’est le prix à payer pour se rendre disponible à « l’invention », thème omniprésent dans le volume, seule capable de surmonter la crise : « nous ne trouverons pas la liberté, l’égalité, la fraternité, sans un renouvellement des formes de vie, une création en matière sociale, un jaillissement d’inventions » (dans « Luttons-nous pour la justice ? »). Ou encore, dans « Légitimité du gouvernement provisoire » : « penser les notions fondamentales, comme si c’étaient des choses nouvelles, est une nécessité sans doute pénible, mais à laquelle aujourd’hui nous ne pouvons nous soustraire sous peine de catastrophe ».

Permis de la France combattante de Simone Weil (1943)
Si la philosophe donne sa démission du commissariat national à l’Intérieur en juin 1943, c’est qu’elle a le sentiment que les hommes de la France libre ne parviennent pas à dépasser le stade de l’organisation de la prise du pouvoir après la Libération. Si la Résistance a « ramassé la légitimité jetée au rebut », l’avoir recueillie ne lui confère qu’une légitimité de « dépositaire ». Plutôt que de pouvoir, il s’agit des conditions de son exercice légitime conféré par la seule souveraineté qui vaille : la justice : « Ce qui est souverain en fait, c’est la force, qui est toujours aux mains d’une petite fraction de la nation. Ce qui doit être souverain, c’est la justice. […] Quand il y a oppression, ce n’est pas la nation qui est opprimée. C’est un homme, et un homme, et un homme ».
Pour Simone Weil, deux principes sont à respecter si l’on tient à une politique renouvelée : l’attention et la responsabilité pénale. Les lecteurs de l’élève d’Alain connaissent bien le thème weilien de l’attention qui ne ressortit pas à la psychologie, mais bien à l’anthropologie évoquée plus haut qui en fait un acte de synthèse entre la perception et la concrétisation d’un « besoin de l’âme », redoutablement nécessaire à l’homme qui prétend gouverner : « le premier des problèmes politiques, c’est la manière dont les hommes investis de puissance passent leurs journées. S’ils les passent dans des conditions qui rendent impossible un effort d’attention soutenu longtemps à un niveau élevé, il ne se peut pas qu’il y ait de la justice » (Œuvres complètes, tome VI, vol. 4, p. 380). Le second aspect tient à une séparation réelle des pouvoirs. Simone Weil remarque que « l’on ne fait plus aujourd’hui aucune distinction entre la législation et l’activité gouvernementale », observation très actuelle face à un exécutif qui ignore ce qu’est une loi. Une vraie légitimité est inconcevable sans la possibilité qu’a le citoyen de demander des comptes aux dirigeants allant bien au-delà de la sanction des urnes, jusqu’à un passage en justice. L’association de l’attention et de l’absence d’immunité garantit, autant qu’il est possible, « le libre consentement du peuple », seule définition acceptable de la légitimité.
À la veille de sa mort, Simone Weil refuse d’avoir quelque lien que ce soit avec la France combattante, puisque celle-ci récuse le sens de son engagement, et, de la même façon, elle ne peut pas imaginer une politique de l’avenir sans des institutions qui assurent à la seule justice la souveraineté.












