Ce petit livre de Johann Chapoutot, d’une rigueur intellectuelle exemplaire, d’une écriture sobre et d’autant plus mordante, devrait faire l’objet d’une lecture et d’une étude obligatoires dans toutes les écoles considérées aujourd’hui – fort légèrement – comme « grandes » : ENA, HEC, officines commerciales et managériales diverses. À partir du cas examiné en détail du haut dignitaire SS Reinhard Höhn, un des brillants théoriciens du nazisme, et d’autres criminels de guerre moins distingués mais presque aussi chanceux, Libres d’obéir revient sur les principes d’organisation du « Reich de mille ans » et sur leur avenir après 1945.
Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management du nazisme à aujourd’hui. Gallimard, 163 p., 16 €
D’abord, il convient de se débarrasser définitivement du mythe d’une loi nazie imposée par la terreur à une population dans l’ensemble réfractaire à ses aspects inhumains et plutôt soumise au pouvoir qu’adhérant d’enthousiasme à ses méthodes. Outre l’accession au pouvoir dans un cadre de démocratie représentative du parfait leader populiste Hitler, jamais le soutien national n’a manqué au régime, même dans les tout derniers mois, quand Berlin s’écroulait sous les bombes. C’est donc bien que l’idéologie volkisch a bénéficié non d’une acceptation du bout des lèvres, mais d’une véritable ferveur populaire.
L’administration de l’État joue dans cette adhésion un rôle essentiel. Non qu’elle soit sans défauts. Elle ne fonctionnerait peut-être pas beaucoup mieux que le système explicitement démocratique (et bancal) de la république de Weimar si ses soubassements politiques correspondaient moins à des aspirations à l’autonomie célébrée (et simultanément dévoyée) par des managers idéologues comme Höhn.
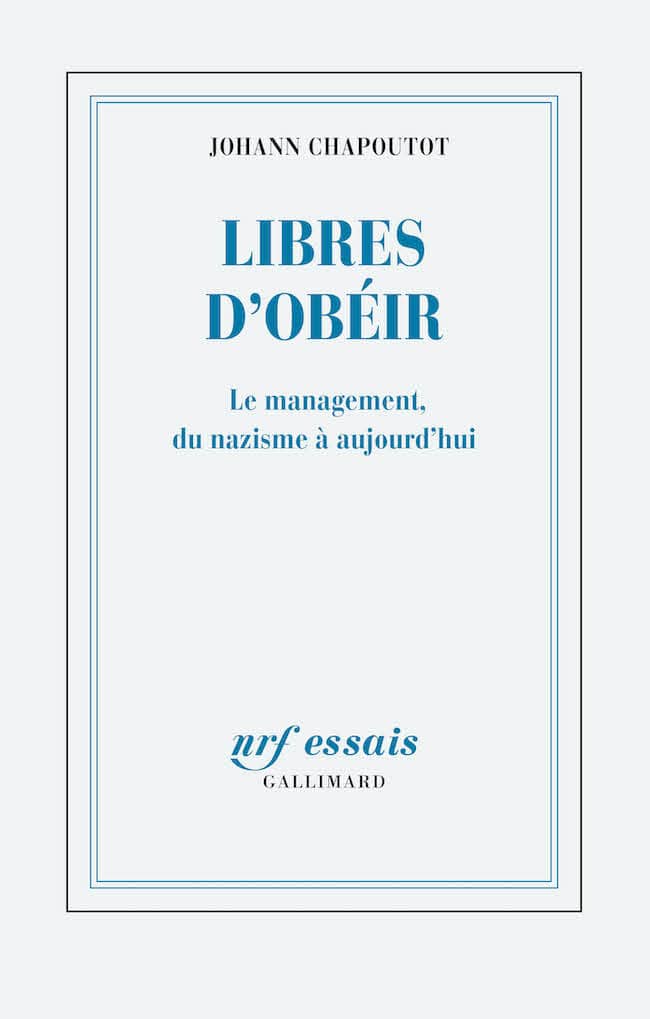
Car le formidable paradoxe du totalitarisme nazi, c’est qu’il s’appuie sur la « libération » des individus par le travail librement accepté et le bonheur de servir. Dans la morale poussive des démocrates, le travail est au fond considéré comme un moindre mal. On n’en fait pas une valeur suprême inculquée depuis l’enfance, et surtout on ne l’assimile pas à l’unique voie permettant l’épanouissement personnel et, au bout du compte, la joie de vivre. En revanche, pour le jeune hitlérien, érigé en modèle notamment par le cinéma, et pour la jeune hitlérienne, future mère de soldats, une propagande subtile forge la conviction que le travail au bénéfice de la communauté est un acte libre, qui permet de développer la force, physique avant tout, mais aussi intellectuelle, dont l’exercice sans entraves procure exaltation et sentiment enivrant de puissance : mens sana in corpore sano, idéal athlétique sublimé par les images de Leni Riefenstahl et devenu le credo de tout un peuple.
En somme, l’organisation nazie favorise absolument l’initiative individuelle, à l’unique condition que les subalternes, laissés libres de parvenir par les moyens de leur choix à accomplir au mieux les tâches qui leur ont été assignées, aient l’impression de les avoir déterminées et perdent la conscience de leur entière subordination aux donneurs d’ordres qui n’attendent de leurs subordonnés que des résultats, indépendamment de la façon dont ils ont été obtenus. Une telle logique de l’entreprenariat s’applique à la fois aux usines Krupp et à Auschwitz. D’un côté il s’agit de produire des armes, de l’autre des exterminations. Pour les individus qui constituent les rouages du système, seule compte l’exécution des instructions données, et le travail c’est la liberté.
Que cette conception du management soit un piège, que ce piège, tout de même, n’ait pu être armé que grâce à la vocation de l’homme ordinaire pour la servitude volontaire admirablement épinglée par La Boétie, c’est là un fait qui ne rend guère optimiste pour l’avenir de l’idéologie managériale sous quelque culture que ce soit. Et en effet le pessimisme en ces matières est d’autant plus justifié que la suite de la carrière de Reinhard Höhn et de quelques autres assassins nazis en gants blancs s’est effectuée sans encombre après 1945 à l’occasion de la construction de la République fédérale.

En 1978, l’ancien SS Reinhard Höhn publie un livre de management
Non seulement Höhn n’a pas été inquiété pour ses fonctions ultimes de général de la SS, mais il a prospéré, fondé un institut formant les managers de l’Allemagne nouvelle, qui a fourni à partir de 1954 les cadres du « miracle allemand », exercé ainsi une influence européenne jusqu’en 1972 (où la seconde génération des penseurs allemands de l’après-guerre a commencé enfin à fouiller sérieusement dans les poubelles de l’Histoire), continué à écrire des livres à succès après sa relative mise à l’écart, enfin est mort dans son lit en 2000.
Mais le plus intéressant de la réflexion magistrale de Johann Chapoutot sur la nature profonde du management hitlérien vient à la fin de son livre : in cauda venenum. Car il n’a aucun mal à montrer que, antisémitisme mis à part (occulté après 1945, exhibant de nouveau ses dents pourries en ce délicieux début du XXIe siècle), l’enseignement du management aujourd’hui, dans nos sociétés « libérales », obéit aux même monstrueuses injonctions qu’à l’époque du national-socialisme. Liberté d’entreprendre, avenir enchanteur de l’initiative privée soigneusement encadrée par l’intérêt financier des multinationales, joie du travail en open space où l’on œuvre en groupe dans la fraternité et la bonne humeur (en se surveillant du coin de l’œil), valorisation des tâches répétitives dûment individualisées, si enrichissantes (sauf en ce qui concerne les picaillons), obsolescence programmée des syndicats qui embrigadent les travailleurs alors que l’entreprise moderne n’a pour but que l’autonomie de la personne : rien n’a vraiment changé depuis « Arbeit macht frei », sauf que le capitalisme, dans ses effrayantes mutations contemporaines, semble cette fois-ci en marche vers le triomphe définitif de l’esclavage librement consenti. On n’arrête pas le progrès.










![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)

