Après ses nouvelles de jeunesse, traduites en 2017, Mia Couto, l’une des grandes voix de l’Afrique dans la littérature contemporaine, revient avec Les sables de l’empereur, sa publication la plus récente en portugais, traduite par Elisabeth Monteiro Rodrigues. Début mars, à Paris, l’écrivain et biologiste mozambicain s’est entretenu avec En attendant Nadeau.
Mia Couto, Les sables de l’empereur. Trad. du portugais (Mozambique) par Elisabeth Monteiro Rodrigues. Métailié, 672 p., 25 €
Au sein de la longue histoire des traductions, celle-ci sera peut-être un cas d’école. Les romans Mulheres de Cinza, A Espada e a Azagaia et O Bebedor de Horizontes, reliés par une même trame narrative, ont été publiés séparément dans leur langue d’origine, respectivement en 2015, 2016 et 2017, au Mozambique, au Portugal et au Brésil, mais aussi dans les pays anglophones. En grande partie dicté par des motifs économiques, leur rassemblement en un seul volume pour la version française – un choix également fait par l’éditeur espagnol – a conduit Mia Couto à une reprise de son texte dans la perspective de sa traduction.
« J’avais pensé chaque volume en lui-même, comme si c’était un enfant », nous a expliqué Mia Couto. Équipée d’un glossaire très fourni et d’une note introductive de l’auteur, cette édition, faite à partir du livre paru au Portugal (pour le Mozambique, les textes sont édités par sa fondation), ne détaille pas les modifications apportées. Elle inscrit plutôt l’histoire de la jeune Imani et du soldat portugais Germano à la fois dans la continuité et comme si les personnages eux-mêmes avaient été transformés par le passage de la langue d’origine à la langue d’arrivée.
La question est d’autant plus intéressante que la traduction est un motif majeur du roman dans son ensemble et dans nombre de ses détails. Pendant la guerre du Portugal contre le royaume de Gaza et son roi, Ngungunyane, qui lui résistent à la fin du XIXe siècle, et dans le contexte de la concurrence coloniale sur le Continent qui est aussi une concurrence linguistique, notamment avec l’anglais parlé en Afrique du Sud, le portugais est imposé, mais tous les personnages ou presque traduisent, tout le temps. En particulier Imani, qui parle txitxope (ou chopi), l’une des quarante langues mozambicaines, et qui contrairement à sa famille maîtrise « la langue de l’envahisseur », mais on croise aussi une Italienne, des Suisses… Imani devient traductrice, pour le double compte des Portugais et des Vatxopi (ou Chopes), son peuple, sous la menace d’un double feu, à la fois utilisé comme auxiliaire par la puissance coloniale et menacé pour cette raison par ses voisins.
Imani n’est pas la seule parmi les protagonistes à faire des mots, à choisir l’objet de sa réflexion et par conséquent de l’action romanesque elle-même. Beaucoup évoquent, par exemple, dans de magnifiques dialogues, les noms perdus et remplacés des fleuves qui, bien loin de l’imagerie occidentale, sont des vecteurs de mémoire. Mais Mia Couto fait plus que représenter la rencontre des langues en parsemant son roman de txitxope. Il maintient tout au long des innombrables péripéties une position sceptique et critique à l’égard de la fixation orthographique des langues, poursuivie jusqu’aujourd’hui. Le travail d’Elisabeth Monteiro Rodrigues, qui suit son œuvre depuis le court texte Tombe, tombe au fond de l’eau (Chandeigne, 2005), va dans ce sens en ôtant les italiques qui soulignaient dans l’édition portugaise des mots « étrangers » (alors qu’ils ne sont en rien étrangers à Imani) ou en ne décidant pas de la transcription du nom même de la langue – on lit ici à la fois txitxope et chopi, Vatxopi et Chopes, comme on lit Ngungunyane et Gungunhane.
Devant l’alternance sur les trois tomes du récit d’Imani et de la correspondance du soldat Germano, on peut saluer le travail d’unification fourni par cette traduction. Là où Imani se déplace entre les langues, Germano reste prisonnier de l’imaginaire raffiné de Lisbonne et de Lorenço Marques, la future Maputo. Et lorsqu’elle veut s’adresser à des soldats dans sa langue maternelle, Imani, placée sous le signe de la transmission des événements passés et de la résistance dans une situation de contrainte, dit : « Je ne possédais aucune langue ». C’est qu’elle parle une langue qui lui est propre, celle d’un roman, faite de toutes les langues.
Comme son personnage, Mia Couto quitte son propre monde. Car ce projet de « trois en un » n’est pas la seule particularité des Sables de l’empereur : autrefois reconnaissable – et trop souvent réduit – à ses néologismes, l’écrivain mozambicain semble laisser de côté la fable merveilleuse pour le récit historique, la métaphore pour une parole plus directe sur la violence de l’histoire ; il s’en explique, entre autres choses, dans notre entretien.
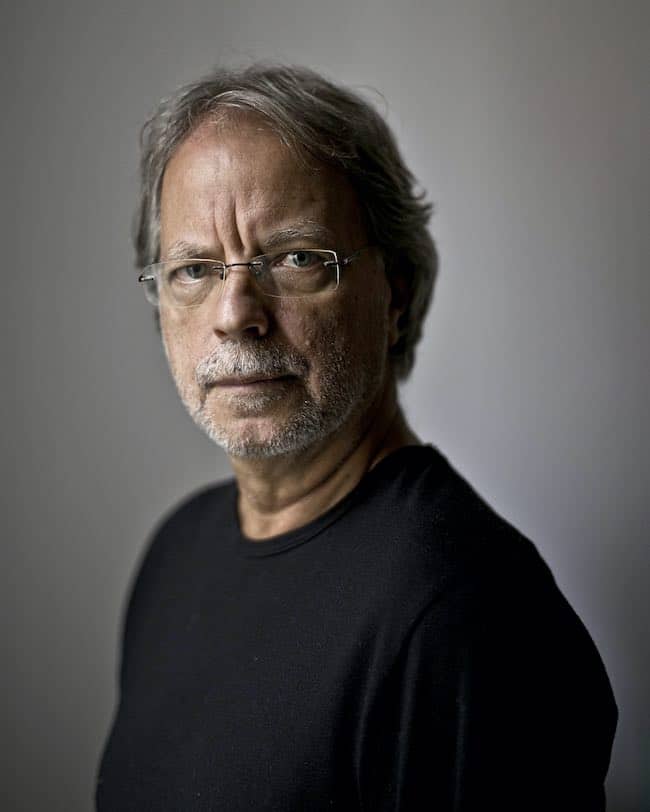
Mia Couto, à Paris (mars 2020) © Jean-Luc Bertini
Il semble que votre propre langue d’écriture ne soit plus tout à fait la même : elle comporte désormais peu de néologismes, voire pas du tout.
Cette idée de me libérer d’un portugais inventé, néologique, a commencé avant ce livre, disons avec La confession de la lionne (Métailié, 2015). Je voulais écrire dans un autre registre, me surprendre moi-même. Mon projet reste de raconter une histoire par le biais de la poésie, et je crois que je continue dans ce territoire-là. Et moi-même, quand j’écris, je me sens plus traducteur qu’écrivain, parce que je me trouve dans un espace de frontière : entre l’oralité et l’écrit, entre une rationalité d’origine africaine et une autre européenne, entre des langues différentes, qui expriment des points de vue et des cosmogonies différentes. Je suis un peu comme un contrebandier…
D’où vient ce besoin de vous « libérer » d’une langue que vous aviez pourtant créée vous-même ?
Je me sentais prisonnier de cette construction. Nous pensons être l’auteur du livre, mais en fait le livre est notre propre auteur, il nous produit nous-même. J’avais besoin d’être libre pour dire autre chose, autrement. Je voyais aussi que certains lecteurs en restaient à la dimension esthétique de ce travail. Ils ne percevaient pas que cette transformation du modèle normé de la langue portugaise voulait montrer d’autre possibilités d’utiliser la langue et de penser. Cela n’a pas été une décision soudaine, j’ai beaucoup réfléchi. Le plus grand ennemi de la beauté que je voulais créer était cette idée de « faire joli ».
Dans le texte en portugais, quelle est la place de la langue des Vatxopi, le peuple d’Imani ?
Je ne parle pas cette langue, qui appartient à un groupe linguistique du sud du Mozambique, mais je comprends une langue similaire. Les locuteurs ont de grandes difficultés à nommer leur propre langue. Ces langues ne sont pas normalisées d’un point de vue orthographique. À chaque fois que je demandais quelque chose, on me donnait une réponse différente. Donc, dans chaque volume de l’histoire, on trouve des différences entre les mots. Et puis j’ai rencontré Alfonso Silva Dambile, qui m’a sauvé.
Qui est-ce ?
[Soudain, Mia Couto se met à parler en français] C’est un vieil homme qui connaît très bien l’histoire de son peuple. Tous les gens que je rencontrais pour faire le livre me parlaient de cet homme, qui est une sorte de sage ou d’érudit. À un moment, il m’a dit : « Peu importe si je te dis la vérité, puisque tu es un écrivain ! »
Vous-même, vous traduisez des langues du Mozambique ?
Je le fais de manière indirecte, car je n’ai pas une connaissance suffisante de toutes les langues du pays. Ce qui m’intéresse dans la compréhension d’un mot d’une autre langue, c’est la manière dont a été construite la réalité qui se trouve derrière ce mot. Et ce qui m’intéresse encore plus, c’est la raison pour laquelle certains mots n’existent pas. Par exemple, le mot « futur » : pourquoi il n’existe pas ici ou là ?
Comment voyez-vous l’évolution du portugais du Mozambique ?
C’est une langue en train de se construire. C’est un peu comme un adolescent qui n’obéit pas à ses parents. Actuellement, il y a tout un processus de normalisation, depuis le portugais jusqu’aux langues mozambicaines. Par exemple, au Mozambique, on dit « deux heures de temps », ce qui semble être un pléonasme, mais il faut le dire, car cela correspond à une certaine idée du temps. Je n’aime pas beaucoup, en général, l’idée de fixer les choses : quand on veut normaliser des langues ou des personnes, il y a toujours un côté négatif, même si je comprends que ce soit nécessaire. Avec ce livre, nous avons tous beaucoup souffert… À chaque fois qu’on fixait un mot en chope, quelqu’un nous disait un mot différent. Imposer une langue unique dans un pays qui en comporte vingt-cinq est un acte de violence. Je ne dirais pas que c’est une violence coloniale, mais c’est quand même une violence exercée contre la diversité de ces langues. Il y a eu un très grand changement au Mozambique après l’indépendance, avec Samora Machel, qui voulait créer ainsi l’unité nationale : il était interdit de parler sa langue maternelle. Aujourd’hui, la situation a changé. On apprend sa langue maternelle et le portugais. J’en suis content, mais je ne suis pas optimiste car, pour faire ça bien, il faudrait des moyens que le Mozambique n’a pas. Par exemple, la langue makua, quand on va la normaliser et l’enseigner à l’école, il va surgir cinquante variantes dialectales qui disent que ce n’est pas le vrai makua. La normalisation des langues crée de nouveaux conflits.
Il y a une autre nouveauté dans Les sables de l’empereur : vous y traitez de la violence de l’histoire d’une manière très directe, à peine métaphorique.
[Mia Couto repasse au portugais et rit] Cet entretien doit s’arrêter là, vous me demandez des choses trop difficiles ! Oui, c’est vrai. Auparavant, vivre avec la violence des guerres que j’ai connues était si traumatisant que j’ai préféré emprunter une voie métaphorique [dans les années 1970, Mia Couto s’est engagé auprès du FRELIMO (Front de libération du Mozambique), qui combattait pour l’indépendance]. Je traitais ce qui était cruel presque avec douceur. Je ne sais pas si c’est le temps qui a fait ça, car cette réalité est une réalité lointaine maintenant, mais il était nécessaire pour moi de recourir à un langage plus direct, plus cru. Aujourd’hui, j’utilise l’histoire, le passé, pour parler du présent.
De quel présent ?
Au Mozambique, l’histoire est très élastique : il n’y a pas eu de période de paix depuis l’indépendance. On en est au troisième accord de paix, et après cet accord il n’y a toujours pas la paix totale. Cette violence a quelque chose à voir avec la non-résolution des conflits du passé. L’un de ces conflits est celui qui se trouve dans Les sables de l’empereur, entre l’État de Gaza de l’empereur Ngungunyane et le Portugal de Mouzinho de Albuquerque. Dans ces conflits, il y a toujours une composante religieuse. La religion dominante au Mozambique, qui n’a pas de nom, a quelque chose à voir avec le culte des ancêtres. Elle préserve une relation vitale entre la terre, les personnes et les ancêtres. La terre est sacrée : en elle sont les morts ; envahir un territoire, c’est comme détruire une église. D’ailleurs, le roman commence avec une termitière, un lieu de naissance qui est aussi un lieu sacré. De telles violences obligent les gens à fuir, comme le fait Imani.

Le roman adopte le point de vue d’un peuple mozambicain qui se bat avec le Portugal et d’un personnage qui est à la fois femme, jeune et traductrice. Ce point de vue de l’entre-deux et de la minorité, est-ce le vôtre sur l’histoire ?
Oui, c’est moi-même, je suis cet homme-là : ma patrie, c’est la frontière. Je ne vois pas ça comme un drame, au contraire c’est une richesse. Ce n’est pas difficile de tenir cette position. Certains imaginent de façon illusoire qu’ils ont une seule identité. Au Mozambique comme dans le monde entier, les êtres humains sont entre des identités multiples. C’est très commun au Mozambique, où chacun parle une langue qui n’était pas la sienne et a deux ou trois religions. Le soir, les gens communiquent avec leurs ancêtres, la journée ils sont catholiques ou musulmans. Et ils ne voient aucun conflit là-dedans ! Donc, ils peuvent me voir comme l’un des leurs. Dans la rue, on m’arrête comme si j’étais un joueur de foot, pour que je transmette des messages. Je voyage souvent, même dans ma ville, je marche tout le temps. Le biologiste peut ne pas savoir beaucoup de choses, mais il marche beaucoup…
La relation de vos personnages aux arbres, aux fleuves, à la terre, est très importante. Décrivez-vous un monde disparu, détruit ?
Tout ce que je raconte se trouve encore au Mozambique. Je rencontre souvent cette relation très ancienne mais très vivante entre les individus et la nature. Les gens peuvent se transformer en arbre ou en lion, il n’y a pas de frontière d’identité absolue. Si on demande à un Mozambicain comment désigner « la nature », il n’a aucun mot pour le dire. La nature est en nous, nous sommes en elle, c’est une seule entité. Je ne pense pas qu’il y ait eu un jour une nature intacte, sans la trace de la main de l’homme. En quelque sorte, on a créé une deuxième nature. Souvent, on parle de nature mais sans l’appréhender ni la comprendre : ce que nous nommons nature, c’est la vie elle-même.
Ce que vous dites ne va pas vraiment dans le sens d’un discours voyant la nature comme étant « à préserver », et qui reste centré sur une vision occidentale.
Oui, les cultures locales sont globales et écologistes intrinsèquement ! Au cours de ma vie, je suis parti d’un point de vue européen et je suis allé vers autre chose. Cela m’aide énormément comme scientifique et comme être humain. J’ai appris que j’avais une relation de parenté avec les arbres, les fleuves, les pierres.
Quel a été cet itinéraire ?
J’ai perdu la peur. Je n’ai plus besoin de toutes ces grandes certitudes. Je suis disponible pour entendre d’autres types de connaissances. L’écriture, de son côté, est simplement une manière d’ordonner ce qui est en moi. Elle m’aide à donner un sens à ce que je ne connais pas. L’Afrique m’a offert un très beau cadeau, qui est de ne pas avoir peur de l’ignorance, ne pas avoir le sens de la prévision, de ne pas faire de la compréhension du monde une forme de domination ou de contrôle. On ne contrôle jamais rien.
Pourtant, en écrivant, vous fixez bien quelque chose.
Oui… j’aime beaucoup cette contradiction ! [Mia Couto rit]
Quelle a été la principale difficulté pour écrire ces trois romans, réunis en un ?
Cette histoire est comme un arbre, elle s’est ramifiée petit à petit. Il fallait tailler cet arbre de manière qu’il se développe. Le dernier volume a été le plus difficile : il fallait terminer l’histoire. J’écris parce que je suis fasciné par des personnages, par les potentialités qu’ils m’offrent. Donc, pour qu’il y ait une fin, il faut tuer le personnage et mettre fin à ses possibilités. Je pars toujours des personnages, ce sont eux qui racontent l’histoire. Et je pars aussi du principe que je ne veux pas savoir. C’est une écriture très obsessionnelle, qui me réveille la nuit pour me dire des choses. Les personnages existent, ils prennent possession de moi. Je dois ensuite les oublier. Je ne sais pas faire autrement.
Quels seraient les auteurs mozambicains à traduire et à transmettre, d’après vous ?
Il y a Ungulani Ba Ka Khosa, qui lui aussi a écrit un livre sur l’empereur Ngungunhane, Ualalapi (1987) ; Paulina Chiziane, dont un livre est traduit en français (Le parlement conjugal, Actes Sud, 2006) ; il y a beaucoup de jeunes, mais qui font surtout de la poésie, car le Mozambique est un pays avec une tradition poétique très forte. Moi-même, quand j’écris un roman, j’écris toujours de la poésie en même temps. C’est comme une pluie qui éclaircit le ciel. [Mia Couto vient de publier un recueil en portugais, intitulé Traducteur de pluie.]
Et que pourra-t-on lire prochainement de vous ?
Je termine un roman qui parle de mon enfance et de mon adolescence dans la ville de Beira, au centre du Mozambique, et qui raconte la fin d’un monde, le monde colonial, dans lequel j’ai grandi, et la fin de mon propre règne, mon enfance. Je continue dans le même registre que dans Les sables de l’empereur, mais en recueillant des documents pour chaque personnage. Chacun, donc, aura la liberté de parler le portugais qu’il désire. Je ne vais pas rompre radicalement en disant que jamais plus je ne retournerai aux néologismes… en fait, je ne veux pas refaire ce que j’ai déjà fait. D’ailleurs, je me relis seulement quand j’y suis obligé. Par exemple, je me suis relu pour l’adaptation au cinéma de mon roman La véranda du frangipanier. J’ai eu tellement honte que j’ai réécrit le livre.
Propos recueillis par Pierre Benetti et traduits par Elisabeth Monteiro Rodrigues












