« Espace ni subjectif, espace ni objectif, espace inobjectif […] Il s’agit de l’extraordinaire révolution sensible qui a précédé, accompagné et suivi la révolution de 1789. Rien n’est comparable à cette immense vague de fond qui a bouleversé la sensibilité occidentale, pour ouvrir dans la profondeur du temps l’espace critique de la nuit », annonce Annie Le Brun dans son introduction à ce recueil de préfaces et de conférences des vingt-cinq dernières années. On peut le lire avec le livre de Donatien Grau, qui relit l’histoire de l’art et de la littérature modernes à l’aune des titres des œuvres.
Annie Le Brun, Un espace inobjectif. Entre les mots et les images. Gallimard, coll. « Art et artistes », 320 p., 22 ill., 28 €
Donatien Grau, Titres. Une histoire de l’art et de la littérature modernes. Préface de Jean-Luc Moulène. Klincksieck, 256 p., 26 ill., 29 €
Au centre des dix-huit textes d’Annie Le Brun ici réunis, on pourra lire celui qui accompagnait, en 2001, l’exposition Surrealism : Desire Unbound organisée à Londres par la Tate Gallery ; son titre : « Le désir, une “invention” surréaliste ». Véritable phare de tout le livre, surgissant dans l’espace critique de la nuit, ce texte justifie et explicite le rôle décisif du désir dans l’activité de chacun des créateurs approchés par l’auteur, cette « approche » allant jusqu’au cœur même des œuvres écrites ou peintes dont il sera question.
« Le désir a été donné à l’homme pour qu’il en fasse un usage surréaliste, pourrait-on dire pareillement à ce qu’André Breton affirmait, non sans provocation, à propos du langage, il y a maintenant plus de trois quarts de siècle. Telle me paraît en tout cas la meilleure façon d’évoquer ce que la modernité doit au surréalisme. » Annie Le Brun annonce la couleur : le lecteur doit s’attendre à être confronté aux forces du désir, jusqu’à ce qu’il y débusque le sien, en écho à celui des autres.
Qu’il s’agisse de la délicatesse déchaînée de Jean Benoît, de la matière enchantée de Slavko Kopač, de la familière étrangeté des images anatomiques, de l’érotisme de Picasso, de la « vitesse » chez Picabia, de l’insurrection lyrique de Toyen ou de l’évidence poétique de Mimi Parent, de la distraction supérieure de Leonora Carrington ou des variations du « message automatique », qu’il s’agisse des stupéfiantes cibles croates, des forces de la nuit, des dessins de Romaine Brooks, de la présence constante de la forêt dans l’œuvre théâtrale et poétique de Radovan Ivšić, ou encore du rêve architectural de Jean-Jacques Lequeu, c’est bel et bien du surgissement du désir sous toutes ses formes qu’Annie Le Brun souligne le rôle décisif pour chacun de ces sujets inobjectifs. Avant de revenir sur certains de ces surgissements, il me faut insister sur l’extrême densité du propos de l’auteur, bel exemple d’intelligence critique portée au rouge par le jeu avec le feu central de la poésie. C’est rare !

Comme il n’est évidemment pas question de remonter ici à la source du désir en chacune des figures tracées par l’auteur, très arbitrairement je vais m’attacher à certaines d’entre elles ; Jean Benoît, pour commencer. Et comme j’imagine que quelques lecteurs ne savent pas vraiment qui fut cet homme, voici un bref rappel de sa trajectoire. Alors qu’André Breton et le groupe surréaliste préparaient une grande exposition internationale consacrée à Éros – en 1959, cela n’avait rien d’anodin, croyez-moi ! –, Jean Benoît fit son apparition en proposant ce que Breton appela le « Grand Cérémonial », c’est-à-dire l’Exécution du testament du Marquis de Sade par ses soins, en prélude à l’exposition, un soir en la demeure de Joyce Mansour, et en présence d’une centaine de personnes spécialement invitées. Tous ceux qui assistèrent au lent dépouillement des éléments du costume conçu par Benoît, qui se terminait par la marque au fer rouge du nom de Sade sur sa poitrine aussi dénudée que le reste de son corps, gardent pour toujours en mémoire ce moment de haute intensité. Ce moment où coexistèrent le « principe de délicatesse » évoqué par Sade dans une lettre à sa femme et la phrase de Novalis qui affirme : « Dans toute œuvre d’art finie, il y a une part d’infini » – phrase relevée par Benoît pour clore ses notes préparatoires au costume du cérémonial –, ce moment donc, où selon Annie Le Brun, il devenait ainsi possible de faire « scandaleusement coïncider la dimension sensible de Novalis avec la dimension physique de Sade », ce moment définitif modifia en profondeur la sensibilité des présents. Sans cette rage inhérente au désir, « celui-ci s’effondre en approximations répétitives qui commandent justement l’art et l’érotique de notre temps », insiste encore Annie Le Brun, soulignant : « Jean Benoît avance en ‟écart absolu” de notre époque. »
Sachez aussi que l’on doit à Benoît le stupéfiant costume de nécrophile, en Hommage au Sergent Bertrand, qui fascina l’assistance lors du vernissage de l’exposition surréaliste consacrée, justement, à l’Écart Absolu fouriériste, en 1965, ou encore Le Bouledogue de Maldoror, sculpture réalisée à partir de gants de cuir de petites filles et de tessons de bouteille, toujours à l’occasion de cette exposition. Autre remarque d’Annie Le Brun, concernant la personne de Benoît : « C’est un exhibitionniste […] pour faire scandaleusement voir, à l’instar de Cravan, qu’il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l’obscurité ».
Dans son texte destiné à introduire l’exposition Picasso érotique en 2001, Annie Le Brun écrit qu’avec Les Demoiselles d’Avignon Picasso avait mis la « peinture dans le boudoir », et rappelle que le premier titre de ce tableau, donné probablement par Apollinaire, était Bordel philosophique. Son étude relève que Picasso aura été hanté par la chose érotique « au point de sembler la faire coïncider, de ses débuts à ses derniers jours, avec l’énigme de la représentation. Comme si, chez lui […] l’invention de la forme avait essentiellement à voir avec le surgissement du désir ». De manière presque tragique, Picasso consacra en effet les dix dernières années de sa vie à l’érotisme, ce qui obligea « les uns et les autres à reconsidérer son œuvre et sa vie à cette lumière », mais trop souvent « au gré de considérations psychologiques, psychanalytiques ou esthétiques à éclairage faible » ; la peur d’affronter la brutalité du désir ? Certainement ! Pour Annie Le Brun, en effet, l’affirmation du désir « comme conscience physique de l’infini » est indissociable de la révolution surréaliste.
Pour Picabia, c’est le combat perpétuel qui se joue en lui entre l’action de peindre et celle d’écrire qui va nourrir une des œuvres les plus chahutées-chahutantes de la modernité ; Apollinaire pourra ainsi évoquer « les poèmes peints » par le génial amateur de grande vitesse et d’automobiles, qui finira par inscrire à même le tableau « non seulement le titre, mais une multitude d’inscriptions » devenant partie intégrante de l’œuvre « jusqu’à prendre complètement possession de la représentation ». Et puis voici le désir du désir : « Notre phallus devrait avoir des yeux, grâce à eux nous pourrions croire un instant que nous avons vu l’amour de près », déclare-t-il dans son livre Jésus-Christ rastaquouère, lui qui savait traiter de l’athéisme avec l’humour utile !
Comme je l’ai suggéré au début, je ne vais plus m’attarder que sur deux des personnalités choisies par Annie Le Brun, sachant que les affinités électives jouaient à plein entre elles ; il s’agit de Toyen et de Radovan Ivšić. Somptueusement méconnue jusqu’à ce jour – mais une grande exposition internationale est en préparation, me dit-on –, Toyen, cette créatrice venue de Tchécoslovaquie rejoindre les surréalistes en 1947, après « le coup de Prague », avait abandonné son nom d’origine pour ce pseudonyme en hommage à la Révolution française et à l’appellation de « citoyen » qu’elle avait faite sienne en en enlevant la première syllabe. Quand on tentait de la ramener à son activité picturale, Toyen s’insurgeait vivement en affirmant : « Je ne suis pas peintre » ; affirmation à laquelle elle ajoutait volontiers : « Je suis poète ». Car elle affichait le plus grand mépris « pour la peinture comme affaire esthétique et pour les peintres producteurs de peinture, ceux qu’elle appelait ‟les fabricants” », rappelle Annie Le Brun.

« La rencontre », de Leonora Carrington et Max Ernst (vers 1939) © CC/Gautier Poupeau
Dans sa jeunesse, durant les années 1920, par d’innombrables dessins et croquis érotiques, « elle réalise, comme en se jouant, un extraordinaire panorama des pratiques sexuelles », ce qui « laisse à penser l’importance qu’elle accorde à cette part de l’activité humaine », écrit Annie Le Brun, qui ajoute : « C’est en ce sens que j’ai déjà été amenée à voir en Toyen l’inventeur d’une catégorie inconnue jusqu’à elle, l’humour érotique, misant sur le vertige du nombre et de la variété pour atteindre un seuil de turbulence érotique, au-delà duquel toute emprise idéologique devient impossible ».
Au fil des années 1930, à Prague, Toyen ressent l’horreur de ce qui se prépare ; et, de 1939 à 1944, elle abandonne pratiquement la peinture pour entreprendre plusieurs cycles de dessins dans lesquels son « insurrection lyrique » va se manifester violemment ; ce sera d’abord Les Spectres du désert (1939), puis, la même année, Seules les crécerelles pissent tranquillement sur les 10 commandements, ensuite Tir (1940), et enfin Cache-toi, guerre – titre emprunté à Lautréamont –, le cycle le plus accompli peut-être, avant Ni ailes, ni pierres : ailes et pierres, celui qu’elle réalise en France, après avoir renoncé à la nationalité tchèque ; je l’entends encore répliquer avec véhémence, et son savoureux accent : « Tu sais, moi je suis apatride ! », quand quelqu’un tentait de lui rappeler ses origines. De ce dernier cycle, Annie Le Brun peut, à juste titre, affirmer que sa « valeur fondatrice […] ne fait aucun doute, au point de déterminer toute la suite de l’œuvre de Toyen », œuvre qui voit se multiplier les éblouissants tableaux des années 1950 à 1970, où le merveilleux est à demeure, comme ces collages d’une extrême liberté qui lui feront noter, en 1976, cette rare confidence : « Dans la salle obscure de la vie, je regarde l’écran de mon cerveau ».
Si je me suis, jusqu’ici, surtout attaché aux créateurs d’images visuelles – peintre, dessinateurs – dont Annie Le Brun avait accompagné la trajectoire par ses textes, c’est avec un poète, créateur d’images en mots, que je vais conclure ; il s’agit de Radovan Ivšić, sachant que le secret des images tient tout entier dans la poésie.
Venu de Zagreb en 1956, afin de mettre de la distance entre le titisme et lui, Ivšić rejoint aussitôt André Breton, Benjamin Péret et le surréalisme, son habitat naturel. À moins que celui-ci ne soit la forêt insoumise, ce qui, d’ailleurs, ne serait pas sans analogie, le jeu de « l’un dans l’autre » pouvant ici démontrer sa capacité à faire surgir la vérité du langage. Rappel : ce jeu, « découvert » en 1953 par Breton et Péret, s’appuie sur l’idée que n’importe quel objet est contenu dans n’importe quel autre, comme la crinière du lion est au bout de l’allumette que l’on vient de craquer, l’analogie imposant alors sa réalité poétique. Revenons à Radovan Ivšić qui n’a cependant pas quitté la scène, le théâtre étant l’un de ses domaines créatifs favoris, comme on va le voir.
Dès l’adolescence, fasciné « par le vertige végétal du tableau d’Altdorfer Coin de forêt avec saint Georges combattant le dragon […] Radovan Ivšić reconnaît son monde comme on choisit son camp », écrit Annie Le Brun qui, de longues années compagne du poète, sait de quoi elle parle. Et si Ivšić n’a cessé, dans ses écrits, d’évoquer les splendeurs contradictoires de la forêt, c’est aussi « pour y discerner de quoi combattre l’univers unidimensionnel censé être le nôtre depuis que technique et idéologie conjuguent leur puissance de domestication », analyse encore l’auteur. Ainsi, en 1943, dans sa pièce Le Roi Gordogane, évoquant la folie meurtrière du pouvoir, Ivšić imagine que son personnage, « après avoir tué tout le monde, va dans la forêt pour anéantir, arbre après arbre, ce qui vit encore ». À noter que cette pièce, l’une des huit écrites par Ivšić, fut créée sur les ondes de la RTF, en 1956, avec une distribution de rêve (Michel Bouquet, Alain Cuny, Jean Parédès, Daniel Sorano…), et que l’on pourrait en situer l’importance en évoquant Alfred Jarry et Witold Gombrowicz, si sa singularité ne l’autorisait à créer elle-même son propre espace.
La forêt, donc, omniprésente dans l’œuvre poétique d’Ivšić, que ce soit par l’image de la forêt dévastée qui menace l’imaginaire, comme dans ce long poème, « Narcisse », écrit en 1942 – saisi à l’imprimerie par la police de l’État fasciste croate, parce qu’accusé de symboliser l’art dégénéré, et interdit pour cela par un acte officiel ; que ce soit la forêt du commencement infini – « commencement du monde, commencement de l’aventure, commencement de l’amour » – comme dans la pièce Airia, cette « tragédie d’où toute culpabilité est absente » ; qu’elle soit le paysage du dépaysement comme dans le poème « Mavena », où l’on trouve cette injonction : « Ne regarde pas avant de voir » ; ou encore que ce soit la forêt des éclairs, comme dans le poème « Autour ou dedans », où il rejoint sa grande amie Toyen « dans ce que j’ai appelé ailleurs une érotique de l’analogie […] à mesure que l’amour prend son sens à devenir incarnation du sens », écrit Annie Le Brun, la forêt du désir opère aujourd’hui un retour en force dans l’imaginaire collectif, car « s’opposant au paradigme du rhizome et de ses modes de nivellement par le bas, se trouve affirmée là, telle une réponse de la vie à ce qui cherche à l’anéantir, l’idée d’un autre devenir par arborescence », dit-elle encore, avant de conclure : « Il sera toujours une fois dans la forêt, disent les contes. Radovan Ivšić savait le secret pour que ce ne soit pas seulement dans les contes : Prenez-moi tout, mais les rêves je ne vous les donne pas ». Tout le livre d’Annie Le Brun brûle littéralement de passion. Puisse cet éclairage très partiel inciter le lecteur à aller y voir de plus près : c’est le seul but de cette chronique !
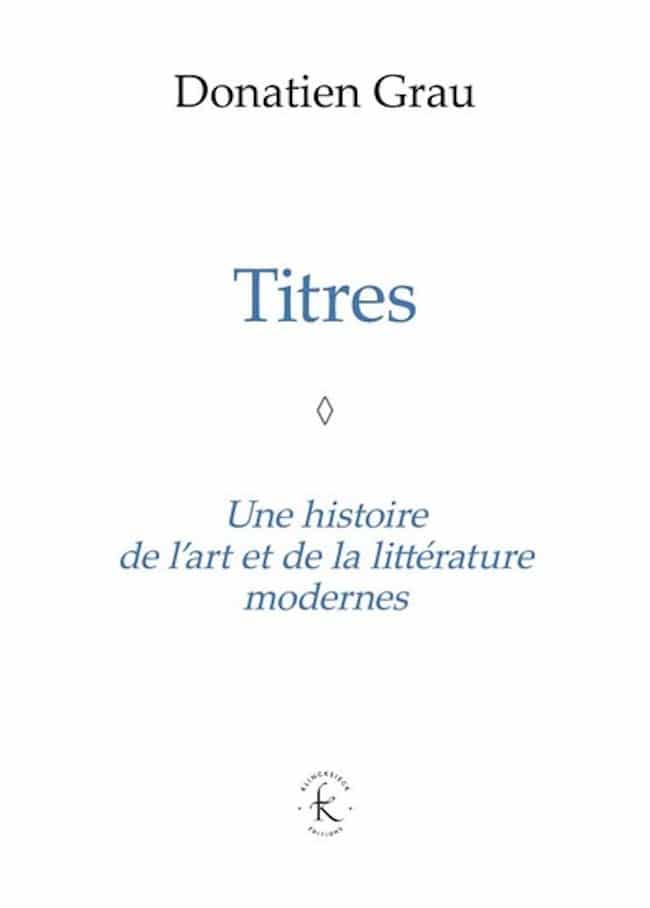
Pas tout à fait, puisque je dois maintenant aborder la question et le rôle du titre dans l’art et la littérature modernes, selon Donatien Grau. Son étude analyse comment, des années 1890 aux années 1920, la relation du mot à l’image se trouve portée au devant de celle qui rapproche Paul Gauguin et Alfred Jarry, Paul Cézanne et Émile Zola, André Gide et Henri Matisse, Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso, Francis Picabia et Tristan Tzara, ou André Breton et Max Ernst. Louable entreprise qui semble toutefois menée sur la base d’une typologie aride, un brin sémiotique, quoi qu’en dise l’auteur ; à savoir les trois catégories suivantes : « Le titre énonciatif […], ce qui apparaît dans le tableau est en évidence annoncé par le titre ; […] le titre métaphorique, qui procède par abstraction ou par image ; […] le titre disjonctif, qui opère par effet de surprise ou d’antagonisme ». Le but de l’opération est de démontrer que ces trois catégories ne constituent pas « des blocs hermétiquement séparés les uns des autres, mais au contraire d’examiner leur porosité », notamment entre les écrivains et les plasticiens. Bon.
Il me semble, à moi, que la dimension poétique du rôle du titre, à peine effleurée ici, joue pourtant une partition capitale, ce qui n’avait pas échappé à Marcel Duchamp puisqu’il considérait le titre comme une couleur en plus, ou encore comme une couleur invisible ; on n’image pas, en effet, Le Grand Verre sans son titre La mariée mise à nu par ses célibataires, même, car où serait alors l’énigme en pleine lumière ?
Supposition : vous êtes peintre ; vous mettez trois pommes dans un compotier, et vous en faites un tableau. Nous supposerons aussi que vous avez du « talent ». L’œuvre achevée, vous l’intitulez Compotier aux trois pommes. Dans le monde de la tautologie, il ne se passe jamais rien. C’est le cas. On taira votre nom. À présent, vous êtes un autre peintre, vous peignez une seule pomme qui envahit l’espace de toute une pièce. Vous titrez La chambre d’écoute ; et c’est une avalanche d’associations, d’interrogations, d’hypothèses, de mystère et d’humour qui, aussitôt, déferle sur le regardeur. Le passage de la quantité misérable à la qualité supérieure se matérialise (le marxisme est donc concerné !), et la pensée poétique prend le pouvoir – ou le grand large, si vous préférez : vous êtes René Magritte.
On vient de voir que le rôle du titre pouvait être fondamental dans l’approche d’une œuvre. Alors, qu’en est-il de ceux qui prétendent s’en passer ? Ne serait-ce pas opérer un désolant retour vers l’art pour l’art ? Car c’est prétendre que la seule manipulation des couleurs et des formes peut constituer un « événement », c’est isoler la peinture au cœur d’un monde vide de sens où virtuosité, savoir-faire et satisfaction rétinienne tiendraient lieu de contenu, c’est négliger l’importance de l’être qui peint et récuser ce que la force et le désir de son inconscient le poussent à mettre au jour.
Car le « titre » ne formule pas une interprétation, il agit comme « un mot de passe » en ouvrant librement un univers à l’imaginaire. Il suggère au regardeur qu’il y a quelque chose de plus que le résultat d’habiles coups de pinceaux, et qu’il convient d’abord de trouver ce quelque chose pour soi, quitte à en faire part à tous par la suite. Le titre provoque une rêverie active, conquérante, dynamique, allant bien au-delà de la porte qui vient de s’ouvrir grâce à lui, en plein territoire poétique. L’énigme que renferme le tableau n’est pas nommée par le titre, son existence est simplement signalée, et son dévoilement est implicitement sollicité par le peintre ; « Quand on intitule un fer à repasser Le Sourire de la mariée, TOUT se met à bouger ; pas seulement le fer à repasser », déclare Georges Raillard dans ses entretiens avec Miró, en évoquant Picabia.
Cette longue digression éloigne et rapproche dans un même mouvement du livre de Donatien Grau. Elle en éloigne parce que cette dimension poétique du titre est précisément ce qui manque à ses analyses ; elle en rapproche, parce que c’est quand même du titre qu’il est question, finalement ! Pourtant, nous divergeons grandement sur son véritable rôle.












