Il n’y a pas une poésie d’Europe centrale, encore faudrait-il définir cette contrée à l’identité introuvable. Il y a des poésies, des poétesses et des poètes en grand nombre, dans cette région aux fortes traditions poétiques. Et ils valent d’être entendus. C’est d’eux que la revue Po&sie, dirigée par Michel Deguy, nous invite à lire des textes traduits d’une dizaine de langues, y compris l’allemand et l’italien. Une cinquantaine d’auteurs de plusieurs générations (le plus âgé est né dans les années 1920, le plus jeune dans les années 1990) sont rassemblés en deux numéros spéciaux qui constituent une anthologie mémorable. Une généreuse occasion de lire ces poésies trop ignorées, et d’y adjoindre le recueil d’une jeune poétesse polonaise.
Po&sie n° 170 : Europe, centrale. 1. Po&sie n° 171 : Tu étais l’Europe. 2. Belin, 2 vol., 124 p. et 180 p., 20 € chacun
Justyna Bargielska, Nudelman. Édition bilingue. Trad. du polonais par Isabelle Macor. Lanskine, 72 p., 12 €
Ni recension chronologique ni échantillon représentatif, cet ensemble de textes ouvre une porte sur une production contemporaine riche et variée, que l’on se gardera de caractériser. Le maître d’œuvre de ces numéros de Po&sie, Guillaume Métayer, met en garde contre « le fantasme d’une ontologie régionale » ; il y voit un « ensemble opaque » et préfère s’interroger sur ce que « cette région a longtemps été et est encore pour nous ». D’où son choix d’associer des traducteurs, parmi les meilleurs, à la sélection des textes. Cela donne une anthologie « décentralisée », où chaque traducteur ou traductrice apporte, dans notre langue, sa propre lecture. Tous, souligne Métayer, « se sont faits les passeurs des langues et des cultures de cette Europe ».
Les auteurs du premier volume sont classés par domaine, c’est-à-dire par langue : l’allemand, le croate, le serbe, le romani, le hongrois, le slovaque, le roumain et le polonais. Dans le second numéro, cette répartition est abandonnée, avec une dominante allemande, et quelques poèmes traduits de l’italien, du bosniaque, du yiddish, du bulgare et de l’ukrainien. Cette entrée par les langues est sans doute la plus judicieuse. On regrettera l’absence des langues baltes ; la loi du genre, dira-t-on, mais elle nous prive de quelques grands poètes, comme par exemple du Lituanien Tomas Venclova.
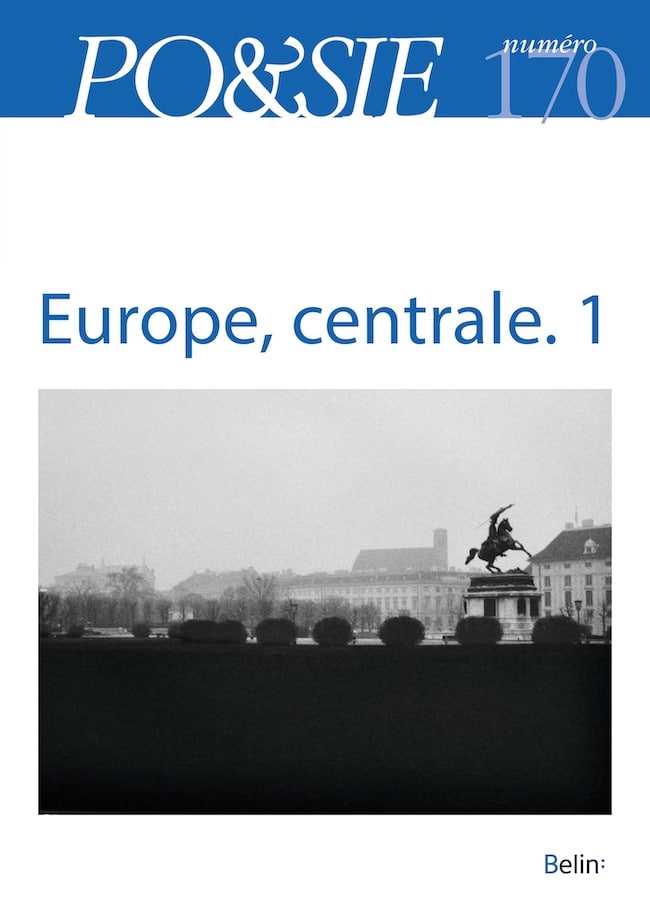
Aussi, en se promenant dans ces deux volumes, traverse-t-on des paysages insolites : « Les poètes, affirme Wojciech Bonowicz, sont des vaches qui à la pleine lune / peuvent paître à des carrefours de plusieurs étages / où il y a peu de circulation. […] / Les poètes sont un souci une habitude bête/ dont on ne peut aucunement se débarrasser à l’aide des guerres du progrès / des nationalismes de la bourse et autres métaphores accrocheuses » (trad. Isabelle Macor). L’auteur écrit de Cracovie. Lui fait écho la « minimaliste subtile » de Prague, Viola Fischerová, laquelle aperçoit « des blanches roses violines » qui « dans la mer se soulèvent » : « jetées sur des pierres sèches / elles endurent ce qu’est / être étranger sur la terre » (trad. Xavier Galmiche). On sent une même colère rentrée dans les supplications d’un poète de Budapest, István Vörös, qui joue avec une forme traditionnelle – ici le psaume – et la détourne. Psaume VI : « Seigneur fais que la nuit / noire ne soit, car j’ai peur / […] Seigneur, fais que les humains / demeurent coupables : sans quoi je n’oserai pas / les regarder dans les yeux ». Psaume XXX : « Il n’est pas facile / d’obtenir un visa pour Ton univers. / […] Tu verrouilles / les cieux avec un blanc cadenas / et Tu plies bagages » (trad. Efraim Israel et Pierre Valine). Colère que l’on entend encore derrière le lyrisme élégant de la grande poétesse de Cracovie, Ewa Lipska, qui fait en trois lignes le bilan d’une époque : « Personne n’imaginait / que l’oiseau tiré à la fronde / nous reviendrait sous forme de pierre. » (trad. Isabelle Macor)
Le dispositif formel peut dessiner sur la page un territoire qui devient une image de soi, une identité moquée, en fait. Le Croate Branko Čegec nous parle ainsi de Trieste, cette ville au nord de Venise que se disputent nationalistes italiens, Croates et Slovènes. Il trace un premier paragraphe en lettres capitales, des vers alignés sur la droite, où nous voyons l’auteur en partance pour l’Amérique. Du bateau, il s’écrie : « TRIESTE EST À NOUS ! CELA RÉSONNAIT / DANS NOS OREILLES, SANS ÊTRE DANS NOS YEUX » ; suit un intertitre en gras, politique : « eurasie », puis une longue phrase se déroule, sans alinéa ni majuscule, qui serpente sur l’essentiel de la page. On passe de la mélancolie nationale à l’orgie sexuelle : « entre les jambes du continent eurasiatique c’est beaucoup plus calme que ce qu’affirmaient les journaux télévisés du moins pendant que tu es dedans ; c’est très humide, tu sens la pulsation, tu entends le vacarme […] tu croises [la belle american girl] dans des cafés, à l’heure du déjeuner à istambul modern, tu désires sans ambiguïté et le lui fais savoir sans ambiguïté : elle remue ses fesses avec brio entre les jambes du continent ». Et ça vire à la « fornication intercontinentale » devant « une vidéo de bill viola : des tripes, de la cervelle, l’abîme des entrailles, tu essaies de la mouiller avec tes doigts, elle remue les fesses… » (trad. Vanda Mikšić).
Le domaine croate, bien représenté dans le numéro 170 de Po&sie, surprend par sa richesse poétique très contemporaine. La Croatie est, avec la Bosnie, le pays qui a le plus souffert des guerres yougoslaves des années 1990. Les blessures sont toujours présentes, quel que soit le propos du poète choisi. Elles effleurent l’évocation assez classique des îles dalmates faite par une jeune poétesse mélancolique, Katja Grcić, née en 1982 à Split, c’est-à-dire en face de ces îles alors transformées en camps : « l’été est le meilleur moment / pour la violence. / Avec toutes ces cigales /c’est à peine si / on peut percevoir un cri » (trad. Daniel Baric). Monika Herceg, qui, petite fille de trois ou quatre ans, a vu la guerre, nous livre un regard dur, avec un sens redoutable de l’énigme : « L’avenir est arrivé trop vite, / l’avenir est arrivé par surprise / comme un regard sur la platitude de son propre bonheur. » Un autre poème intitulé « Archipel » : « j’ai peur qu’un jour / on ne mange notre sens de l’humour », et plus loin : « as-tu attrapé un brin de soleil aujourd’hui / c’est important d’ensoleiller la tristesse, même peu » ; le titre d’un autre formule la vie : « Entre nous le silence s’éteint », que l’auteure peint ainsi : « tel est l’état de guerre entre moi et le monde depuis toujours / une profonde inquiétude sous le visage qui sort devant / les êtres humains et fait semblant de pouvoir dire / tout ce qu’il faut dire » (trad. Martina Kramer).
La fréquentation, pendant des semaines de confinement, de cet ensemble de poèmes en vers libres ou en prose (pas de vers comptés dans les traductions) transporte dans un univers sans véritable unité, bien sûr, mais dont le parfum, les couleurs, les mots, une petite mélancolie, un humour noir et des extravagances colorées (souvent sexuées) ne trompent pas. C’est bien l’Europe centrale. Voyez « Hypnothérapie », ce magnifique poème d’István Kemény, « le grand poète de sa génération », qui s’enroule comme une longue méditation autour de la proposition si typiquement hongroise, stéréotypée même : « Maintenant vous être triste, triste / triste ». Il s’adresse à lui-même, se vouvoie : « Vous êtes assis sur un banc dans le parc. » Tout passe, l’âge, les souvenirs, la patrie – « les jardiniers du monde civilisé souffleront / hors des promenades les feuilles mortes » –, les amis, les artistes, la famille, etc. « Vous êtes triste. Pas infiniment, / juste extrêmement. / Vous pensez à votre âge. Vous êtes vieux. / Plus vieux que votre âge. Vous êtes un moderne. » Il ne reste que la tristesse : « Triste. Vous pensez que peut-être / il en est ainsi pour vous du bonheur. / Mais vous n’êtes pas déçu, pas en colère, / pas impatient, vous ne vous moquez même pas de vous-même. / Vous n’êtes pas non plus satisfait. Triste. / Triste, solennellement. / Vous pensez à la tristesse. Vous puisez de la force en elle. » (trad. Guillaume Métayer) Cela dit-il le temps d’aujourd’hui ?

Pas forcément, car la musique est toujours là. Que ce soit dans l’apostrophe ironique de Wolf Kirsten qui joue avec la cacophonie de sa chère Bucovine – « des schistes mellites en filons popianka / aucun slowarnik n’en parle, / d’où te vient ce savoir ? et moi qu’en sais-je donc ? » (trad. Stéphane Michaud) – ou dans « L’aboiement » de la poétesse de Cluj, Marta Petreu, qui est « heureuse » – « je ne suis plus triste mes phantasmes sont partis / aujourd’hui découpée à la bêche mon ombre s’en va elle aussi » (trad. Dumitru Tsepeneag) –, les sons emportent. Chez Krzysztof Siwczyk, cocréateur en Pologne d’un groupe poétique au nom programmatique, « À la sauvage », « la chose est claire » : il observe « le transfert fluvial nul et non avenu des jours / de joyeux ennui ininterrompu » ; « vendredi la terre s’étendait à perte de vue noire et trapue », et il conclut sur une interrogation : « comment on peut se faire ça à soi mine de rien / voir leur illusion suffisante elle était si hospitalière / elle n’avait jamais été aussi ouverte » (trad. Isabelle Macor). Est-ce si clair ? De ce jeu avec les « mots donnés », on retient « illusion ».
Car aux illusions d’autrefois répond le regard sur le monde de Justyna Bargielska, auteure de Nudelman, un recueil publié dans la belle collection de poésie polonaise qu’alimente, depuis 2015, sa traductrice, Isabelle Macor, aux éditions Lanskine. En phase avec la jeune génération, elle nous met devant une réalité anarchique, c’est-à-dire insensée, où se côtoient étrangeté du quotidien et horreurs, l’incroyable des contes de fées, le sexe, la féminité et l’enfance, la vie si liée à la mort. Celle d’un hanneton « déjà mort », « balayé », résume l’affaire : « la plupart d’entre nous sont encore en vie, / mais quelques-uns sont morts ».
Bargielska est aussi l’auteure d’un roman remarqué, construit en fragments au langage pop (Petits renards, trad. Agnieszka Żuk, Les Allusifs, 2016), qui mettait en scène une féminité à plusieurs voix face à l’oppression de la maternité. Nudelman lui fait suite, en plus radical : « Maintenant je vivrai sans rien comprendre / parmi des gens qui ne comprennent rien, / mais en robe longue avec des manches. » Bargielska est directe, elle exprime un monde humiliant : « Je voudrais simplement que nous nous rappelions / que Dieu a créé le monde pour que celui-ci nous salisse, / la rose, pour qu’elle raconte des histoires comiques / d’escargots qui la mangent, et nous, afin que nous sortions à la rencontre / d’une mort certaine et rentrions pour le dîner, / à condition de ne pas trop faire attention. » Des images, pas des métaphores, convoquent le fait divers. Évoquant un « monde des jalousies », elle lance : « la mort sans gêne s’est installée dans la vie, / l’incendiaire a pris deux cents litres d’essence dans les bidons / et un repas gratis, et ta femme m’a envoyé un sms : j’existe ».
Après l’expérience décisive d’une fausse couche, Bargielska se démarque dans ces textes cruels de la critique sociale féministe, elle joue avec des images patriotiques-patriarcales, si intenses en Pologne, joue avec leur perversité – à la fois source de violence et de plaisir – ce qui, selon une de ses commentatrices polonaises, fait ressortir un « ton métaphysique ». C’est son « plan B » : « Tu sais quelles sont nos chances ? Nulles. / Mais j’ai appris qu’il fallait jouer à gagner du temps, / car justement le corps, c’est ce qui reste sur le champ de bataille. » Pour cette nouvelle génération, la vie est une vilaine bataille.











