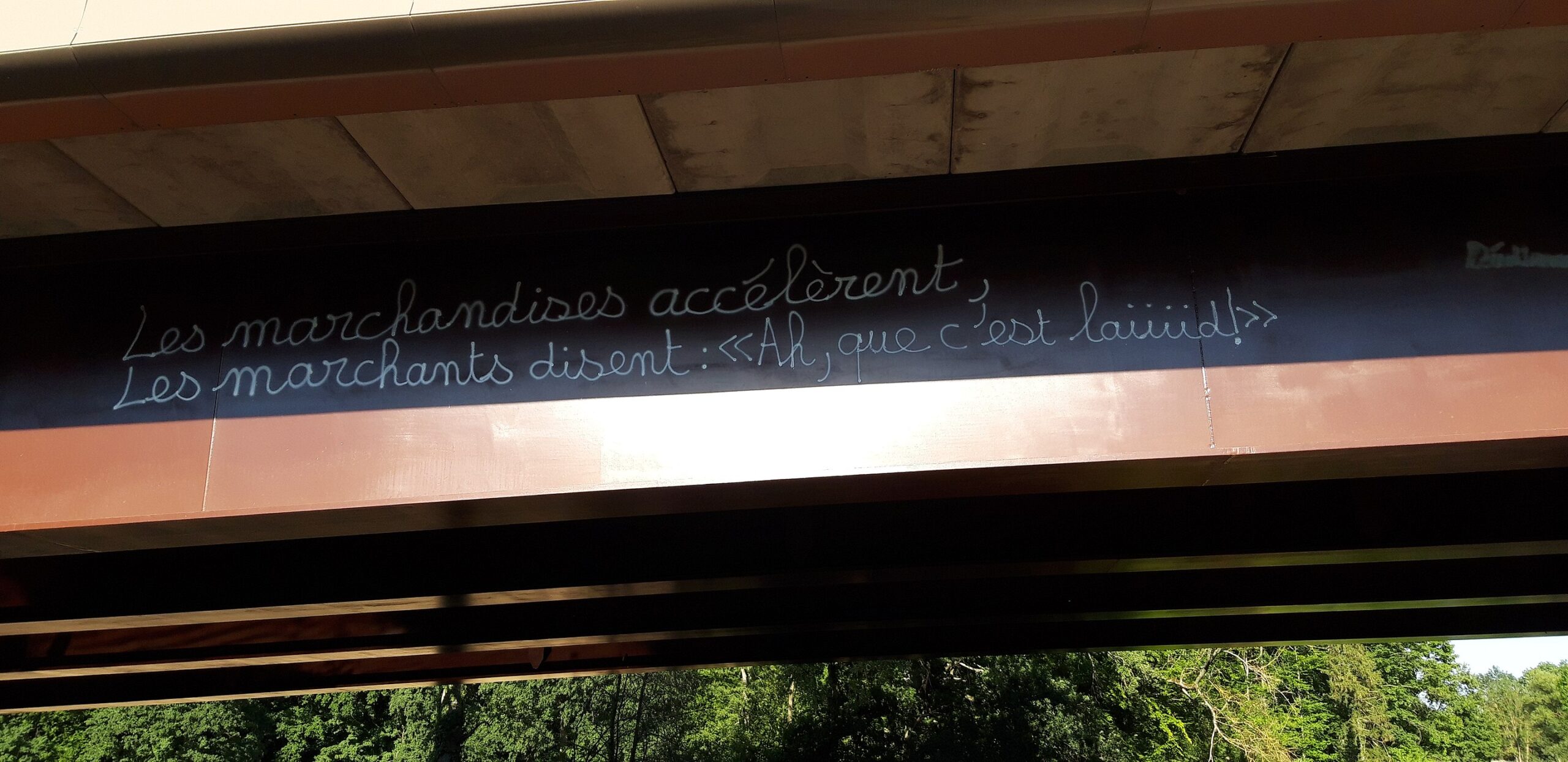Depuis des siècles, la conscience historique des Occidentaux est marquée par la décadence et la chute de Rome. On y revient ces temps-ci avec des discours apocalyptiques dont la mode pourrait expliquer la panique qui nous a saisis à l’occasion de l’épidémie actuelle. Confinés dans une obsession de la maladie, nous pouvons en profiter pour nous interroger sur ce qu’il en fut réellement de l’effondrement de l’Empire romain. Paru à l’automne dernier, le livre de Claire Sotinel, Rome, la fin d’un empire, en fournit l’occasion.
Claire Sotinel, Rome, la fin d’un empire. De Caracalla à Théodoric. 212-fin du Ve siècle. Belin, coll. « Mondes anciens », 688 p., 49 €
Il convient de saluer cette entreprise éditoriale de la collection dirigée par l’historien de la Révolution Joël Cornette : on est là devant un bel exemple de livre « à offrir ». Magnifiquement illustré de cartes et d’images peu banales et soigneusement commentées, le livre de Claire Sotinel se lit avec aisance et offre à qui connaît mal cette période une première approche bien documentée et présentée dans une écriture fluide. On est là devant une histoire narrative dont les personnages principaux sont les grands hommes, à savoir principalement les empereurs successifs et leurs entourages. Pour qui veut découvrir cette époque, ce parti pris se défend tout à fait. La présentation ainsi donnée de la trame politique est nourrie des travaux les plus récents, dont beaucoup ne sont pas encore traduits de l’anglais, de l’italien ou de l’allemand. Elle fait bien sentir que, « si cet empire a bien disparu, ce n’est pas par une chute brutale mais à travers un lent et complexe processus politique s’inscrivant dans une société en cours de transformation ». Ainsi sont donnés au lecteur « des outils pour enrichir sa propre réflexion sur la fin d’un empire ».

Ruines de l’arc de Constantin, par Canaletto (1742)
Le livre s’ouvre avec l’édit de Caracalla qui, en 212, donna la citoyenneté à tous les hommes libres de l’Empire, et il se referme, vers l’an 500, sur la royauté de Théodoric, reconnue officiellement par l’empereur qui est à Constantinople. Ces dates se justifient de façon positive, mais aussi négativement : les retenir, c’est ne pas reprendre celles que mettent en avant les défenseurs de la notion de « Bas Empire », pour qui la fin débute avec la mort de Marc Aurèle en 180 ou celle de Commode en 192, et s’achève trois siècles plus tard, avec la déposition de Romulus Augustule par Odoacre en août 476. Ce décalage d’un quart de siècle avec les dates habituellement retenues peut paraître anodin ; en réalité, il change tout à fait l’éclairage. L’édit de Caracalla est un progrès et Théodoric un grand roi. Aller de l’un à l’autre n’est donc pas suivre un chemin descendant.
Depuis Montesquieu, expliquer la chute de l’Empire romain est un des projets les mieux partagés par les historiens et les penseurs politiques. Parmi les explications récemment avancées, nous touchent particulièrement celles liées à la pollution par le plomb, aux modifications climatiques et aux grandes épidémies. Elles peuvent se combiner si l’on considère la peste bubonique qui s’est propagée au milieu du VIe siècle : elle dut pour partie sa virulence à un affaiblissement généralisé de la population après un net rafraîchissement dû, pense-t-on désormais, à une désastreuse éruption volcanique en Amérique centrale. Claire Sotinel ne s’attarde pas sur cette peste justinienne, qui est hors de son champ chronologique, mais elle convainc lorsqu’elle entreprend de montrer que les épidémies et les crises climatiques des IIe et IIIe siècles n’ont pas eu les conséquences à long terme qu’on leur prête, non plus d’ailleurs que le saturnisme.

Ruines du forum à Rome, par Canaletto (1742)
On ne saurait trop recommander la lecture de la dernière partie de son livre, intitulée « L’atelier de l’historien ». En une cinquantaine de pages, elle y présente les quatre grands débats que suscite la question de cet effondrement ultime : de quoi parle-t-on lorsque l’on évoque « le christianisme » dans l’Empire romain ? Qu’en était-il exactement de la présence des « barbares » à l’intérieur de l’Empire et à ses frontières ? Y a-t-il vraiment eu division de l’Empire et chute de celui-ci ? La notion de « décadence » est-elle mieux qu’un lieu commun ?
Tout l’intérêt de ces pages très denses tient au fait qu’elles présentent de façon précise et argumentée les arguments qui opposent les spécialistes. On y apprend ainsi que le débat sur la réalité ou non d’une décadence a été préempté par les tenants d’un « politiquement correct » qui refuse de « hiérarchiser les différentes pratiques culturelles », ce à quoi, bien sûr, ont répondu les adversaires du multiculturalisme et du relativisme, qui se sont posés en défenseurs intransigeants de la culture écrite et de la pensée rationnelle. Une fois exposés les arguments adverses, il est sage de conclure avec Braudel que « les rythmes de l’histoire politique, de l’histoire culturelle, de l’histoire religieuse, de l’histoire économique, de l’histoire de l’environnement ne sont pas les mêmes ». La leçon vaut aussi pour ceux qui, de nos jours, ne parlent que de décadence et d’apocalypse.