Ces Journaux de sons permettent de découvrir un aspect important du travail de Louis Roquin, compositeur et instrumentiste : sa recherche d’un dialogue entre l’image, le texte et le son, qui s’inscrit dans une riche histoire de la musique savante (ou non), qu’évoquait également John Cage dans son Autobiographie, récemment traduite.
Louis Roquin, Journaux de sons. Les Presses du réel, coll. « Al Dante », 540 p., 30 €
John Cage, Autobiographie. Édition bilingue. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Monique Fong-Wust. Allia, 64 p., 6,50 €
Le jeune John Cage est alors élève de Schoenberg. « Pour Schoenberg, l’harmonie n’était pas simplement une question de couleur : elle était structurelle. C’était le moyen dont on se servait pour distinguer une partie d’une composition d’une autre. C’est pourquoi il m’a dit que je ne pourrais jamais écrire de musique. » Ce passage de l’Autobiographie du compositeur américain (remarquablement courte) est vertigineux en ce qu’il synthétise des siècles de musique savante autour de deux concepts, l’harmonie et l’écriture de la musique, solidaires dans cette drôle de révolution viennoise où elles trouvèrent un couronnement historique et des interrogations sans fin.

John Cage © D. R.
L’harmonie, donc : structure, moyen de juger les œuvres, par nature écriture. On sait depuis les travaux de Jessie Ann Owens (Composers at Work : The Craft of Musical Composition (1450-1600), 1997) à quel point cette importance accordée à l’harmonie dans les traditions savantes occidentales est affaire d’écriture. L’essor de la partition moderne est le temps où s’inventent les possibilités d’une verticalité impensable sans support écrit. La musique commence à s’écrire, n’en finit plus de s’écrire, dans une mise en notes des sons que l’on interroge bien peu, jusqu’à ce XXe siècle qui vit John Cage, après et avant bien d’autres, tenter d’autres mises par écrit des sons : graphisme musical de Morton Feldman, fantaisies de Satie, les « sons organisés » du dernier Varèse, jusqu’à ces musiciens plus récents que ne cite pas l’Autobiographie mais qui sans peine s’inscrivent dans cette généalogie, par le biais de l’improvisation (partitions graphiques utilisées dans le free jazz et les musiques improvisées) ou de la composition (musique concrète ou « nouvelle complexité » de Brian Ferneyhough par exemple). Bref, depuis Schoenberg, et Cage en est l’illustration, on ne compte plus les attaques faites à l’harmonie et à la partition.
C’est que, depuis leurs origines, les portées recouvertes de signes ne sont pas sans poser de difficultés aux musiciens y compris de tradition classique : comment noter des bruits ? Comment marquer les instruments non tempérés, c’est-à-dire en Europe essentiellement les percussions ? Que transcrit-on par ce médium gros d’une raison graphique étrange, puisque les partitions ne sont en aucun cas une nécessité de la pratique musicale ? Si la musique est un langage, ce langage ne serait que marginalement écrit, y compris de nos jours où la partition concerne d’abord les conservatoires et écoles de musique, qui ne représentent en aucun cas la totalité des pratiquants de la musique. Cage livre quelques-unes de ses démarches créatrices pour opérer la remise en question de la grande structure historique défendue par son maître Schoenberg : utilisation croissante des percussions, partitions graphiques, fascination pour le zen, que connaissent déjà les lecteurs du Cage mémorialiste du Journal : Comment rendre le monde meilleur (on ne fait qu’aggraver les choses) ou auteur des Confessions d’un compositeur.
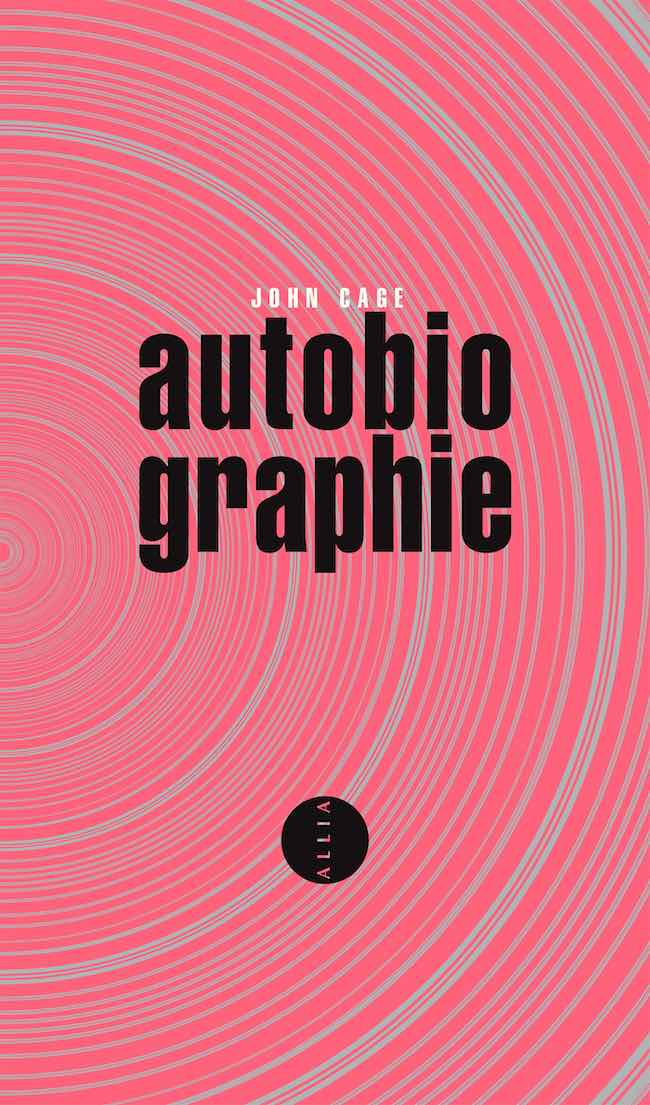
Le zen et l’Extrême-Orient ont accompagné l’essor de la modernité musicale de l’Occident de longue date : le contrebassiste new-yorkais William Parker, figure de proue actuelle de ce qu’on appelle encore free jazz, rappelle souvent à quel point le célèbre ouvrage de Herrigel – Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc – a pu innerver l’évolution de l’improvisation états-unienne depuis les années 1970. Peut-on voir dans cette fascination plus qu’une coïncidence ? Sans doute, à lire les Journaux de sons de Louis Roquin, compositeur, instrumentiste, photographe, écrivain qui tint régulièrement le journal des sons « enregistrés » depuis 1998, lors de voyages à Taïwan, au Japon, en Corée ou en Chine. Au-delà de la géographie, c’est bien à la question graphique du son que se consacre cet imposant volume qui se contemple autant qu’il se lit et, si l’on veut, qu’il s’écoute.
Chaque journal, chaque voyage suit un mode opératoire singulier où se mêlent trois « plans de mise en œuvre » (texte, photographie, partition) pour restituer les sons rencontrés. Pris entre ces trois plans, le son s’y délivre d’une manière entièrement renouvelée, abolissant ici la convention de la notation musicale et acoustiquant là une photographie banale d’une rizière chinoise. Livre impressionnant, au-delà de la technicité engagée par son auteur, Journaux de sons formule dès lors une nouvelle voie d’accès à la question du graphisme musical dans une remise en cause aussi radicale que paisible des partitions. Subverties, moquées, vidées mais révélées dans leur étonnante poésie graphique, notes et clefs de sol traversent ici les débats du XXe siècle pour s’épanouir dans une forme nouvelle, splendide, qui est musique autant qu’elle est tout le reste. Elles transpercent alors le papier pour venir se coller aux photographies, aux plans de Chine et du Japon, intégrant un espace-temps graphique plus en rapport avec l’espace-temps sonore de la musique. L’opération de Louis Roquin est d’une alchimie rare, parvenant à enfermer dans un livre ce qu’il ne peut contenir et que pourtant la lecture fait entendre : bruits, mélodies, vibrations. Peut-être, pour la première fois, peut-on tenir entre les mains un vrai journal de son.












