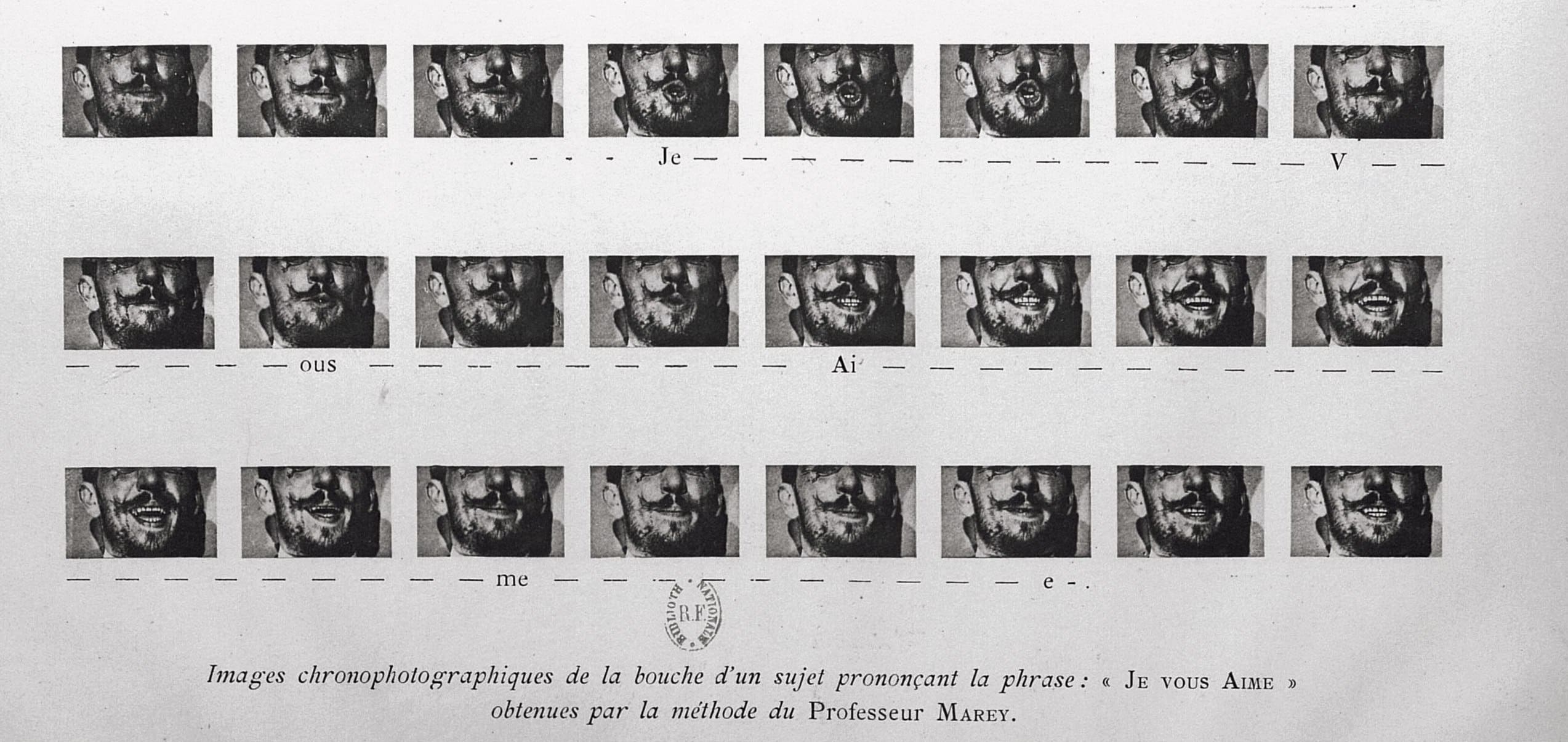Exterminations et littérature, sous-titré Les témoignages inconcevables, est né d’une quinzaine d’années de recherche. François Rastier, nourri par la philosophie kantienne de la vérité, expert des mouvements extrémistes des XXe et XXIe siècles et des discours de banalisation du préjugé racial, revalorise le témoignage contre la fiction, avec pour fil directeur l’absolue nécessité d’en finir, en littérature, avec le découplage de l’esthétique et de l’éthique.
François Rastier, Exterminations et littérature. Les témoignages inconcevables. PUF, 416 p., 22 €
En travaillant à la défense de ce genre qu’est le témoignage littéraire, proscrit par la critique et mal considéré dans le monde universitaire, François Rastier exhorte son lecteur à sonder les raisons de l’évincement du genre des zones « nobles » du champ littéraire. Partant du constat anti-genettien que « la fiction ne fait pas la littérature », il formule ainsi la question : en quoi la fiction serait-elle dépositaire des « vérités » du monde mieux que ne le serait un témoignage, par exemple d’un survivant ?
En remettant, hors de tout moralisme, la question éthique à la première place dans l’échelle des valeurs, l’auteur conteste la primauté d’une poétique séparée de la vérité historique. Il récuse une littérarité gavée par l’autotélisme narcissique de la littérature – ce que Genette nomme son intransitivité –, victime d’une tournure fictionnelle qui ne serait pas contestable si elle n’usurpait ici la légitimité du témoin et ne falsifiait, par une stylisation dangereusement déformante, la valeur de vérité du récit testimonial. Pour Rastier, une « poétique qui définit exclusivement la littérature par la fiction » et conforte l’idée reçue selon laquelle la fiction est « supérieure à la réalité » n’est désormais plus recevable.
Ces 400 pages parfaitement argumentées, dédiées à la mémoire de l’artiste résistant cambodgien Vann Nath, sont en dialogue critique avec des textes célèbres de la littérature mondiale. Elles tiennent le pari difficile mais abouti de rehausser au rang de plein genre le récit testimonial, prolongeant la démarche humaniste amorcée en 2005 avec Ulysse à Auschwitz (Cerf, 2005) où François Rastier se mettait à l’écoute de la poésie si mal connue de Primo Levi et de ses traductions, lesquelles, à l’ère contemporaine de la post-vérité, rappellent combien la question d’écrire pour témoigner d’une humanité soumise à la barbarie se pose plus que jamais.

Primo Levi
Dans cet ouvrage structuré en crescendo éthique, le lecteur est frappé par la sobriété du ton et par sa droiture – quelque chose de l’ascèse tonale de l’aphorisme et de la réserve elliptique du témoignage a infiltré le souffle agissant du volume. François Rastier met ses pas dans ceux du traducteur et aphoriste François Vaucluse, qui lui-même les met dans ceux de Primo Levi, dans une lignée commune de dignité. La réflexion intransigeante que l’essai instruit met à nu les trémulations d’une fiction désormais fourbue, vidée par un intellectualisme outrancier dissocié de la pensée humaniste. De fait, l’engouement contemporain pour la fictionnalisation fantaisiste de faits historiques, dans des œuvres au tonnage stylistique massif, ne semble plus s’assouvir que dans ce qui revient au fond à une profanation de l’épreuve, celle d’humains persécutés, ici ou là – profanation par inversion spectaculaire du Bourreau et de la Victime, comme dans Les bienveillantes de Jonathan Littell (Gallimard, 2006). François Rastier le certifie, « l’éthique des témoignages littéraires devient de plus en plus éclairante et nécessaire », pour contrer notamment les « prétentions du roman à dépasser l’histoire » et son instrumentation confusionniste. Car les témoignages obligent à la réévaluation des rapports entre littérature et histoire en déplaçant le curseur des valeurs vers la victime, ce qui défait le narcissisme exalté – hérité du romantisme tardif – d’un écrivain au « surhommisme nietzschéen ».
L’introduction de l’ouvrage met en place très précisément le cadre conceptuel et les contours épistémologiques de cette offensive contre une fiction abusive qui brouille la visibilité des récits de témoignage des violences politiques de masse. En exposant les différences esthétiques qui séparent le romanesque du témoignage, François Rastier souligne la posture égocentrée de l’auteur dans ce romanesque au « grand style » – notamment dans le roman à succès prenant les camps d’extermination comme décor –, réprouvant le pathos qui, adjuvant de la violence cynique du tueur, en amplifie la voix. À l’inverse, le témoignage est porté par la retenue de son auteur, qui parle « pour compte tiers », ne met en avant ni héroïsation ni subjectivité et, au contraire, objective, pour remettre « le crime dans l’espace commun de l’humanité ». L’insanité du couplage qui unit esthétisation et barbarie se déploie dans des fictions historiques où infamie et grandeur se conjoignent dans une outrageuse déformation romanesque de la vérité historique, au profit de cette « divinisation de l’artiste » dont Panofsky avait retracé les étapes de l’avènement à la Renaissance. Or, la question de la vérité a été évacuée des préoccupations de la critique du romanesque : le réalisme littéraire n’est pourtant pas le réel et « chacun sait que Troie n’aurait jamais été retrouvée si Homère n’avait narré ses malheurs ». Le témoignage bouscule la norme établie : il ne répond pas au principe de plaisir édicté par le roman, mais au principe de réalité historique. Stigmatisé comme une entrave – aux idéologies populistes, en particulier –, ce genre gêne.
La première partie du livre opère l’articulation entre le présent essai et Ulysse à Auschwitz – Primo Levi nous aura fait comprendre que « seule l’éthique peut assurer une médiation entre esthétique et politique ». Le refus de la pompe et le choix du « style maigre » sont les marqueurs du profil esthétique de cet écrivain rescapé des camps qui appelle à une « éthique de la responsabilité et non de la culpabilité », entrant ainsi en dialogue avec Jean Améry. Attentif à distinguer entre victime et survivant, François Rastier entame une critique des trauma studies, ou des Holocaust studies, leur reprochant justement leur approche post-traumatique qui, en surchargeant de subjectivité le récit du trauma, le banalise en quelque sorte : « la théorie du trauma subjective les séquelles du crime, alors que le témoignage appelle à son objectivation ». À mille lieues d’une « littérature du moi », le témoignage contribue à réhabiliter l’objectivité des faits historiques, accentuant la distance qui sépare le discours historique du discours mythique. François Rastier postule que la justice exigée par le témoignage suppose la réintégration des bourreaux « au sein de l’humanité qu’ils voulaient nier », les confrontant du même coup à leur responsabilité. Les très belles pages sur la traduction, discipline insoumise et salvatrice – « traduire un livre, c’est le contraire de le brûler » –, opèrent une belle extension de son domaine au commentaire, à la réécriture, et à la critique même. Contre « l’intraductibilité », la traduction permet d’expérimenter sans égocentrisme un devenir auctorial : « par la traduction, des lecteurs peuvent franchir le pas, et finir par se compter au nombre des auteurs ».
C’est plus particulièrement la question du style et de son rapport avec les distorsions de la vérité historique qui est le sujet de la deuxième partie. Rastier y épingle les postures mitigées, les aveuglements de la critique et les décompositions intellectuelles. Au premier chef, la mort de la raison – devenue un topos de l’extrême droite – ou sa subversion cynique, à la source de l’alarmante montée de l’irrationalisme. Le pathos devient ici l’arme d’une propagande donnant « tout à voir et rien à comprendre », dédouanant les bourreaux de leur responsabilité historique. François Rastier relit les philosophes en éprouvant la violence interne et la radicalité des représentations qu’ils cautionnent. La notion d’horizon d’attente (Gadamer, puis Jauss) est problématisée : la manipulation d’une « attente » lectoriale n’est qu’une soumission conformiste au préjugé. Le témoignage, « éternellement intempestif », ne répond quant à lui à aucun « horizon d’attente ». De ce fait, il dérange. De Céline à George Steiner en passant par Sade, Giorgio Agamben, Robbe-Grillet, Blanchot et Brasillach, de Bataille à Jauss, François Rastier montre que la pernicieuse intrication de l’horreur et de la jouissance procède de ce brouillage des repères éthiques, de la suspension du jugement et, bien entendu, de l’exclusion des témoignages du domaine de l’art. Outre qu’elle ressortit à une vision libidinale de l’histoire, où l’érotisation – pire, une « pornographie du meurtre » chez Jonathan Littell – intensifie la furie exterminatrice, une telle intrication s’inscrit dans les inversions antinomiques et la déconstruction ; elle marque l’irruption mortifère du mythe dans l’Histoire, irruption dont le nazisme a illustré le caractère sanglant.
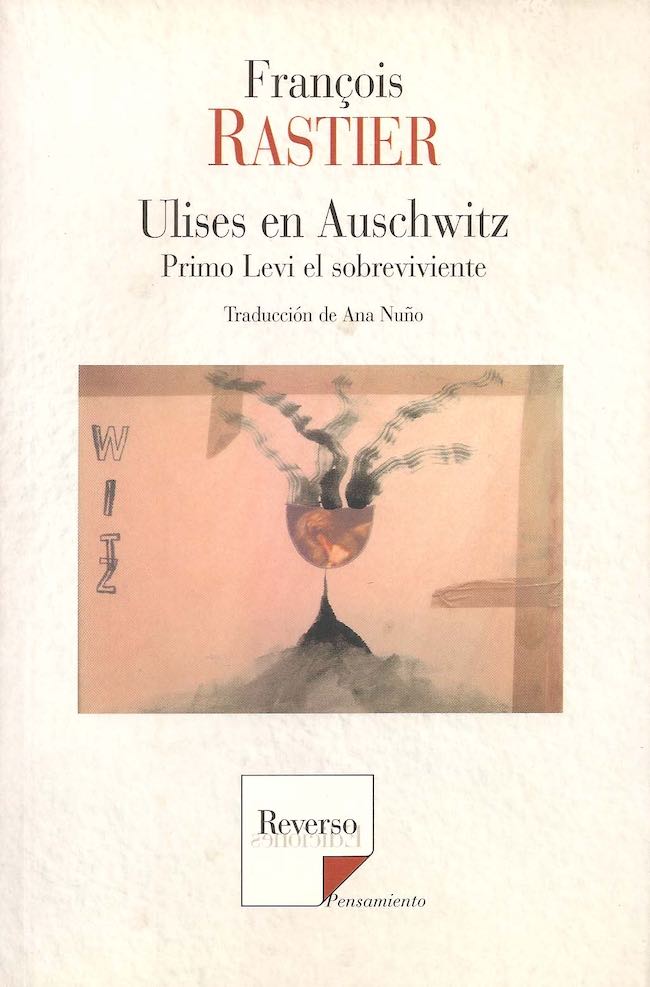
Enfin, la troisième partie, intitulée « L’Honneur de la littérature », recentre l’éthique dans la pratique littéraire – l’épigraphe de Victor Hugo reflète superbement le présupposé qui sous-tend la défense du témoignage contre l’heroic fantasy de la fiction : « Tant qu’il y aura des grimauds qui griffonnent, il y aura des gredins qui assassinent »… Contextualisant la naissance moderne du genre testimonial, « né avec la qualification pénale de crime contre l’humanité », François Rastier s’interroge sur les raisons de son bannissement de la théorie littéraire. C’est que, allant à l’encontre de la canonisation de l’écrivain professionnel – « le témoin n’écrit pas pour faire carrière » – et ne s’inscrivant dans aucun courant littéraire, le témoignage demeure en marge des réflexions essentialistes sur la littérarité.
François Rastier prolonge l’argumentation vers les problématiques des sciences du langage, dont il est un expert mondialement reconnu, et procède à une critique de l’illusion référentielle, de ce dogme qu’est devenue la référence. Aujourd’hui que celle-ci « est devenue inscrutable », comment garantir en effet l’alignement avéré de la référence de ces textes à leurs « mondes » ? Au fond, le réalisme est « toujours un conformisme que l’on prend pour une conformité référentielle ». Problématisant la théorie des mondes possibles de Thomas Pavel, François Rastier infère que « les œuvres ne créent pas de mondes », mais qu’elles « questionnent notre désir de prendre des évocations pour des réalités. Définir la distance c’est refuser l’illusion ». C’est donc à la littérature de refuser d’être un secteur parmi ceux de « l’industrie de la désinformation », de sauver son honneur en résistant à la conjonction perverse du principe de plaisir et du déni de réalité, en cultivant l’art de la « critique, entendue comme rupture du consensus et combat contre le mensonge et l’aveuglement ».
Il faut saluer cette exigence de précision et de justesse. En transmettant « l’étincelle » de la parole testimoniale de Primo Levi, en la répercutant dans une mission d’éducation qui accroît la levée du témoignage comme « front littéraire contre la barbarie », et parce qu’une œuvre littéraire « prend place dans une lignée », François Rastier s’inscrit lui-même dans le sillon d’une éthique de la transmission que la tradition philosophique judaïque ne dénierait pas, en lien étroit notamment avec la recommandation du « Rav Lakh » dans le Deutéronome – que peut-être Primo Levi connaissait. La formule signifie au sens littéral « assez pour toi » mais suggère au sens moral la nécessité de cette transmission. Le moment venu, le maître se doit, en s’effaçant, de concéder au disciple la responsabilité de la transmission de la parole testimoniale et le magistère du recueil des faits et de l’approfondissement même de la question, par l’interrogation – prophétique au sens noble et premier – sur l’existence d’autres injustices et d’autres massacres, qui se déroulent au moment même de la transmission.