Alain prônait la résistance aux pouvoirs. Mais aujourd’hui tout le monde n’est-il pas contre les pouvoirs ? On ne veut pas être trop gouverné, mais on se plaint aussi qu’il n’y ait plus de gouvernement. On accuse l’État de ne pas avoir assuré la sécurité des populations pendant une pandémie, mais on lui reproche aussi d’être trop sécuritaire. Si l’on ne veut pas sortir de cette démocratie molle et contradictoire par la dictature populiste, il faut réinventer la démocratie délibérative.
Francis Kaplan, Propos sur Alain. Édition de François Brémondy et Nicolas Cayrol. Préface de Frédéric Vengeon. Postface de Thierry Leterre. Gallimard, coll. « Folio », 192 p., 6,90 €
Jean-Claude Monod, L’art de ne pas être trop gouverné. Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 324 p., 20 €
Le livre posthume de Francis Kaplan (1927-2018) sur Alain est à l’image de son auteur : d’une honnêteté exemplaire. Ce grand professeur de philosophie, modeste et érudit, se signalait par son absence totale de dogmatisme, sa curiosité et son ironique bienveillance. Ses livres sur la vérité (La vérité et ses figures, Aubier, 1977 ; La vérité : le dogmatisme et le scepticisme, Armand Colin, 1998) sont des modèles de pensée claire et de pédagogie lucide. Ses livres sur Marx et sur la bioéthique sont des enquêtes scrupuleuses et originales.
Kaplan a beaucoup écrit sur Alain et préfacé certains de ses livres les plus connus comme les Propos sur les pouvoirs. Ses élèves et ses amis ont réuni ici certains de ses textes. Le succès d’Alain tient au fait qu’il est philosophe sans en avoir l’air. Chez lui, pas de concepts-massues, pas de jargon, pas d’érudition cachant une pensée absente, mais de fines réflexions, prenant le plus souvent la forme de propos journalistiques et de pensées morales. Quant à la doctrine, c’est celle d’un héritier de la philosophie réflexive, dans la tradition de Lachelier et de Lagneau, qui insiste sur la liberté, le pouvoir de la conscience et du jugement. Tous les élèves de terminale et de khâgne ont eu à subir ses sentences (« Penser, c’est dire non »).
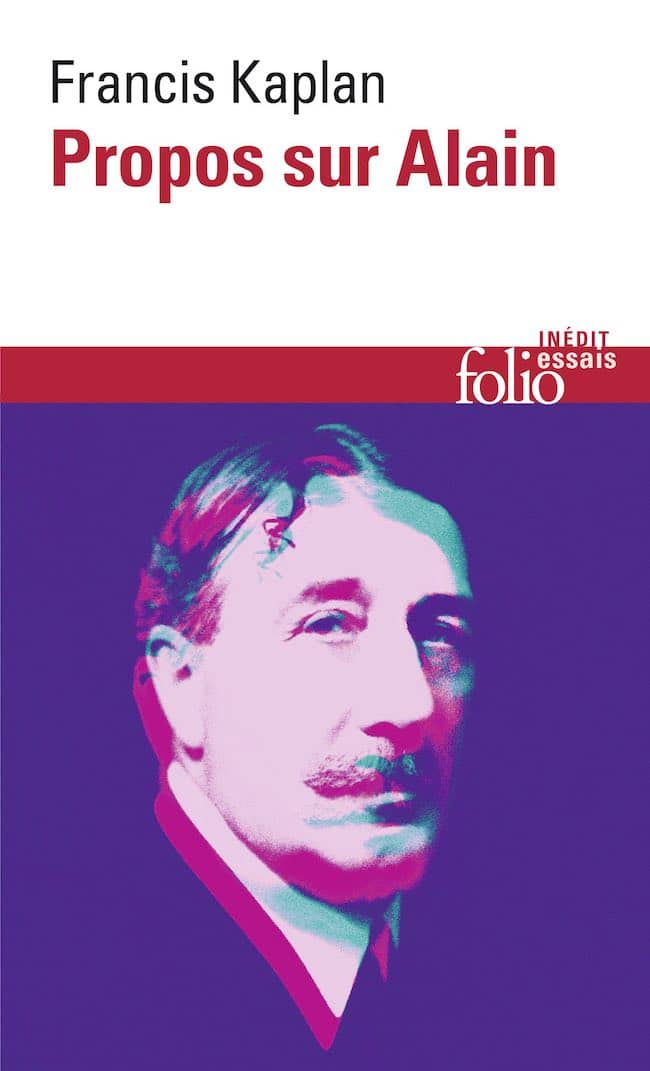
Alain et ses disciples, qui furent souvent professeurs de classe préparatoire et inspecteurs de l’Éducation nationale, détestaient la philosophie universitaire et le rationalisme à la Brunschvicg, et leur préféraient ce rationalisme aimable teinté de scepticisme souriant (dans Le confort intellectuel de Marcel Aymé, on croirait quelquefois entendre Alain par la voix de Lepage). La philosophie d’Alain, c’était la philosophie des professeurs de cette institution disparue, la « classe de philosophie » des lycées, où il était inconcevable jusqu’aux années 1940 que les élèves ne parussent pas en complet et cravate (mais ils ne représentaient alors pas plus de 5 % d’une classe d’âge). On présentait le sage normand comme modèle pour les dissertations et l’on nous disait qu’en un sens tous les philosophes avaient dit la même chose, puisqu’ils nous apprenaient la liberté par l’éducation du jugement. Peuchère ! Mais la grande leçon d’Alain, aux yeux de ses amis, fut son pacifisme et son hostilité à tous les pouvoirs. La guerre de 14 l’avait définitivement dégoûté des armées et des chefs ; et la Troisième République, des parlementaires. Il tâta un moment du radical-socialisme, signa des manifestes, mais sans jamais s’engager trop.
Le plus intéressant du livre de Francis Kaplan est un chapitre consacré à Michel Onfray, rebelle officiel à succès qui prétendit consacrer un livre, destiné, selon sa méthode de démolissage fielleux, à déboulonner l’idole de Mortagne-au-Perche en montant en épingle quelques propos d’allure antisémite de son Journal. Kaplan n’a pas de mal à montrer que le compatriote percheron d’Émile Chartier manie l’interprétation faussée et intéressée avec la délicatesse du cheval du même nom et l’incompétence splendide que confère l’écho médiatique. La démonstration est d’autant plus probante que Francis Kaplan était le fils du Grand Rabbin Jacob Kaplan (1895-1994), l’une des plus grandes figures du franco-judaïsme, et qu’on ne pourrait pas le soupçonner de jouer sur l’hystérisation de l’antisémitisme.
De quoi s’agissait-il ? Alain était un Normand, homme d’une France rurale qu’il ne cesse de célébrer dans ses livres, et un pacifiste qui, malgré les combats antifascistes, avait en 1940 plus de sympathie pour Giono que pour Benda, et pour Pétain que pour de Gaulle. Dans quelques phrases très souvent citées de son Journal, il laisse entendre qu’il n’aime pas les juifs, qui incarnent pour lui comme pour une bonne partie de la France catholique post-affaire Dreyfus le pouvoir de la banque et des affaires. Mais on trouverait des déclarations du même genre chez Julien Benda, qui lui était juif et, à la différence d’Alain, militariste convaincu, et qui dès 1933 avertissait ses compatriotes contre Hitler et réclamait un renforcement de l’effort de guerre. Vichy et l’étrange défaite, comme l’a montré Simon Epstein dans son livre Le paradoxe français (Albin Michel, 2008), ont rebattu les cartes : d’anciens philosémites devinrent antisémites, des communistes d’hier sont devenus les collabos du lendemain et des disciples de Maurras de grands résistants. Sic transit gloria mundi.
Mais qu’est-ce qu’un antisémite ? Ce n’est pas seulement quelqu’un qui dit du mal des juifs, ou qui, selon le cliché facile de Sartre, constitue l’autre comme juif par son regard, c’est surtout quelqu’un qui agit en conséquence, par ses publications ou ses fonctions, y compris quand elles revêtent l’allure grise de la fonction publique ou l’allure violette de l’évêché. Les quelques propos d’Alain dans son Journal qui ont fait scandale sont indéniablement à connotation antisémite, et montrent la débâcle de son esprit en 1940, qu’il analyse lui-même assez lucidement. Mais rien à voir avec les délires de la presse antisémite, ni avec ceux de Céline ou de Brasillach, ni avec des collaborateurs philosophes comme Marcel Déat et Jacques Chevalier, qui d’ailleurs rendirent hommage à Bergson.

Photo de classe au lycée Henri IV. À la table, le professeur Alain (vers 1914)
Le vrai problème d’Alain fut son pacifisme. Sa conception de la résistance aux pouvoirs était approuvée par ses élèves Simone Weil et Georges Canguilhem, mais ils s’engagèrent tous deux dans la Résistance, tandis que leur maître se réjouissait de Montoire. L’ennemi des pouvoirs était bien désemparé. La comparaison du journal du sage du Vésinet avec celui de Jean Guéhenno, Journal des années noires, n’est pas à l’avantage du premier. On ne reprochera pas à un philosophe d’être dépassé par les événements, du moment qu’il n’est pas dépassé dans sa pensée, même s’il aurait mieux valu qu’il ne fût dépassé ni dans un cas ni dans l’autre. De ce point de vue, Alain est et demeurera, comme le montre Francis Kaplan, un républicain, même si son héritage philosophique est sujet à caution quand on espère plus du rationalisme.
Michel Foucault a, en un sens, pris en France la place d’Alain dans les esprits. Chaque époque a sa forme de radicalisme. Comme Alain – mais sur des bases totalement différentes –, il nous a expliqué que tout pouvoir est mauvais, et que nous étions quadrillés par des micro-pouvoirs bien pires que les macro-pouvoirs d’État. Comme Alain, Foucault a pris la posture du rebelle, tout en étant bien installé dans l’institution universitaire. Certes, Alain ne goûtait guère le nietzchéisme ni Foucault la philosophie réflexive, mais tous deux aspiraient à une philosophie de la libération.
Le livre de Jean-Claude Monod, L’art de ne pas être trop gouverné, pose bien le problème de savoir si, au-delà des enquêtes brillantes de Surveiller et punir et des cours des années 1979-1980 sur le bio-pouvoir, il y avait chez Foucault au moins les prémisses d’une théorie politique. Ses interventions publiques, si nombreuses dans l’après-Mai 68, sur les prisons, les pauvres, les homosexuels, et sa fameuse prise de position en 1979 sur la révolution khomeyniste supposée porter un pouvoir « spirituel » jusqu’au sein de ce qui est très vite apparu comme une tyrannie théologique dont tout l’Iran a fait les frais depuis quarante ans, ne diffèrent malheureusement pas des habituelles poussées de révolte dont les intellectuels français sont coutumiers et quasiment professionnels. On a beaucoup glosé sur l’attirance que Foucault manifesta pour ce qu’on appelle le libéralisme. Comment un penseur qui tenait toute la société contemporaine pour disciplinaire et qui fut tenté souvent par l’anarchisme se trouva-t-il à un moment intéressé par l’ultra-libéralisme d’un Hayek ? Comme il le dit dans sa fameuse conférence « Qu’est-ce que la critique ? » (1978 ; Vrin, 2016), l’idéal serait d’avoir « l’art de ne pas trop être tellement gouverné ».

Jean-Claude Monod retrace les conceptions de Foucault sur les « crises de la gouvernementalité », qui vont des révoltes de la Renaissance et de la crise du pastorat chrétien aux origines du libéralisme économique. L’État libéral moderne, dont une des incarnations fut l’ordo-libéralisme d’Eucken et de Röpke, n’a plus comme objectif de gouverner par la contrainte au nom de sa souveraineté juridique, mais de gouverner plus doucement en lâchant la bride. Monod montre comment Foucault fut à la fois intéressé par ces théories et, quand la crise iranienne vint, par une sorte de renouvellement de la politique par la religion. Le moins que l’on puisse dire, à lire ses analyses, est que Foucault n’avait pas des idées très claires sur ce en quoi pourrait consister l’art de ne pas être trop gouverné. Monod reprend, mais met aussi à distance, les intuitions de Foucault sur les crises de gouvernementalité, et les applique aux révoltes contemporaines, celle des Gilets jaunes notamment. Il propose, dans le dernier chapitre de ce livre au style profus, les pistes diverses qui s’ouvrent à la gauche radicale d’aujourd’hui, et envisage, comme beaucoup, la piste écologique, qui nous propose un bon règlement de « l’usufruit du monde ». Le problème est qu’on ne sait pas encore bien si l’option écologiste, qui est sans doute la seule possible en ces temps d’effondrement, penchera du côté de l’art de ne pas être trop gouverné ou du côté de la douleur de l’être trop.
Le livre de Jean-Claude Monod illustre les dilemmes auxquels sont confrontés ceux qui ne croient plus ni en la démocratie représentative classique, ni en un libéralisme économique tenté par l’autoritarisme. Ils sont nombreux aujourd’hui, et même si tous ne tombent pas dans les dérives post-foucaldiennes de Giorgio Agamben, qui nous a récemment sorti l’idée que la pandémie de la Covid-19 était une simple invention du bio-pouvoir pour nous soumettre à un régime sécuritaire et d’exception. Ce qui surprend, quand on jette un regard rétrospectif sur les travaux du Foucault de la fin des années 1970, c’est son ignorance – sans doute volontaire car il était très au courant de la philosophie politique américaine – des travaux de Rawls, de Nozick sur l’État minimal et des autres philosophes libéraux de l’époque. On a souvent confondu le libéralisme économique et le libéralisme politique, mais il est étrange que les écrits s’inscrivant dans la descendance de Foucault ignorent à la fois cette tradition et celle du républicanisme.
C’est assez naturel en un sens. Foucault ne voyait dans la démocratie libérale qu’un accomplissement du régime juridique de gouvernement. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un auteur qui refusait en philosophie les notions de raison et de vérité ait formulé des propositions politiques hostiles à la démocratie. Mais n’y a-t-il pas d’autre alternative que le marché ou le populisme (ou un mélange des deux, comme c’est le cas de plus en plus souvent) ? Ne peut-on préférer à l’art de ne pas être trop gouverné celui de se gouverner soi-même et de tenter de nous gouverner collectivement ? Il faudra alors prendre de tout autres modèles que ceux de la pensée de Michel Foucault.












