Mars 1968 n’a pas laissé de traces marquantes dans l’Histoire et ce mois a signé pourtant la fin, ou presque, d’une présence très ancienne, celle des Juifs en Pologne. Certes, il reste des Juifs en Pologne et l’antisémitisme trouve avec eux de quoi s’alimenter en permanence, mais la plupart ont quitté ce pays après ce que le grand philosophe Leszek Kołakowski a appelé « l’invasion des punaises ». Dans Affaires personnelles, la journaliste polonaise Agata Tuszyńska, auteure d’Une histoire familiale de la peur, de Wiera Gran, l’accusée et de La fiancée de Bruno Schulz, relate ce départ et ce qui l’a précédé ou provoqué.
Agata Tuszyńska, Affaires personnelles. Trad. du polonais par Isabelle Jannès-Kalinowski. L’Antilope, 384 p., 23,50 €
« Ce récit choral d’émigrés de Mars 1968 retrace différentes expériences de l’exil, la privation du pays de son enfance, la perte de sa patrie. Il raconte également comment lutter pour soi quand on atterrit dans une autre réalité, comment trouver sa place à l’étranger, comment construire un nouveau monde avec lequel il faut – en partie – se familiariser ». Ainsi Agata Tuszyńska présente-t-elle en introduction ce livre riche, parfois foisonnant, au risque quelquefois de la confusion. Si on s’attache, en effet, aux noms des témoins, on risque de moins entendre les voix. Les histoires que chacun des protagonistes raconte sont classées selon des thématiques, comme autant de têtes de chapitres. Mais on oublie assez vite qui dit quoi, on perd le fil d’une histoire singulière. Le mot « choral » est en ce sens précieux. On s’y tiendra.

Le dirigeant polonais Władysław Gomułka et Leonid Brejnev (1967) © Bundesarchiv, Bild 183-F0417-0001-011 / Kohls, Ulrich / CC-BY-SA 3.0
Trois grandes parties dans le récit d’Agata Tuszyńska : avant mars, les jours terribles, après. Avant, les enfants disent qui ils sont, qui sont leurs parents, quels liens ils entretiennent avec la judéité. Les jours terribles sont ceux de mars mais tout commence des années avant, dès 1960, quand, au sein de l’appareil, certains établissent des listes. On sait le pouvoir des listes. Mais un autre événement, qui concerne toute la Pologne de ces années-là sert de repère : l’interdiction, en janvier 1968 des Aïeux, pièce de Mickiewicz dans laquelle les allusions à la Russie, le grand frère d’alors, dérangent le pouvoir. Des manifestations étudiantes s’ensuivent. En mars, parmi les anciens manifestants, on en vise surtout certains. Après, c’est le départ pour la Suède, le Danemark, la France ou Israël. Rares sont ceux qui restent en Pologne.
L’histoire des parents est exemplaire d’un siècle de fer qui a dévoré ses enfants. À la lecture de certains passages, on retrouve ce que Danilo Kiš écrivait dans Un tombeau pour Boris Davidovitch dès les années 1970 : l’impression de voir une génération sacrifiée, une génération d’idéalistes brisée par les tueurs cyniques de la NKVD sur ordre de Moscou. La plupart de ces femmes et de ces hommes, nés à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, ont cru dans le « Parti et la Patrie ». Ils ont espéré un monde plus juste, égalitaire. Ils ont rompu avec le shtetl, avec la religion, souvent avec la langue yiddish (ils l’utiliseraient plus tard pour se dire des secrets devant leurs enfants). Ils se sont engagés dans le Parti communiste polonais, ce KPP laminé comme d’autres partis communistes européens en URSS. Ils ont fait la guerre d’Espagne, « école de la vie » dans la brigade Dombrowski. Certains ont subi l’enfermement du ghetto, à Varsovie, Cracovie ou Lodz. Ils se sont quelquefois échappés, de façon miraculeuse, sont entrés en résistance. Beaucoup ont fui vers l’Est en 1939. Quand ils n’ont pas voyagé jusqu’à la Kolyma, ils ont pu combattre avec l’Armée rouge. À leur retour en Pologne, ces idéalistes, dont la foi dans le communisme était restée intacte, ont occupé des fonctions importantes au sein de l’appareil d’État, qui dans la police, qui dans le domaine culturel ou économique. La Pologne n’était que ruines, ils voulaient la reconstruire.
Cette génération avait des valeurs très fortes. Ces pères et mères étaient les « champions olympiques de la morale » et veillaient à ce que leurs enfants aient un comportement exemplaire. Les livres, le théâtre, faisaient partie de ce qu’ils transmettaient à leurs enfants. Ces enfants issus de familles juives restaient entre eux. Ils habitaient le même quartier résidentiel de Varsovie, allaient dans les mêmes colonies de vacances, vivaient en bande. Les fêtes et autres surprises-parties les rassemblaient ; ils étaient, dit l’un, « isolés des autres ». L’une des voix résume : « La poésie gouvernait nos vies. On débattait. On vivait dans la passion, la curiosité. Nous étions un petit îlot dans la Pologne d’alors. Au milieu de l’océan de bêtise et d’absurdité de la Pologne populaire ».
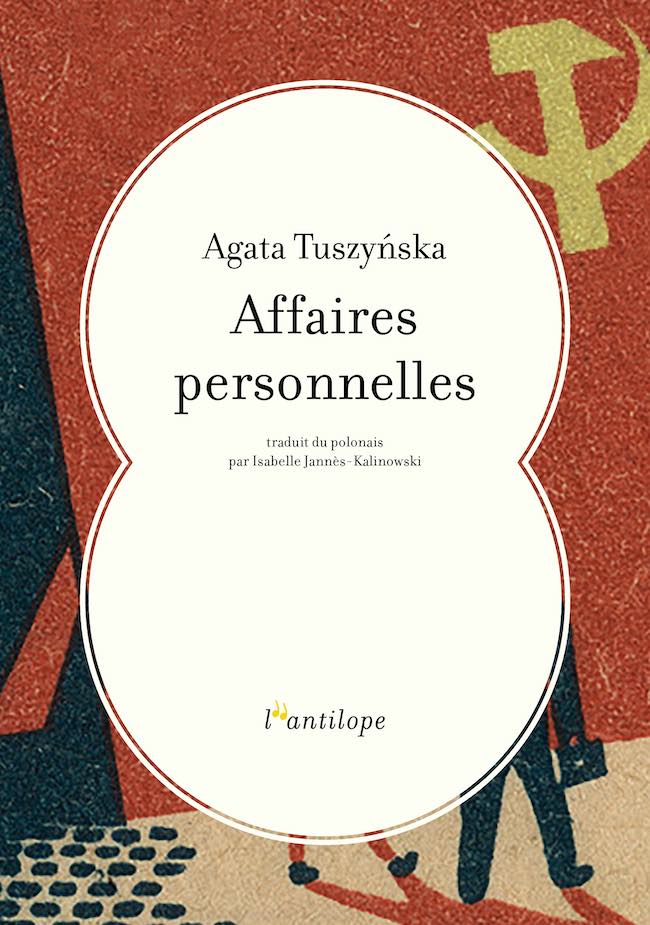
Pour le reste, et comme pour bien des rescapés, des survivants, leurs parents parlaient peu, ou pas. Sur leur judéité, ils étaient silencieux. La Shoah faisait partie de ces « déchets radioactifs dangereux ». Ou comme le dit un autre : « [Mes parents] voulaient que leurs enfants vivent au présent, pas au passé, leur passé ». Mais l’envie et la haine envers ces survivants restaient présentes. Leurs enfants en payaient le prix. Sans doute parce qu’ils vivaient dans de meilleures conditions que beaucoup d’autres, mais pas seulement. Dans bien des récits reviennent les clichés, les préjugés fondés sur l’ignorance. On s’étonne ainsi qu’à l’école, dans un pays communiste, des enfants sortent de classe au moment où un prêtre vient faire le cours de catéchisme. Un exemple parmi d’autres que je croyais propre à la seule avant-guerre, dans la Pologne conservatrice du maréchal Piłsudski. Le reste est plus connu, avec les vexations dans les lieux publics et les transports en commun, ou au sein des institutions.
Alors, quand Gomulka qualifie la génération des parents de « cinquième colonne », quand les pères et mères qui ont consacré leur vie à la cause communiste voient leur monde s’effondrer, le quai de la gare Gdanski devient le dernier lieu commun pour les jeunes. L’expulsion est brutale. Elle fait suite aux arrestations d’étudiants au printemps 1968 (pas du tout le nôtre ! Celui qui trouvera un écho à Prague jusqu’à l’été suivant). Ceux qui s’exilent doivent renoncer à la nationalité polonaise. Ils sont spoliés et partent avec un petit bagage. Mais beaucoup sauront se reconstruire ; ils ont de la ressource et surtout ces valeurs si précieuses. L’un deviendra architecte au Danemark, l’autre « planétologue » à Grenoble, une troisième enseignera Gombrowicz, Hłasko et Konwicki à la Sorbonne. La vie en Israël est paradoxalement plus difficile, parce que la religion n’est pas leur fort – des années plus tard, les Juifs soviétiques connaitront la même difficulté. Mais ils n’éprouvent pas de regrets. Ils retournent en Pologne pour certains, parce que quelques « Juifs indécis » y sont restés, parce que des « Justes » (rappelons que la Pologne est le pays qui en a donné le plus grand nombre, alors que le danger couru était le plus intense) sont encore là, qui proposaient à leurs parents de les cacher de nouveau, quand « l’invasion des punaises » les menaçait. Rysiek Szulkin résume l’époque : « La Pologne d’avant-guerre et celle d’après-guerre, d’un point de vue ethnique, sont deux mondes totalement différents. D’un côté une mosaïque multi-ethnique, d’un autre un bloc de béton mono-culturel. Les défenseurs de ce bloc devraient se rendre compte que cette Pologne mono-culturelle est le fruit des agissements de deux personnes, Hitler et Staline. »
Être juif est toute une aventure. Être juif polonais, c’est l’être au carré, voire au cube. Quiconque a hérité de cette histoire, à la fois trop simple par son horreur et trop complexe pour qu’on l’épuise en quelques lignes, sait ce qu’il en est. Le livre d’Agata Tuszyńska le rappelle avec justesse et souvent avec émotion.












