L’enquête de L.A. bibliothèque retrace l’histoire du grand incendie de Los Angeles qui a embrasé plus d’un demi-million de livres le 29 avril 1986. La journaliste Susan Orlean recrée l’ambiance d’une grande caverne publique, dans un cheminement tout foisonnant de vies et de mémoires pour faire parler les cendres.
Susan Orlean, L.A. bibliothèque. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Sylvie Schneiter. Éditions du Sous-Sol, 345 p., 23 €
Tout commence par une immense ironie dramatique : simultanément se déclenchent la catastrophe de Tchernobyl, ressentie à l’échelle de la planète, et un drame du feu dans la Cité des Anges, un incendie qui va connaître une couverture médiatique très limitée : c’est la survie du monde global, un accident nucléaire, face au crépitement d’un pâté de maisons de 1926, sept étages à l’angle de la 5e Rue et de Flower Street.
Une bibliothèque publique donc, couleur fauve, élevée comme une proclamation, avec ses bas-reliefs aux visages de Virgile, de Léonard de Vinci et de Platon, des volutes, des mosaïques, des inscriptions anglaises et latines, un lustre représentant le globe terrestre, une rotonde qui abrite l’imposante statue en marbre de la Civilisation. Cette bibliothèque centrale s’érige en une geste, brandie comme une torche portée par une main de bronze.
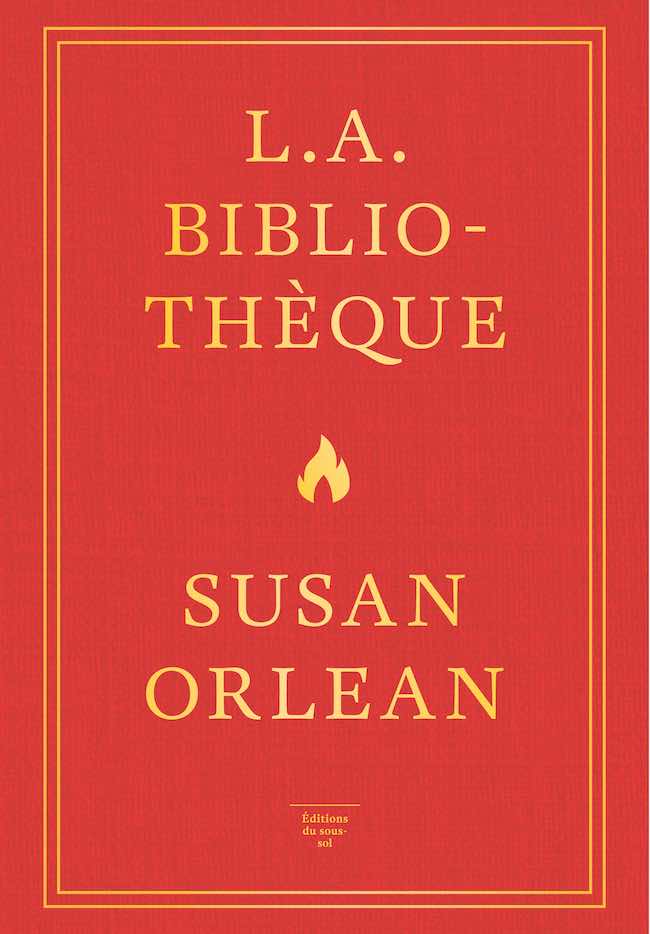
Le 29 avril 1986, la sonnerie d’un détecteur branlant est suivie d’une fumée au magasin de littérature, filant le long d’une étagère allant de Robert Coover à John Fowles. Le feu ravage les livres pendant sept heures, avec des écroulements, des étagères fondues, des torrents d’eau, cinq jours à plus de 500 degrés Fahrenheit, et, jusqu’aux chevilles, des cendres.
Une tragédie pour la ville au regard de tous les trésors disparus, et une raison de plus de fouiller les mémoires. Susan Orlean s’investit et s’acharne dans une traque de plusieurs années, de manière à évoquer le grand incendie et surtout à ressusciter la richesse d’un foyer de l’écrit et la périphérie humaine et culturelle de la bibliothèque. Journaliste au New Yorker, elle possède toutes les ficelles du métier pour susciter des rencontres, mener des entretiens, entendre des confidences ; mais, à titre privé, c’est aussi une assidue des rayonnages de livres depuis l’enfance. D’emblée, elle reprend à son compte la citation de Jorge Luis Borges dans L’or des tigres : « J’ai toujours imaginé le paradis comme une sorte de bibliothèque. »
Mais quel univers ? et quel paradis ? Susan Orlean plonge tous azimuts dans les coulisses et les archives d’un appareil composite, très divers, en prise avec la société californienne et avec l’air du temps dans cette ville sèche, crépitante, caniculaire. L’intérêt de ce travail documentaire tient à la diversité des sources, des observations et des témoignages, qui construit par juxtaposition la mosaïque d’un monde en ruche, largement méconnu du public venu a priori pour emprunter des livres. Elle est un lieu d’émerveillement pour le voisin Charles Bukowski, connaisseur de la porosité des lignes. À l’ouverture, en 1873, la première bibliothèque publique de Los Angeles, dont l’abonnement coûte 5 dollars par an, consiste en un espace de lecture exigu ; les hommes déposent leur chapeau à l’entrée, les femmes ont seulement une pièce réservée avec des magazines ; mais en aucun cas il ne s’agit de devenir des « obsédés de la fiction », de lire des livres vulgaires, sentimentaux ou douteux. Réservée aux plus riches et aux érudits jusqu’à la fin du XIXe siècle, la bibliothèque de L.A. s’est ouverte ; c’est l’ampleur de cette transformation opérée en cent ans qui est au cœur du livre.

La bibliothèque centrale de Los Angeles (1971) © Library of Congress
La pose de la première pierre de la nouvelle bibliothèque est prétexte à la fête en 1925, un an après l’ouverture de la tombe de Toutankhamon et la création de la Rhapsody in Blue de Gershwin qui électrisent le monde de l’art. Pour marquer l’événement, Los Angeles monte un très grand spectacle avec un millier d’enfants costumés, la brochure vante un cadre idyllique où « l’esprit du visiteur s’accorde au message du poète, du prophète, du philosophe de l’artiste, du savant… Une légende devenue réalité, car c’est le refuge de nos meilleurs et plus vieux amis – les Livres ». La suite sera à l’avenant : Goodhue et les grands architectes sont à l’ouvrage – il s’agit pour eux de faire méditer sur le pouvoir de l’esprit humain et la puissance de la narration –, un peintre de l’atelier du maître John Singer Sargent entreprend un travail de six ans sur les fresques, tout doit frapper les imaginations et faire de la bâtisse un château de conte de fées. La circulation des livres s’accentue après le krach de 1929, la plaque tournante ne désemplit pas, guérit de ses péripéties – dont le tremblement de terre de 1971, qui fait tomber 100 000 volumes des étagères –, elle accueille toujours plus et toujours autrement, jusqu’au grand incendie.
Inscrite dans l’histoire de la destruction des bibliothèques (à ce sujet, on peut lire Livres en feu de Lucien X. Polastron, Denoël, 2004), depuis le premier autodafé signalé (Chine, 213, l’empereur décide de faire disparaître tous les livres d’histoire) jusqu’au bombardement de Sarajevo en 1992, la plus grande partie des pertes de Los Angeles touche au domaine de l’histoire des États-Unis. Mais ont aussi disparu des incunables, un in-folio de Shakespeare, des collections de cartes et de menus, des annuaires, des journaux, des atlas, des photos, des brevets, des manuels, des dessins, des partitions, tous ces témoins en bribes de la vie sociale et artistique d’une société.
La trame policière à l’arrière-plan tourne autour d’un jeune pyromane, blanc, célibataire, à découvrir et à confondre : un certain Harry Peaks, acteur à ses heures, coursier, mannequin, chauffeur, dilettante et fanfaron, qui rêve d’être célèbre. Passage au détecteur de mensonges, alibis et récits changeants, case prison à Hollywood pour interrogatoires, fortes présomptions, jalonnent une enquête difficile ; la ville le poursuit en justice mais l’incendie a englouti les preuves. Réouverture le 3 octobre 1993, 50 000 personnes retrouvent le chemin du Goodhue Building, dansent avec Barney le Dinosaure puis traversent la rotonde.

La journaliste américaine Susan Orlean © Gaspar Tringale
Auparavant, avec Le voleur d’orchidées (2018), Susan Orlean est passée d’un bouton d’orchidée de Floride aux guerres des Séminoles, cherchant réponse à ses questions. Ici comme ailleurs, son intérêt est caméléon, multiple pour faire avant tout la part belle à l’évolution de la grande bibliothèque : derrière les volumes alignés, des gens et des idées, des combats féministes et des projets, des captations de populations dont pêle-mêle les enfants, les nouveaux immigrants, les sans-abris, les indigents, les grouillots des studios d’Hollywood en mal de documentation, les visiteurs de tout poil dans la file d’attente. Susan Orlean fait revivre les conservateurs opiniâtres, les vestales du livre, les documentalistes joyeux, les bibliothécaires passionnés, les idéalistes, les hippies et autres noctambules. Elle visite entrepôts et bureaux, fréquente pompiers et secrétaires, elle fait les comptes : 700 000 livres détrempés, 2 ans de congélation des livres endommagés, 20 % récupérés, séchés puis reliés. Elle s’enquiert du développement de la fondation Bill et Melinda Gates pour la culture, suit les appels de levée de fonds du maire, Tom Bradley, lors de sa campagne « Save the Books ». Alphabétisation, services sociaux, prêts en ligne, bénévolats et mécénats, références par téléphone, lectures estivales, toutes les expériences nouvelles s’ajoutent et les salles de lecture sont bondées, 700 000 personnes franchissent chaque année le seuil de la bibliothèque : à chacun sa recherche et sa pulsion, car tout le corps social s’y abreuve. On s’y cherche, on s’y perd, on s’y retrouve, on se donne rendez-vous dans ce carrefour du monde. Le fourmillement humain donne la trame, le dynamisme l’intrigue de cette enquête hors normes.
Cet inventaire est aussi un clin d’œil à Ray Bradbury qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les bibliothèques européennes détruites fument encore, termine l’écriture du roman Le pompier et téléphone au chef du service de la sécurité incendie de Los Angeles pour lui demander le point d’inflammation du papier. La réponse, toute technique, Fahrenheit 451, donne aussitôt le titre définitif de ce chef-d’œuvre de science-fiction, devenu un classique et une vigie à travers cette phrase : « Et quand ils demanderont ce que nous faisons, vous pourrez répondre : nous nous souvenons. ». Ironie toujours, tous les ouvrages de Ray Bradbury alors en rayon à la bibliothèque périront dans l’incendie.
L.A. bibliothèque tient sa place comme un livre-gigogne, en forme de collection d’aperçus, de données rassemblées où chacun puisera au fil des rayonnages et des curiosités. Une démesure à l’américaine, « une histoire essentielle », un hommage à ceux qui ont le courage dément d’écrire et à ceux qui veulent lire, tous unis par un partage et un acte de foi. « On se sent moins seul dans une bibliothèque, confie Susan Orlean, on participe à une conversation qui se tient depuis des siècles. C’est une effusion de murmures. » Au-delà des chuchotements, c’est une nécessité qui toujours nous ramène au savoir, à la puissance de la narration et aux forteresses de la mémoire.












