À travers le portrait de huit intellectuels de renom représentatifs de la gauche du XXe siècle, Susie Linfield a entrepris d’exposer les contradictions qui traversent leurs prises de position sur le sionisme, ainsi que leur ambivalence vis-à-vis de l’État d’Israël. The Lions’Den (« La cage aux lions »), paru aux États-Unis, est un ouvrage non dépourvu de parti pris, mais dont la lecture critique peut être l’occasion de repenser le sionisme comme une idéologie du siècle dernier.
Susie Linfield, The Lions’ Den. Zionism and the Left from Hannah Arendt to Noam Chomsky. Yale University Press, 400 p., $ 32,50
Comment expliquer le changement d’attitude de la gauche à l’égard d’Israël, après qu’elle se fut prononcée en faveur de sa création en 1948 ? Pourquoi se dire sioniste provoque-t-il désormais un malaise parmi les intellectuels américains ? La réponse qui vient à l’esprit de tous et de Susie Linfield elle-même est, bien sûr, l’occupation des territoires palestiniens. Mais la gauche n’aurait-elle pas changé, passant de l’antifascisme fondateur des années 1930 à l’anticolonialisme et au tiers-mondialisme des années 1960 et, plus tard, au soutien à la cause palestinienne, laquelle aurait pris la place qu’avait occupée le Vietnam ?
Ce changement d’attitude de la gauche (entendue au sens large) aurait été, selon Linfield, antérieur à l’occupation des territoires à l’issue de la guerre des Six Jours en 1967 et n’aurait fait que s’accentuer depuis. L’évolution de la politique israélienne, à propos de laquelle elle dit partager la réprobation de la gauche, ne serait pas, soutient-elle, la seule raison : « À mes yeux, Israël fonctionne encore comme le prisme à travers lequel le changement des valeurs de la gauche peut être le plus clairement vu. Israël est le test Rorschach de la gauche. » Tel sera le fil conducteur de l’examen du rapport au sionisme des huit figures étudiées : Hannah Arendt (1906-1975), Arthur Koestler (1905-1983), Maxime Rodinson (1915-2004), Isaac Deutscher (1907-1967), Albert Memmi (1920-2020), Fred Halliday (1946-2010), Izzy Stone (1907-1989) et Noam Chomsky (né en 1928).
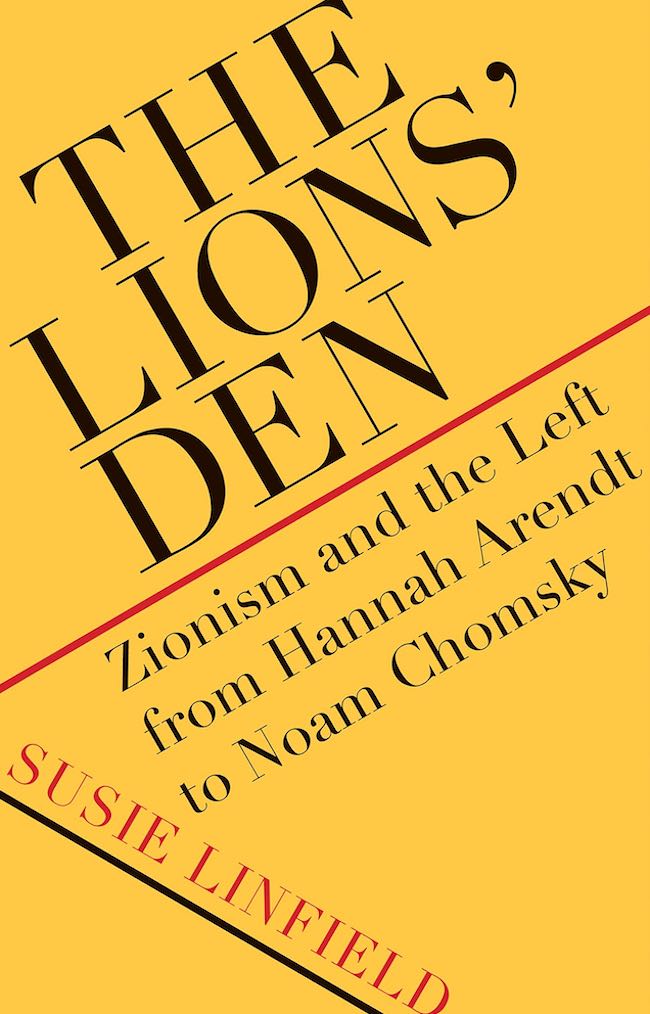
Dans ce portrait de groupe, « l’intrus » est Fred Halliday, le seul non-Juif. On ne comprend pas très bien sa présence dans la mesure où il est clair que Linfield entend faire le lien entre l’ambivalence supposée de ces intellectuels vis-à-vis d’Israël et leur identité juive, revendiquée ou non. Mais au moins The Lions’ Den fera-t-il découvrir cet universitaire irlandais dont la connaissance du Moyen-Orient pourrait être comparée à celle d’un Henry Laurens en France. De même, le choix de Maxime Rodinson et surtout d’Albert Memmi, tous deux intellectuels français, présentera l’avantage de les faire connaître au public anglophone. De ce groupe, seul Noam Chomsky est encore vivant, Albert Memmi venant de mourir. Memmi est d’ailleurs de loin celui qui trouve le plus grâce aux yeux de Linfield. Il faut dire que cet intellectuel juif tunisien s’est toujours déclaré sioniste – sioniste critique sans aucun doute, mais sioniste – et que quiconque a lu Portrait du colonisé, publié en 1958 et préfacé par Jean-Paul Sartre, et plus encore son roman autobiographique La statue de sel, publié en 1953, ne peut qu’éprouver de la sympathie pour leur auteur.
Contrairement à Rodinson (et naturellement à Hallyday), tous ces intellectuels ont été un jour, ne serait-ce que brièvement, sionistes. S’étant éloignés de ce que j’appellerais le sionisme « réel » – comme on a pu parler du socialisme « réel » pour marquer la distance entre le projet et sa pratique –, ils se seraient tous, au fil du temps et des événements, mus en sionistes de plus en plus critiques, voire en antisionistes militants. Pour Linfield, cette évolution dans la trajectoire de chacun d’eux demeure entachée de contradictions. À vrai dire, la tâche consistant à relever des contradictions était affaire d’interprétation : étalé sur plusieurs décennies, scandé par des dates aussi décisives que la création d’un État (1948), la guerre des Six Jours (1967) et celle de Kippour (1973), le massacre de Sabra et Chatila (1982) et plus tard encore les accords d’Oslo (1993), sans oublier l’assassinat du Premier ministre d’Israël Yitzhak Rabin (1995), leur rapport au sionisme et/ou à Israël (une distinction qui n’est jamais établie) ne pouvait que fluctuer. Mais se sont-ils autant contredits que Lindfield l’affirme ?
Commençons par Hannah Arendt. On a beaucoup écrit sur elle et, surtout, sur Eichmann à Jérusalem, ce reportage qu’elle effectua pour The New Yorker lors du procès de 1961 et qui donna lieu ultérieurement à son essai sur la « banalité du mal ». Linfield s’y attarde à son tour, pour conclure qu’à l’issue de la polémique qu’elle avait provoquée (notamment avec Gershom Scholem, juif allemand et son ami de longue date, installé depuis 1923 en Palestine) Arendt allait devenir « anti-antisioniste », de la même façon qu’elle était « anti-anticommuniste ». Linfield y voit une contradiction avec ses positions avant la création d’Israël, lorsque Arendt tenait un État juif pour impossible et injuste. Mais ne devrait-on pas comprendre qu’elle modifia son jugement dès lors que l’État était devenu une réalité ? De ce point de vue, son « anti-antisionisme » est tout aussi cohérent. Un jugement lapidaire clôture la partie qui lui est consacrée : la relation d’Arendt au sionisme serait une « saga tortueuse [qui] ne fut d’aucune utilité pour aider à résoudre le conflit israélo-palestinien ». Hannah Arendt aurait-elle eu pareille prétention ?

Arthur Koestler (cinquième à partir de la droite) au kibboutz d’Ein Hashofet (1945)
Sur Koestler, dont toute personne l’ayant approché a pu dire beaucoup de mal, on en apprendra davantage encore dans ce livre. Son portrait s’intitule « Le sioniste comme antisémite ». Mais qu’on ne s’y trompe pas. Linfield a su éviter deux lieux communs : le premier qui consiste à déceler dans tout Juif antisioniste une « haine de soi », le second qui consiste à déceler en tout antisioniste de l’antisémitisme. Concernant Koestler, il est vrai qu’elle frôle les deux accusations, mais les propos à l’emporte-pièce de ce dernier peuvent lui donner raison. Il reste que son portrait est tellement dépourvu d’aménité qu’on a du mal à démêler, non pas le vrai du faux, mais l’écheveau des prises de position de Koestler mises bout à bout souvent hors contexte. Il n’aimait ni les Juifs de la diaspora, ni les Sabras, ces Juifs nés en Palestine/Israël, ni le yiddish ni l’hébreu, ni les sionistes ni leurs adversaires. Il fut tour à tour communiste, sioniste, internationaliste, anticommuniste et, pour finir, décida d’en finir avec le peuple juif et le sionisme en écrivant La treizième tribu qui faisait des Juifs (d’Europe de l’Est) des descendants des Khazars. Exit l’option sioniste.
Chez Maxime Rodinson, qui se voulait « le plus célèbre antisioniste français », Linfield peine davantage à trouver des contradictions. Marxiste indépendant, ce spécialiste du monde arabe fut de tout temps résolument antisioniste. Après la création d’Israël, il se prononça en faveur de la création de deux États, ce qui correspond là encore à une adaptation à la réalité davantage qu’à une contradiction. Linfield va jusqu’à lui reprocher d’avoir songé, lui, l’antisioniste, à rejoindre la Palestine lorsque, en poste à l’Institut français de Damas pendant la guerre, il avait évoqué la possibilité de se réfugier à Jérusalem. Aurait-elle voulu que, par fidélité à ses convictions, il s’exposât au danger d’être fiché comme Juif en Syrie alors sous mandat de la France de Vichy ? Mais encore, où voit-elle une contradiction dans le fait qu’un Juif dont les parents ont été déportés à Auschwitz, comme c’était le cas de Rodinson, puisse maintenir sa croyance dans l’assimilation ?
Si Isaac Deutscher bénéficie d’un jugement plus indulgent, c’est d’ailleurs parce que Linfield lui attribue une sensibilité à la tragédie du peuple juif qu’elle dit absente chez Rodinson. Qu’est-ce qui l’autorise à l’affirmer ? Rodinson n’avait-il pas rejoint Léon Poliakov et Pierre Vidal-Naquet pour démonter la rhétorique négationniste ? Elle pense également Deutscher plus internationaliste que Rodinson mais, paradoxalement, moins antisioniste. Deutscher est le seul parmi ces intellectuels à être crédité d’une moindre ambivalence dans ses prises de position. Quoique ayant éprouvé, rappelle-t-elle, une « aversion idéologique » à l’égard d’Israël, il en aurait admiré l’expérience du kibboutz. À ce sujet, elle oublie de rappeler que sa mort, intervenue peu après la guerre des Six Jours, l’avait empêché d’assister au déclin du sionisme de gauche dont le kibboutz était l’héritier. Le principal regret formulé à l’encontre de Deutscher concerne son célèbre Essai sur le problème juif dans lequel il élabora la figure du « Juif non juif » : un Juif qui « a dépassé les frontières étroites du judaïsme », pour reprendre les termes de Deutscher lui-même. Linfield fait à ce propos une curieuse comparaison : « Les partisans de ce livre seraient-ils autant enthousiasmés par un ‟Noir non noir”, ou un ‟Arabe non arabe” ? Tandis qu’un ‟Juif non juif” est célébré comme un internationaliste, un ‟Noir non noir” serait considéré comme un Oncle Tom et un ‟Arabe non arabe” comme un islamophobe animé de la haine de soi. » À méditer…

Noam Chomsky © CC/Andrew Rusk
Si l’intellectuel new-yorkais Izzy Stone, qui se disait un Juif pieusement athée, bénéficie également d’un traitement moins sévère qu’Arendt, Koestler et Rodinson – pour ne rien dire de Chomsky –, c’est probablement parce que cet internationaliste aimait le yiddish et la culture juive que Koestler disait quant à lui tant détester. Indifférent au sionisme avant-guerre, puis sioniste « par nécessité », Stone avait approuvé le célèbre numéro des Temps modernes, confectionné avant mais paru juste après la guerre des Six Jours, dans lequel Maxime Rodinson posait la question : « Israël, fait colonial ? ». Linfield revient souvent sur ce numéro et en fait, à juste titre, un moment charnière de l’évolution du rapport à Israël de la gauche française. On sait que Sartre et Claude Lanzmann s’en distancièrent plus tard, tandis qu’il allait devenir le point d’ancrage de l’opposition à la politique d’Israël.
De son côté, prolixe et péremptoire, Noam Chomsky courait plus que d’autres le risque de se contredire. Qu’il ait contribué à l’avancée de la linguistique n’en faisait pas un spécialiste du conflit du Moyen-Orient, mais lui reprocher son engagement, c’est assigner sa place au savant : dans sa tour d’ivoire. (On se souvient de ce qu’il en coûta à Pierre Bourdieu d’avoir apporté son soutien aux grévistes et manifestants contre le plan Juppé des retraites en 1995.) Chomsky avait d’ailleurs écrit très tôt à ce sujet, dans son essai paru en 1967, The Responsability of Intellectuals. C’était au moment de la guerre du Vietnam. Un texte courageux à l’époque, concède Linfield. À ses yeux, sans doute aurait-il dû s’arrêter là. Or, Chomsky n’a cessé depuis de parler et d’écrire et de s’avancer sur des sujets qu’il ne maitrise pas forcément et, comme de bien entendu, sur le conflit israélo-palestinien avec les positions antisionistes radicales qu’on lui connait. Pour Linfield, son compte était bon.
Il aurait été utile de dissocier le rapport au sionisme du rapport à Israël en apportant une pièce supplémentaire à ce dossier qui prend trop souvent des allures de réquisitoire. En octobre 2003, dans la New York Review of Books, l’historien anglo-américain Tony Judt (sans doute un « Juif non juif ») qualifiait Israël d’État-nation « anachronique » car issu d’un concept de l’État datant du XIXe siècle. Ce disant, il posait la question qu’à aucun moment Linfield ne se pose : que signifie le sionisme et être sioniste aujourd’hui ? Ce qui fait qu’on reste sur l’impression d’un ouvrage orienté qui assène davantage qu’il ne démontre. Selon le philosophe américain Michaël Walzer, mis à contribution pour la quatrième de couverture, dans ce livre sur huit intellectuels, Susie Linfield serait la neuvième voix. C’est bien là le problème : on aurait aimé moins l’entendre et se faire une idée soi-même grâce à la fantastique documentation qu’on lui reconnaîtra le mérite d’avoir rassemblée.












