Ce nouvel ouvrage de Mireille Gansel rassemble, comme les précédents parus aux éditions de La Coopérative, de courts textes écrits au fil des souvenirs et des voyages de l’auteure, traductrice de Paul Celan, de Nelly Sachs et du poète vietnamien To Huu. Il franchit un pas de plus dans la proximité entre les êtres, liés les uns aux autres comme le sont entre elles les eaux de la terre.
Mireille Gansel, La voix du fleuve. La Coopérative, 126 p., 15 €
Mireille Gansel s’efforce toujours de trouver ce qui relie les êtres, ces « riens » qui nous lient, mots ou objets, tout ce qui procure lumière et refuge. Ici il est question des origines, c’est-à-dire de la terre et de l’eau, de la glaise façonnée par le potier comme par le petit enfant. Les mots coulent avec simplicité et fraîcheur comme les fontaines des cours d’autrefois, jusqu’aux humbles « terres de bourbe » si fécondes, ces marécages souvent détruits par l’expansion humaine, dans la Dombes en France comme à Calcutta en Inde, ville de l’artiste Jayashree Chakravarty qui mêle eau, terre et végétaux pour créer de grandes canopées de papier. Les terres arides ne sont pas en reste, qui connaissent la soif des eaux rares, « cette Provence où chaque surgissement d’eau est comme une naissance : ‟neissoun” ».
Il est doublement question de la Hongrie, pays familial et familier pour Mireille Gansel et contrée riche en sources thermales. Mais la fréquentation des livres et des langues, et surtout cette propension à trouver du lien fort, permet à cette auteure singulière de se sentir partout en terrain connu : visitant Tolède pour la première fois, « ce fut comme être de retour ». Tolède n’est pas seulement le lieu de la captivité de Jean de la Croix à qui l’expérience du cachot inspire le Cantique spirituel, pas seulement le lieu où le Greco, éternel exilé, peint son Expolio, c’est aussi une ville pétrie de traditions juives et musulmanes. Mireille Gansel laisse percevoir toutes ces résonances et y ajoute des échos liés à son propre parcours : des vers de Nelly Sachs qu’elle a traduits, des vers qu’elle a écrits à Hanoï.

Le fleuve Whanganui, en Nouvelle-Zélande (2007) © CC/Duane Wilkins
Peu importe la distance géographique ; en apprenant que le fleuve Whanganui a obtenu le statut de personne juridique, elle décide de se rendre sur place, en Nouvelle-Zélande. Au fil des rencontres, elle s’imprègne de la culture maorie, sa langue, sa musique, ses objets et ses rites. Elle retrouve l’eau et de la terre liées à la vie et à la naissance (en maori, « le mot Terre est le même que celui qui dit placenta whenua ») et prend la mesure de ce que les textes officiels ne peuvent restituer. Il y a bien des textes qui tentent de changer la perception du monde, comme l’Appel de l’Alliance des Peuples indigènes : « Il est vital de transformer notre approche de la nature en l’envisageant non comme une propriété mais comme un sujet de droit, garante de la vie ». Autrement dit, à l’avoir préférer l’être. Le fleuve Whanganui est Te Awa Tupuna, « l’eau-ancêtre-l’eau qui a un pouvoir sacré » ; selon l’Acte de Règlement du gouvernement néo-zélandais, « “Te Awa Tupuna will have its own legal personality with all corresponding rights”… » mais « les mots anglais “rights” dans notre langue maorie, cela veut dire ‟les valeurs” inhérentes à la vie, ce qui la préserve, la garde, la sauve ; right is not something we “have”, right is something what “is” : c’est un taonga : ‟un trésor”… »
La volonté de réparation palpable dans la reconnaissance du statut particulier du fleuve Whanganui ne saurait faire oublier la violence faite aux Maoris pendant plus d’un siècle. Personnes déplacées, langue confisquée, fleuve étranglé par un barrage ; aujourd’hui encore, le miel de manuka, trésor médicinal de la Nouvelle-Zélande, est réservé à l’exportation. Et que penser de ce texte de loi rédigé en anglais mais pas en maori (les deux langues étant pourtant langues officielles) ? Mireille Gansel consulte un texte réservé aux tribus vivant au bord du fleuve « pour leur expliquer, leur commenter cet Acte » et perçoit, en dialoguant avec un habitant maori, la difficulté de transposer des mots « comme calqués d’un autre monde mental ». Il y a une difficulté intrinsèque de transposition d’une langue à une autre inséparable de la difficulté de transposition d’un système de pensée à un autre, avec tous les enjeux éthiques et législatifs sous-jacents. Comme l’a montré Tiphaine Samoyault dans son récent ouvrage sur le sujet (Traduction et violence, Seuil), ce rapport a quelque chose de violent.
Sans dériver trop loin, on peut penser à l’auteur et illustrateur australien Shaun Tan, dont l’œuvre la plus célèbre raconte en bande dessinée sans paroles l’histoire d’un migrant (The Arrival, titre traduit en français par Là où vont nos pères, Dargaud, 2007). Dans l’une de ses nouvelles, dans Tales from the Inner City (Arthur A. Levine Books, 2018), la tension entre les lois humaines et les lois de la nature est poussée à l’extrême : les ours font un procès à l’humanité, engagent des avocats humains et font traduire les documents exigés, qui remplissent des conteneurs entiers. Cela finit mal pour les ours, pour leurs avocats aussi, mais les dernières lignes du récit laissent entendre que cette victoire du camp Homo Sapiens, si tant est qu’elle puisse être considérée comme telle, est au mieux un sursis.
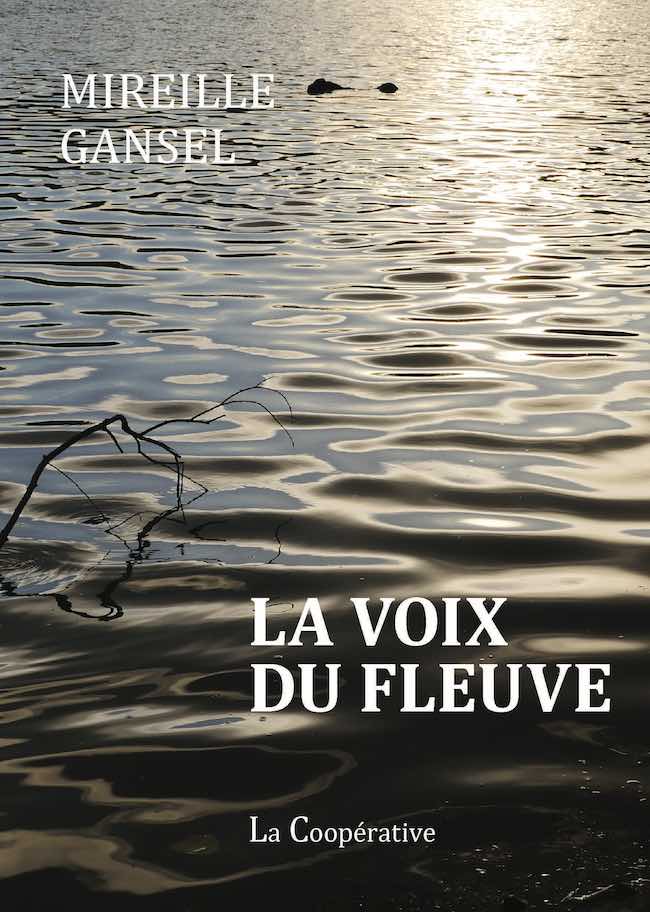
Un épisode de l’histoire néo-zélandaise, évoqué par Mireille Gansel dans le texte intitulé « Le silence du Fleuve », illustre cette idée de mainmise illusoire : des parcelles de la région du Whanganui, terres maories donc, furent offertes à des soldats revenus de la Grande Guerre pour être cultivées dans un esprit pionnier. Un pont en béton fut construit, non sans peine, à l’aube des années 1930, mais, à la suite d’une crue quelques années plus tard, le gouvernement renonça à aménager la vallée et la forêt a repris ses droits. Le pont qui ne mène nulle part (« bridge to nowhere ») est décrit comme une apparition irréelle, vestige glaçant d’un projet mené au mépris du terrain – à tous les sens du terme.
C’est pourquoi, loin des oppositions binaires (gagnant/perdant, humain/non humain), il importe de prêter l’oreille à cette « voix du fleuve », d’écouter les riverains et le Whanganui lui-même, comme évoqué dans les dernières pages aux côtés de Sebastian Lowe qui pose son micro à l’embouchure pour entendre la rencontre des eaux fluviales avec celles du Pacifique. Programme exigeant : faire résonner entre elles les cultures en évitant l’hégémonie de l’une ou de l’autre, faire cohabiter nature et culture avec une approche « dégagée du poids des religions ou des idéologies qui présupposent l’humain au centre du monde », dit Valérie Cabanes (Un nouveau droit pour la Terre, Seuil, 2016). En bonne traductrice, Mireille Gansel excelle dans la capacité à percevoir ce qui unit : « sous les fibres en muka des berges du Whanganui, sous la fine baguette de bambou du monocorde des rizières du Vietnam, sous l’archet en rudes crins des tziganes sans pays, ces mêmes vibratos, cette même voix aux accents si humains ». Mais elle s’efforce aussi de préserver les différences, puisant toujours aux différentes langues-sources, et surtout de réajuster son rapport au monde, à travers l’éclairage qu’apporte, sur le large éventail de l’artisanat et de l’art notamment, chaque création humaine.
Il faut apprendre (ou réapprendre) à penser et agir en écosystème, retrouver l’oikos (la « maison », en grec) dans tous ces mots commençant par « éco » brandis presque sans réfléchir, la maison déjà évoquée dans Maison d’âme (La Coopérative, 2018). L’eau est essentielle à la vie ; ressource à la fois locale et globale, c’est aussi l’élément le plus propice à l’idée de mesure et de justesse (il n’en faut ni trop, ni trop peu), voire de justice (droit à l’eau). On ne pouvait rêver meilleure messagère pour un appel poétique à la sagesse.





![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)






