Dans tous nos bons vieux manuels d’histoire, la « nuit du 4 août 1789 », après la prise de la Bastille, symbolise la fin de l’Ancien Régime, avec « l’abolition de la féodalité ». On croyait tout savoir sur cet épisode fondateur, mais l’historien états-unien Rafe Blaufarb, en rouvrant le dossier, l’éclaire d’un jour nouveau. L’Assemblée nationale constituante, cette nuit-là, a posé les fondements de notre conception contemporaine de la propriété : individuelle et privée, forcément privée. Une conception qui explique notre grande difficulté aujourd’hui à penser la notion de biens communs.
Rafe Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Christophe Jaquet. Champ Vallon, 336 p., 27 €
Dans l’univers libéral contemporain, la propriété privée paraît aller de soi. Elle revêt même une sorte de caractère sacré, depuis qu’elle a été gravée dans le marbre par le Code civil de 1804, qui la définit comme un « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544). Rien de naturel pourtant là-dedans : cette « absolutisation » de la propriété libre et indépendante, ce régime de propriété unifiée et unidimensionnelle (une chose est à moi ou à un autre, de façon totale, sans interférences ni recouvrements), découle des décisions prises dans la tourmente de l’été 1789, par une Assemblée nationale confrontée à une agitation paysanne sans précédent.

Pour mettre fin à la Grande Peur et aux attaques contre les châteaux, après la prise de la Bastille, les députés décident dans l’urgence d’abolir le « système féodal », et toutes les redevances que les paysans devaient verser à leur seigneur. Manière de faire la part du feu pour ramener le calme. Dans un même élan de ferveur « nationale », on décrète l’abolition de tous les privilèges, on proclame l’égalité de tous les citoyens. Une longue tradition a analysé ce grand moment historique comme l’acte fondateur de la société bourgeoise, entérinant la « transition du féodalisme au capitalisme ». Quel qu’ait pu être le caractère improvisé des décisions prises dans la nuit du 4 août, elles se seraient en somme inscrites dans la chronique d’une mort annoncée.
Mais alors, peut-on se demander, pourquoi tant de tergiversations, ensuite, sur les conditions pratiques de cette abolition ? Pourquoi avoir exigé des paysans le rachat des droits seigneuriaux officiellement abolis ? Pour Rafe Blaufarb, on peut lire autrement la nuit du 4 août. Si la notion de propriété est alors redéfinie, ce n’est pas tant pour calmer les revendications paysannes, de nature économique et sociale, que pour clarifier la définition de la puissance publique souveraine, en termes politiques et constitutionnels, en détachant précisément la souveraineté de la propriété. La nuit du 4 août serait alors l’acte fondateur de la modernité politique. Rafe Blaufarb propose ainsi de replacer l’abolition du « système féodal » dans la perspective plus large d’une refondation de l’ordre socio-politique par la séparation radicale entre ce qui relève de la propriété privée et ce qui ressortit à l’exercice de la souveraineté politique. Pour le comprendre, il faut revenir sur ce qu’était l’Ancien Régime.
Avant 1789, propriété et souveraineté ne sont pas nettement séparées. Tout d’abord parce que l’autorité politique publique peut faire l’objet d’une appropriation privée : depuis le XVIe siècle, pour des raisons financières et de clientélisme politique, la monarchie vend en effet des offices, c’est-à-dire des fonctions administratives ou judiciaires, comme autant de biens patrimoniaux. Des milliers de personnes possèdent ainsi un pouvoir public à titre privé : les offices sont vénaux, ils s’achètent, se transmettent par l’héritage ou se revendent, comme de vulgaires biens immobiliers. Certains même procurent l’anoblissement à leur heureux propriétaire.
D’autre part, les seigneurs exercent sur leurs terres, au nom de leur propriété dite « éminente », un double pouvoir de commandement et de prélèvement : ils rendent la justice et collectent des redevances sur les paysans qui « tiennent » d’eux, c’est-à-dire qui possèdent une tenure dans le périmètre de leur seigneurie. Dans les quelque 70 000 seigneuries que compte le royaume de France en 1789, vivent ainsi des millions de paysans ayant le statut de tenanciers : ils sont possesseurs-occupants et recueillent les fruits de leur terre, qu’ils peuvent transmettre ou vendre, mais se trouvent dans un rapport de dépendance envers le seigneur à qui ils versent diverses taxes en signe de reconnaissance de son autorité. La « propriété utile » des paysans se trouve donc subordonnée à la « propriété éminente », c’est-à-dire à la juridiction du seigneur. La notion de « complexe féodal », qui renvoie à cette situation de dépendance juridique et de soumission économique, découle de l’assimilation du système seigneurial à la féodalité médiévale qui voyait les vassaux prêter allégeance au suzerain qui leur concédait des terres. C’est au nom de cette fiction historique, selon laquelle les tenanciers auraient reçu leur tenure en concession perpétuelle de la part du seigneur, que celui-ci exerce son emprise, en une sorte de racket mafieux : « protection » judiciaire et militaire contre redevances imposées, en somme.
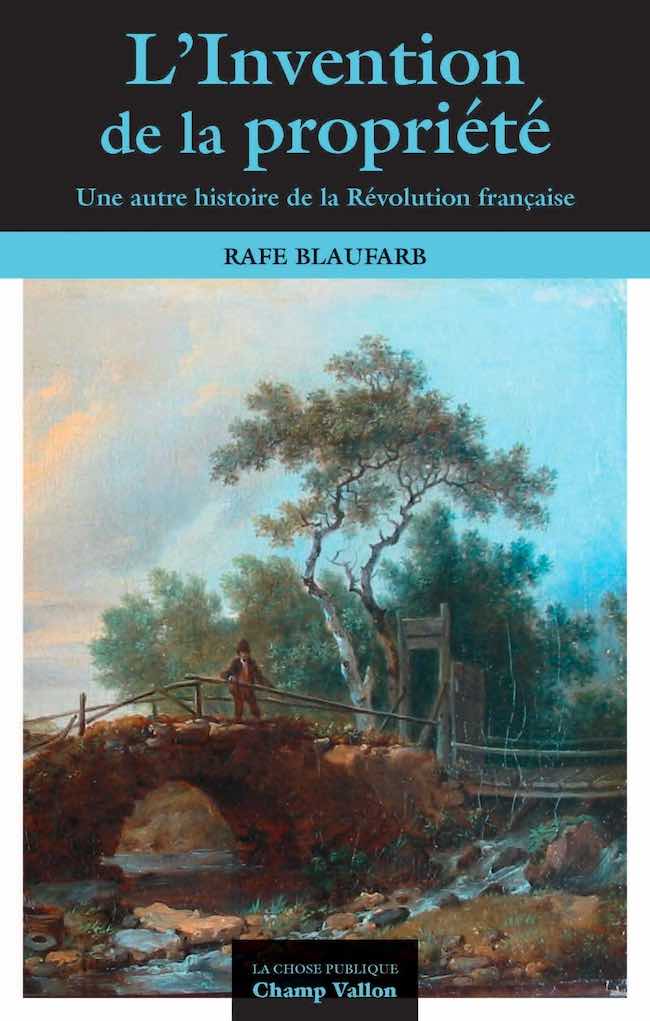
Certains contemporains avaient clairement perçu cet état de confusion entre le public et le privé : selon le jurisconsulte Charles Loyseau, « la seigneurie, c’est de la puissance publique attachée à une terre, et tombée avec elle dans le domaine privé. C’est de la puissance en propriété » (Traité des seigneuries, 1603). La société d’Ancien Régime se caractérise donc par une fragmentation de la souveraineté, éparpillée entre de multiples détenteurs d’une parcelle d’autorité politique, administrative ou judiciaire, tandis que la propriété foncière et immobilière se trouve elle aussi fragmentée du fait de la superposition de différents degrés de droits, allant de la possession usufruitière à la détention de droits assis sur les bienfonds. Cette imbrication du pouvoir et de la propriété fait depuis longtemps débat parmi les légistes soucieux de consolider la souveraineté monarchique, en combattant l’atomisation de l’autorité politique.
Les députés de 1789 héritent en somme d’une longue tradition de critique du « système féodal », jusque-là contingentée à l’exégèse historique : on relisait l’histoire de la conquête franque, on questionnait le processus de constitution des fiefs et les « usurpations » seigneuriales. De Jean Bodin et Charles Loyseau jusqu’à Montesquieu et aux physiocrates, le débat sur le fief, la seigneurie et la souveraineté n’avait pas cessé. En rappelant cela, Rafe Blaufarb peut démontrer que le véritable enjeu de « l’abolition de la féodalité », en août 1789, n’est pas tant de garantir les droits de propriété, socle de l’essor du capitalisme bourgeois (version marxiste) ou base d’une organisation économique efficiente (version néo-institutionnaliste à la Douglass North), que de réunifier l’autorité politique, en la séparant justement de la propriété.
Ainsi s’opère ce que Rafe Blaufarb nomme « la Grande Démarcation » (par analogie avec la « Grande Transformation » de Karl Polanyi), qui désemboîte radicalement puissance publique et propriété privée. De deux manières. Tout d’abord en supprimant la patrimonialité de l’autorité publique, avec la suppression des offices vénaux, ce qui permet de (re-)constituer une souveraineté une et indivisible. Ensuite, en unifiant la sphère de la propriété, désormais absolue : le paysan, le propriétaire d’immeubles, sont libérés de toute dépendance envers le seigneur ; la propriété éminente et la propriété utile ne font plus qu’un. De sorte qu’enfin la citoyenneté et la souveraineté nationale deviennent possibles, du fait qu’aucune parcelle d’autorité politique ne peut plus devenir la propriété de celui qui l’exerce. Désormais, le droit de propriété ne peut plus « exister que sur les choses », déclare Target à la tribune de l’Assemblée.
Rafe Blaufarb insiste à juste titre sur la portée immense de cette Grande Démarcation : si « la réforme de la propriété fut l’acte fondateur de la Révolution », c’est parce qu’elle a permis de séparer la propriété et le pouvoir, le privé et le public, c’est-à-dire la société et l’État. Il est alors possible d’accomplir le double idéal de l’égalité civile et de la liberté personnelle. Les rapports au sein de la société civile sont désormais indépendants de tout statut ou privilège, et réglés par le seul droit privé. Ainsi la Révolution française est-elle tout à la fois une révolution civile, politique, institutionnelle, et une révolution sociale : c’est que précisément la distinction entre ces deux sphères a été rendue possible par la Révolution elle-même.

« Ma finte Monsieur, je crois que vot habit d’Officier m’irois ben », estampe, série « Abolition des privilèges (1790) © Gallica/BnF
Les véritables ressorts de l’abolition de la « féodalité » seraient donc d’abord d’ordre constitutionnel, pour les députés et juristes qui sont alors à la manœuvre. Mais les réalités économiques et les contradictions juridiques les rattrapent très vite. Tout d’abord, les députés se divisèrent à propos des limites de l’indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les détenteurs des droits seigneuriaux : dans un premier temps, la plupart de ces droits furent déclarés rachetables, jusqu’à ce que la colère paysanne imposât en 1793 l’abolition complète sans rachat. Dans les années qui suivirent, les députés eurent également bien du mal à faire la part entre les rentes foncières perpétuelles dites féodales et celles qui étaient de nature contractuelle, en principe non entachées de « féodalité ». Dans les années 1810, la question demeurait pendante. Sur ce point, Rafe Blaufarb semble parfois victime de la complexité des arguties juridiques développées par les différents protagonistes du débat. Les pages consacrées à la difficile question des divers types de rentes ne sont pas les plus claires du livre, et certains spécialistes d’histoire agraire y trouveront sans doute beaucoup à redire.
Le débat des années 1790 s’enlisa plus encore à propos du domaine royal, propriété de la couronne, réputé inaliénable. Il n’était plus concevable que l’État fût propriétaire, qu’il s’agît de biens fonciers ou de droits et rentes, car cela aurait perpétué la confusion entre propriété et puissance souveraine. Or, la nationalisation des biens du clergé puis celle des émigrés accrurent soudainement la propriété de l’État. Pour résoudre la contradiction, il fallait tout vendre ! À peine créé, le domaine national devait donc disparaître. Ce qui fut fait, avec la vente des biens nationaux. Mais une question restait posée : si avant 1789 il n’existait pas de distinction entre propriété privée et propriété publique, comment concevoir, après la Grande Démarcation, que l’État, des communes ou des établissements publics, ou pire encore des corps politiques, possèdent des biens (au sens nouveau de la propriété absolue) ? Autrement dit, comment penser la propriété autrement qu’individuelle, sans faire resurgir la confusion entre propriété et pouvoir politique ? Les rédacteurs du Code civil de 1804 eurent bien du mal à s’extirper de ces contradictions.
En réduisant la propriété à une conception absolue, unidimensionnelle et individuelle, pour des raisons politiques parfaitement soutenables, les juristes et députés révolutionnaires ont certes aboli l’Ancien Régime inégalitaire, mais ils ont aussi jeté un discrédit durable sur l’idée de propriété collective. À rebours de cette doxa individualiste libérale, confortée par le Code civil napoléonien, les défenseurs actuels des biens communs nous invitent à concevoir un régime différencié de propriété, une sorte de « faisceau de droits » (distinguant des droits d’usage, de gestion, d’aliénation…), contribuant à désacraliser la propriété pour en faire non plus un totem mais un outil au service du bonheur commun. Tels sont à la fois l’apport inestimable et les limites manifestes de l’héritage révolutionnaire en France, que le livre érudit de Rafe Blaufarb nous aide à repenser.










![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)

