La première caractéristique des Lionnes, l’énorme roman de Lucy Ellmann traduit par Claro, c’est l’extrême simplicité de sa structure. Cela commence par une voix narrative fonctionnant à l’objectivité : un observateur anonyme campe en quelques paragraphes une scène animalière, sous la forme d’un commentaire empathique sans excès, du genre de ceux qu’offrent à satiété les bonnes émissions de télévision consacrées à la vie sauvage.
Lucy Ellmann, Les lionnes. Trad. de l’anglais par Claro. Seuil, 1 152 p., 27 €

Lucy Ellmann © Amy Jordison
En l’occurrence, il s’agit, sans surprise, d’une de ces séquences obligées, légèrement anthropomorphiques, de toilettage de bébés couguars (le lion américain, une sorte de gros chat arboricole, jaunâtre, appelé aussi puma), tout cela montré (conté) dans un registre écologique très actuel. Mais le tableau est court, presque immédiatement interrompu par une tout autre écriture, une formidable, déferlante, répétitive (tous les fragments de phrases sont annoncés et donc reliés par la formule minimale « le fait que… ») logorrhée qui fonctionne au contraire à la subjectivité pure, puisqu’il s’agit de reproduire sous forme de monologue le flux de la petite voix intérieure accompagnant une mère de famille, nombreuse selon les normes modernes (quatre enfants dont une adolescente de quatorze ans issue d’un premier lit et révoltée, comme il fallait s’y attendre), qui ne cesse de culpabiliser à propos de tout et surtout d’elle-même, de sa propre fragilité (elle vient à peine de guérir d’un cancer), de son manque d’autorité, de ses diverses incompétences.
Ce dispositif dramatique en deux actes alternés ne se modifiera plus et permettra de faire évoluer en parallèle deux intrigues qui comportent beaucoup de points communs, la femelle couguar réchappant par miracle d’une série de catastrophes (capture de ses petits, longue traque de chasseurs surarmés, dans une extraordinaire atmosphère de peur hystérique du sauvage, enfin enfermement dans un zoo où l’infortunée retrouve sa progéniture), la femme esclave volontaire de son foyer s’épuisant à confectionner des gâteaux qu’elle vend afin de participer un peu aux dépenses modestes du ménage, en butte à la libido bestiale d’un voisin trumpiste qui manque de la tuer, elle et ses enfants, sauvés in extremis par l’héroïsme de la fille aînée. Bref, un champ/contrechamp néanmoins fort déséquilibré puisque moins du dixième du texte suit la lionne dans ses pérégrinations erratiques à la recherche de ses lionceaux, le cours tumultueux d’une conscience humaine en désarroi se taillant dans l’histoire, si l’on ose dire, la part du lion.
Une telle structure est éminemment lisible et ne risque à aucun moment de faire déraper le lecteur, ce qui constitue un des premiers mérites du roman. Bien qu’il soit d’une taille démesurée et à vrai dire excessive – plus encore que d’honorables bestsellers d’autrefois comme Autant en emporte le vent ou Babbitt de Sinclair Lewis qui, en 1922, mettait en scène la misère intellectuelle et morale de l’american way of life à travers un anti-héros de la classe moyenne habitant « Hauteurs fleuries » dans un quartier moderne de Phoenix, Arizona – et bien qu’il fourmille de détails que seule une bonne connaissance de la quotidienneté américaine, dans un quartier plutôt aéré d’une petite ville de province, permet d’éclairer, Les lionnes n’est pas ennuyeux, ce qui représente une gageure et une manière d’exploit.
Cet intérêt qui ne faiblit pas tient en partie à la personnalité de l’héroïne, cette pauvre femme qui trime dans sa cuisine à fabriquer des tartes dont elle ne cesse de se remémorer les ingrédients, les tours de main nécessaires à leur réussite, environnée de livres de gastronomie dont les ménagères américaines sont d’autant plus friandes qu’elles se montrent, en général, incapables d’élaborer ne fût-ce qu’un café buvable. Anti-héroïque par excellence, mal dans sa peau, manquant de confiance en elle à un degré rare, attachée à son passé de petite fille, à sa chère maman décédée, d’une façon à la fois pleurarde et viscérale, ne sachant trop si elle hait ou désire le salopard suant amateur d’armes qui lui vend la nourriture pour ses poules (car, dans cette existence de ruralité dévoyée, il n’y a plus aucune place pour la piètre université locale où elle donnait naguère de vagues cours, le concept d’université, aux États-Unis, recouvrant toute une gamme d’activités dont les niveaux s’étagent entre jardin d’enfants et Harvard), elle est une victime pathétique qui exaspère et apitoie le lecteur.
Victime avant tout d’une solitude effroyable, passée à ressasser minuscules pensées effilochées, grandes obsessions morbides et surtout peur omniprésente (peur du froid, de la nuit, des ours, des tireurs fous) ; privée les trois quarts du temps de son second mari, qu’elle adore et à qui elle se cramponne comme une naufragée à sa bouée – il travaille au loin dans l’entretien des ponts et ne la retrouve pas tous les soirs ; privée de ses enfants qui sont à l’école, elle rumine terreurs et rancœurs tout en façonnant sa pâte et ses seules distractions sont la livraison des tartes et les sorties en supermarché où elle se trouve parfois bloquée lors d’une montée des eaux polluées de l’Ohio – nous sommes en effet tout près de Columbus, ville sinistre où, un soir, cherchant à échapper à un motel lugubre, nous fûmes arrêtés dans notre progression vers un restaurant chinois situé à cinquante mètres, de l’autre côté de la rue, par un shérif affolé de voir circuler sur deux pattes, de nuit, deux êtres qui pourtant avaient toute l’apparence d’humanoïdes.
L’Amérique dans ses profondeurs ! À se flinguer ! C’est la seconde et plus importante raison qui fait de ce livre une réussite socio-critique de premier ordre. Son arrière-plan d’enquête débouche, sans hargne ni volonté explicite de dénonciation, sans militantisme avéré, sur une autopsie politique. Et celle-ci, d’une justesse – donc d’une virulence – absolue, montre que l’Amérique de Trump est dans une situation préfasciste, nouveau rapprochement avec le chef-d’œuvre de Sinclair Lewis, paru à la veille des années 1930, avant qu’un sursaut démocratique, dans ce pays édifié à partir du génocide des populations autochtones (thème largement présent dans Les lionnes) et l’exploitation des esclaves noirs importés, n’aboutisse au New Deal de Roosevelt.
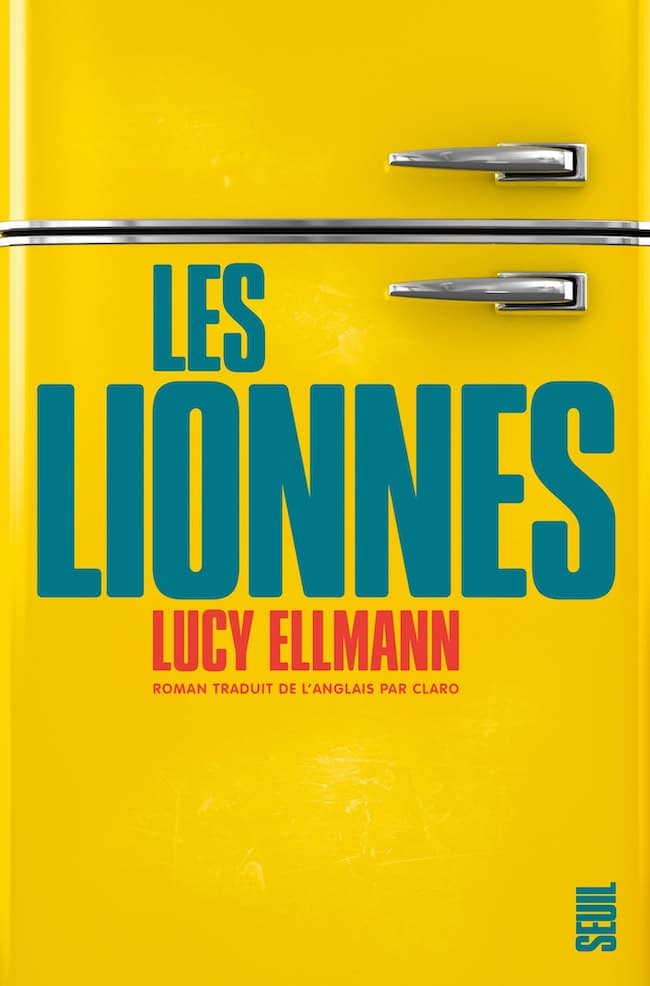
Lucy Ellmann, qui d’ailleurs a quitté son Illinois natal pour l’Europe (Édimbourg), connaît intimement l’état lamentable de l’Union. Elle le restitue sans fard dans son roman via les gémissements, les jeux de mots hasardeux, les chansonnettes idiotes, les éructations de sa pâtissière d’occasion – un grand bravo au traducteur, Claro, qui a dû s’échiner pour trouver approximations et équivalences en français de cette langue chaotique mais toujours claire, à bout de souffle mais cohérente et accusatrice sans désespérance.
C’est pourquoi, pour ce reliquat bien caché d’espoir en l’Amérique, réfléchissant à un texte littéralement bourré de références au cinéma (à travers le culte des acteurs uniquement, dont la pâtissière, plus midinette que critique avertie, revoit à la télévision les rôles, entre deux pétrissages, sans même soupçonner, comme les 9/10e des spectateurs, américains ou français, qu’ils sont dirigés par quelqu’un qu’on appelle réalisateur), j’avais pensé pour titrer cet article au film de John Ford (1941), Qu’elle était verte ma vallée, tourné juste après Les raisins de la colère, soit un brin d’espoir nostalgique après l’âpreté de la satire sociale.
Lucy Ellmann est toutefois, et c’est un signe des temps, moins optimiste que John Ford, et on lui sait gré de n’avoir terminé son livre que sur un demi happy end. « Happy », parce que tout de même la lionne a retrouvé ses petits, comme la mère poule fauteuse de tartes sa nichée intacte. « Demi », parce qu’être couguar et finir dans un zoo sordide n’est pas précisément un sort enviable, pas plus que n’échappe à la logorrhée féminine (et féministe), au moment même où elle cesse, « le fait que… » la fille aînée, Stacy, dont la présence d’esprit et le courage ont sauvé la famille et qui pourtant « semble éprouver un lien de complicité avec cette pauvre créature » (celle du zoo), ne restera pas à coup sûr indemne de la folie meurtrière du suprémacisme blanc sous la chape de plomb (de chasse) du trumpisme.
Les lionnes est donc un excellent livre, sans aucun doute. Un « grand livre » ? Ah ! ça, c’est une autre paire de manches, et la discussion là-dessus nous entraînerait loin. Qu’il suffise de noter que les critiques anglo-saxons un peu rapides qui ont comparé Les lionnes aux romans de Melville ou de Joyce font le plus évident tort à la romancière, qui se situe – et ce n’est déjà pas si mal – dans la catégorie très restreinte du talent, non dans celle du génie.
Car dans une œuvre de génie, voyez-vous, ce qui importe est presque moins ce qui est dit que ce qui reste inconnu, mystérieux aux yeux du lecteur et souvent de l’auteur lui-même. Qu’est-ce que c’est, Moby Dick ? Sûrement pas l’histoire d’une baleine blanche et d’un capitaine de navire fou. Qui sont Bouvard et Pécuchet, qui est Marcel et quel rapport entretient-il avec Proust ? Ce qui empêche de répondre à ces questions définit le chef-d’œuvre total, celui après la lecture duquel il demeure toujours, dans l’esprit du lecteur, ce reste qu’André Breton appelle un « infracassable noyau de nuit ». Les lionnes est un livre diurne, parfaitement limpide et comestible comme une tarte réussie. Il ne comporte pas de reste. On le lira avec le plus grand profit, on n’en rêvera pas demain. Pas plus que de Babbitt d’ailleurs, qui valut pourtant à son auteur le prix Nobel.












