Henri III et Henri IV se croisent aujourd’hui en librairie dans deux ouvrages que tout oppose. Auteur de nombreuses biographies, Simone Bertière publie Henri IV et la Providence. L’historien Nicolas Le Roux rassemble des articles dans Portraits d’un royaume. Henri III, la noblesse et la Ligue.
Simone Bertière, Henri IV et la Providence. De Fallois, 331 p., 22 €
Nicolas Le Roux, Portraits d’un royaume. Henri III, la noblesse et la Ligue. Passés composés, 389 p., 23 €
Simone Bertière est disciple de Jacqueline de Romilly. Nicolas Le Roux est disciple de Denis Crouzet et Jean-Marie Constant. Simone Bertière avait fait parler Clytemnestre dans une Apologie de l’héroïne tragique, et se définissait comme un « électron libre », mal accueillie par les historiens qui la considèrent comme une aimable fantaisiste [1]. La même année, en 2016, Nicolas Le Roux publiait un long article intitulé « Henri IV. Le roi du miracle », où il examinait les circonstances de son arrivée au pouvoir, qui a pu « apparaître comme la preuve de sa vocation providentielle [2] ». Coïncidence ? Réponse de la bergère au berger ? Simone Bertière cite Crouzet dans sa bibliographie, et Constant qui tranche sur le lot des nombreux travaux sur Henri IV – dont aucun ne répond aux questions qu’elle se pose –, mais pas Le Roux, qui ne la cite pas non plus.

Henri IV, dessin de Pierre Dumonstier (1568) © Gallica/BnF
Les deux Henri, petit-fils et petit-neveu de François Ier, n’étaient ni l’un ni l’autre destinés à recevoir la couronne de France. Henri III, d’abord duc d’Anjou, puis roi de Pologne, en hérite après deux frères défunts. Les fils de Catherine de Médicis étant morts sans laisser d’héritier mâle, c’est leur cousin Henri de Navarre qui succède à Henri III. Avec lui, les Bourbons, une branche cadette des descendants de saint Louis, s’installent sur le trône et y resteront jusqu’au XIXe siècle. Quel que soit le rôle du miracle ou de la Providence dans leur avènement, ils finiront tous deux assassinés, Henri III à mi-chemin du livre de Le Roux, Henri IV dix ans après le dénouement de Bertière, qui arrête son ouvrage en 1600 : la Providence se retire puisque le royaume a retrouvé la paix – après la Saint-Barthélemy, huit guerres civiles meurtrières, et toutes les façons de mourir sauf dans son lit. Les voies de Dieu sont impénétrables, mais on espère comme Woody Allen qu’Il avait une bonne excuse.
Simone Bertière se glisse dans les pensées intimes du jeune Navarre, complétées d’une chronologie et d’un catalogue des principaux protagonistes. Elle s’autorise « un maximum d’humour » et des libertés avec la langue neutre propre à l’exposé historique, adoptant un ton primesautier, des expressions familières, comme « pourrir la vie » ou « le gratin aristocratique » ; Navarre « traîne ses guêtres », sa mère « fait les boutiques » en vue de son mariage. L’usage du discours indirect libre ne signale pas toujours si elle fait parler son héros de source sûre ou en lui prêtant les paroles appropriées à ce qu’on sait de lui et de la situation où il les prononce. Elle n’invente rien, précise l’introduction, mais faute de notes on sait rarement si c’est elle ou lui qui pense tout haut. Son ouvrage ne se lit pas pour autant comme un roman, mais il a le mérite de clarifier les mouvements d’âmes et d’alliances qui alimentent les conflits.
Nicolas Le Roux, lui, ne se permet aucune familiarité, aucune facilité, il étaie les propos par quarante pages de notes serrées, par des références impeccables. Pas question non plus de céder à la « tentation biographique », ses cas exemplaires visent à montrer comment un individu « utilise les ressources du champ social et des réseaux dans lesquels il évolue », en adoptant des postures qui varient selon les circonstances. Inutile de dire qu’il ne cite jamais Dumas, même quand il détaille les carrières de Bussy et Montsoreau, Caylus, Schomberg et Maugiron, La Molle et Coconat, qui, grâce à l’indigne romancier, offrent quelques repères au lecteur moyen étourdi par une rafale de noms. Devant ce modèle de sérieux, on se rappelle l’indignation exprimée par les historiens quand Patrice Chéreau s’était permis d’ignorer leurs travaux en filmant une Reine Margot assez indifférente à leurs vérités historiques.

Henri III, dessin de Jean de Court (1581) © Gallica/BnF
En tout cas, l’article de 2016 le confirme, Henri IV soutenait personnellement que « Dieu lui a mis le sceptre entre les mains », et l’un de ses plus illustres partisans, Philippe Duplessis-Mornay, lui écrivit dès la mort de Henri III que « Dieu, qui vous a conduict par la main, sire, jusques sur le throsne, vous y asserra et establira lui mesmes ». Mais c’est d’abord la force de la loi salique qui lui assure un transfert de fidélité de la part de nombreux officiers royaux, et ses victoires militaires qui contribuent à lui rallier une partie de la noblesse chevaleresque avant sa conversion. Les combats d’Arques et d’Ivry « ont constitué une sorte de sacre guerrier », avec « transfert de sacralité en direction de l’État ». Un catholique « politique » comme Pierre de L’Estoile ne doute pas que la Providence l’ait soutenu sur le champ de bataille. Dieu combattait à ses côtés. Une fois son royaume conquis à coups d’épée, Navarre le protestant concède que Paris vaut bien une messe.
Plus qu’à la dimension politique de cette double conversion, Bertière s’intéresse au « retour en force du religieux », qui rend d’autant plus pressante la réflexion requise de l’historien des mentalités « dans ce XVIe siècle où vacillent tous les repères », ce climat d’intense religiosité susceptible d’éclairer notre propre quotidien. Son objet ici est « une plongée dans le vécu ». Elle reconstitue l’enfance rustique au pays des Béarnais « gais et bons vivants par nature », les premiers trublions de la Réforme et leur stratégie de plus en plus agressive, la royauté qui oscille sans cesse entre la répression et une relative tolérance, les pressions exercées par les radicaux des deux bords. En Navarre, le couple d’Albret se montre ouvert aux idées nouvelles, mais bientôt la rupture se creuse entre eux. Jeanne adhère au calvinisme ; Antoine, plus modéré, est compromis entre les deux camps, et, à l’avènement de l’enfant Charles IX, il renonce à la régence en faveur de Catherine de Médicis. C’est Catherine qui accueille le jeune Henri pris entre deux feux parmi ses propres enfants pour parfaire son éducation. Des liens d’amitié se nouent entre lui et Charles, tandis qu’à l’extérieur de leur bulle la régente s’efforce en vain de faire coexister les deux factions. Les réformés obtiennent la liberté de conscience, mais ils réclament la liberté de culte, et leurs actions se font de plus en plus violentes. Ils pillent et saccagent les églises, abattent les statues, profanent les sépultures.
Pendant la première guerre de Religion, les assassinats et les chasses à l’homme se multiplient. Poltrot de Méré tue François de Guise de trois coups de pistolet dans le dos, tandis que Condé, chef des troupes huguenotes, livre Le Havre aux Anglais. Coligny fait marcher sur Paris une armée de reîtres auxquels il a sans doute, faute d’autre argent, promis le sac de la capitale. En chemin, ils pillent l’abbaye de Cluny et massacrent ses moines. Jeanne, qui a repris possession de son fils, l’entraîne avec elle dans la rébellion armée. C’est dans ce climat, estime Simone Bertière, que le jeune Navarre commence à douter de la pureté des objectifs huguenots, et c’est alors que se forge sa mission : faire prévaloir la paix, à l’inverse des projets de sa mère ; non pas assurer le triomphe du calvinisme, mais réconcilier les deux religions. Cependant, c’est Jeanne qui le persuade qu’il est l’élu de la Providence, choisi par Dieu pour prendre le flambeau qu’a refusé son père. « La Providence le maintient en formation permanente, entraîné à se renouveler et à rebondir. »

Le massacre de la Saint-Barthélemy sent l’improvisation. L’opération devait se limiter à occire un groupe de rebelles avérés, mais elle est impossible à arrêter car les exécutants qui haïssent les huguenots font du zèle. Cette fois, la Providence « n’y est pas allée de main morte. La Saint Barthélemy clôt la phase conquérante de la Réforme en France ». Chez Henri, qui ne peut que s’interroger sur le pourquoi de cet événement, un constat s’impose : « les desseins de Dieu nous échappent, il est présomptueux de s’en faire l’interprète et plus encore de prétendre y interférer ». D’où la vanité des grands desseins. Mais l’hécatombe est sélective : elle lui a ouvert la voie, sans qu’il ait à la joncher lui-même des cadavres d’amis encombrants.
Simone Bertière s’emploie à corriger les traits durablement attachés à la famille royale : oui, Henri sent mauvais ; mais non, ce n’est pas un rustre, Marguerite n’est pas une débauchée, ni François d’Alençon un dégénéré, juste un être odieux. Quant à Catherine, déjà réhabilitée par les historiens, elle manipule ses fils, se sert de Navarre mais travaille en coulisse à rétablir la paix, face aux Malcontents, aux Ligueurs, aux Politiques. Les rebelles avancent pour argument qu’ils luttent pour délivrer le roi d’un entourage corrompu. Navarre, qui a le sens de l’État, désapprouve les attaques contre l’autorité royale. Il soutient la monarchie. Le pouvoir le dénonce publiquement comme rebelle, tout en négociant avec lui en secret. Après l’assassinat des Guise, il combat en tête des armées du roi pour lui reconquérir son trône, mais trop tard : Henri III est assassiné à son tour. Sur son lit de mort, il ordonne à son entourage de reconnaître Navarre pour son successeur. Le Béarnais, qui espérait hériter un jour d’un royaume apaisé par leur effort conjugué, se retrouve seul. Jamais la paix n’a paru aussi lointaine. Les catholiques modérés réclament sa conversion, les protestants, une partition qui leur assurerait un pouvoir autonome dans le sud-ouest. Heureusement, Henri III a fait pour lui une partie du « sale travail » en décapitant la Ligue. La Providence ne l’abandonne pas. Entre autres faveurs, elle va neutraliser son plus puissant ennemi, le roi d’Espagne. C’est en souverain victorieux sur les champs de bataille militaire, politique et diplomatique qu’Henri IV accepte enfin de se convertir. L’exemple qu’il offre, et qui lui a survécu, c’est un modèle d’humanité sécularisé.
Henri III, imprévisible, complexe, déchiré entre des aspirations contradictoires chez Bertière, est relégué en sous-titre dans les Portraits d’un royaume. Le Roux propose « une plongée dans les tensions qui marquèrent la noblesse française », dans les « différentes formes de la légitimité politique qui furent à l’œuvre à l’époque d’Henri III ». L’ouvrage rassemble douze articles parus entre 1994 et 2015, introduits par diverses cautions conceptuelles. On passe de la pratique du duel à la « posture anti-curiale » de Montaigne, des formes variées de turbulences rebelles au réseau des amis de Monsieur, François d’Alençon, avec force chiffres et noms de personnages, illustres ou obscurs, leurs réseaux de parents, domestiques, créanciers, fournisseurs. La disgrâce des ministres de Henri III, démis de leurs fonctions en 1588 sans motif déclaré, fournit l’occasion d’une nouvelle série de portraits illustrant la diversité de leurs réactions – amertume, douleur, stoïcisme chrétien –, de leurs modèles philosophiques et des difficultés financières qui conduisent certains d’entre eux à se chercher d’autres maîtres. Vient ensuite le pacte de vengeance d’éminentes figures féminines engagées dans la guerre avec leur réseau de parents, enfants, prêteurs etc., puis l’ascension et la chute de Guy de Lanssac, dont « les entreprises navales et les projets belliqueux pouvaient constituer un dérivatif à des frustrations sociales ou à des impasses politiques ». Ce faisant, ils relèvent aussi d’une idéologie valorisant les actions d’éclat propres à la vertu aristocratique. Selon la brève conclusion, ces parcours divers « témoignent du fait que les conséquences des actions sont rarement conformes aux intentions qui leur présidaient [sic] ».
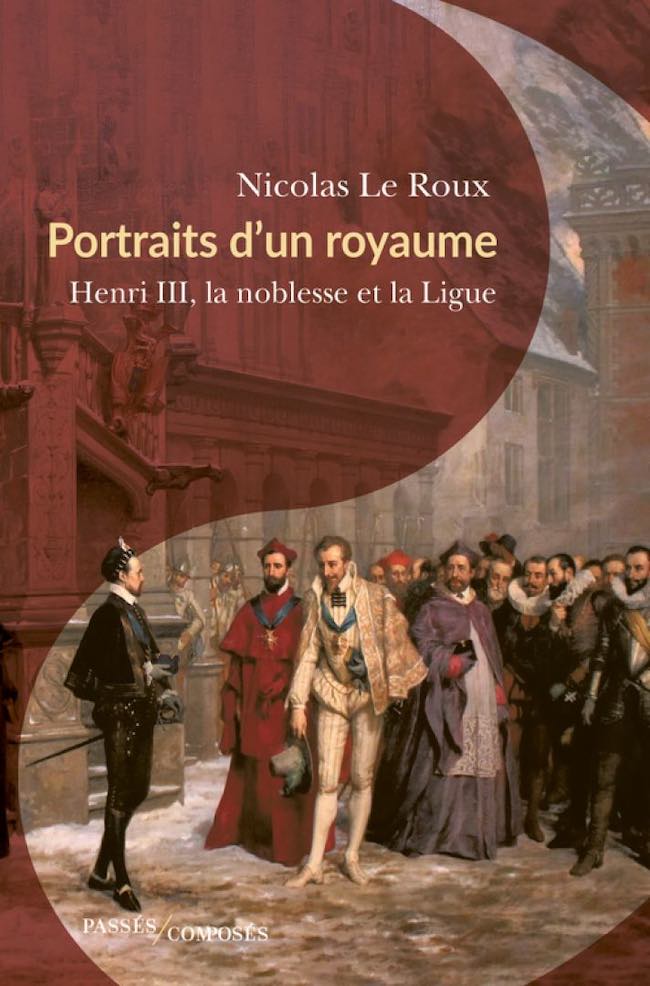
La Ligue, souligne Le Roux, était d’abord un mouvement d’autodéfense ou de conservatisme communautaire. La religion n’occupait pas toujours la première place dans les conflits de pouvoir, même si les partis rivaux l’évoquent constamment pour justifier leurs pires violences. Les plus sanguinaires peuvent faire preuve d’une profonde dévotion, déclarant agir pour la gloire de Dieu, l’honneur du roi et le bien public, même quand le désir de vengeance est le motif prioritaire. Parmi les cas traités, la carrière de Philippe de Mercœur, duc de Lorraine, a droit à une trentaine de pages. Ce vibrion se nourrit à tous les râteliers, retourne vingt, trente fois sa veste selon ses intérêts du moment, chaque fois en déclarant sa parfaite loyauté au parti adopté. Il travaille tantôt pour, tantôt contre le roi de France, le roi d’Espagne, les ligueurs, avant de se mettre au service de l’ex-hérétique converti Henri IV.
En quoi et de quoi ce Mercœur, « qui avait pour seul titre celui de beau-frère du souverain », est-il représentatif exactement, ce n’est pas précisé, mais Le Roux parle à bon droit d’univers chaotique, où la parole donnée a peu de poids, où la foi et ses principes sont régulièrement bafoués par les infractions au code de l’honneur autant qu’aux lois de l’Évangile, où la vendetta joue un rôle structurel. Ces « portraits » montrent le royaume en proie à une grande confusion politique, une mosaïque de clans constitués par les liens de parenté, les appétits et les intérêts matériels communs autant que par les affinités religieuses. Sans établir comme Simone Bertière une projection explicite des guerres civiles sur notre présent, Nicolas Le Roux nous peint un univers mental redevenu dangereusement proche.
-
Entretien avec Marianne Payot, L’Express, 27 juillet 2016.
-
Accessible en ligne.












